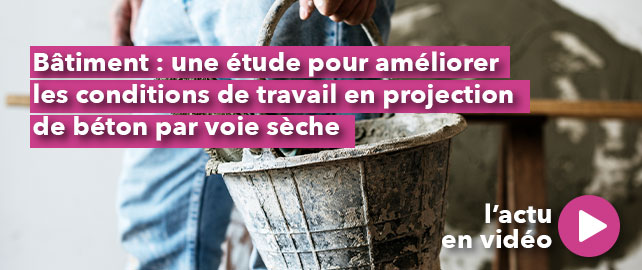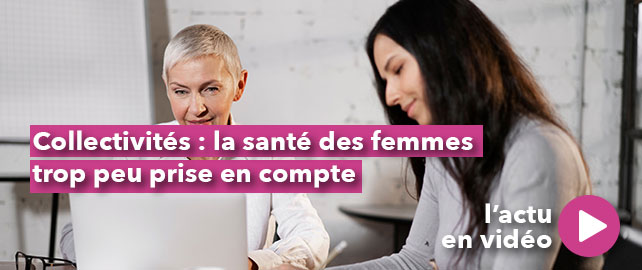Avec 2 756 réponses, cette forte participation révèle un réel besoin d’expression sur un sujet encore trop souvent passé sous silence. Ces pathologies entraînent douleurs chroniques, fatigue, troubles de la concentration et difficultés à se rendre au travail.
Des diagnostics longs et des droits peu connus
Parmi les personnes souffrant de ces douleurs :
- 52 % disposent d’un diagnostic précis,
- 38 % n’ont jamais consulté de médecin,
- 10 % sont en errance médicale.
Le diagnostic reste difficile à obtenir. Le délai dépasse souvent 7 ans, même s’il tend à diminuer chez les moins de 35 ans. Une fois le diagnostic posé, 84 % des salariées sont suivies par un spécialiste.
L’accès aux droits, en revanche, reste très limité. Seules 6 % disposent d’une reconnaissance ALD et 10 % d’une RQTH, alors que 77 % présentent des symptômes handicapants une ou plusieurs fois par mois.
La médecine du travail est peu mobilisée : seulement 6 % des personnes concernées y ont recours, alors que 86 % déclarent que leurs douleurs ont un impact sur leur activité professionnelle.
Des conséquences concrètes sur le travail et les carrières
Les douleurs menstruelles invalidantes entraînent :
- des difficultés de concentration pour 82 % des répondantes,
- une baisse de productivité pour 64 %,
- des difficultés à se rendre au travail pour 60 %.
L’absentéisme reste limité : 59 % des répondantes s’absentent rarement ou jamais. Cette situation traduit un présentéisme contraint.
Les carrières sont également affectées. 20% ont déjà renoncé à un poste en raison de leur état de santé et 30 % estiment que leur évolution professionnelle est freinée.
Un sujet encore tabou en entreprise
Pour 89 % des répondantes, ces douleurs ne sont jamais évoquées dans l’entreprise. Les aménagements sont rares : 92 % ne bénéficient d’aucun ajustement et 84 % n’ont pas informé leur employeur.
Les mesures souhaitées concernent :
- la sensibilisation des collègues (67 %),
- une communication plus ouverte avec le management (56 %),
- l’accès au télétravail (78 %),
- la mise en place de journées d’absence spécifiques et rémunérées (63 %).
L’enquête rappelle que ces pathologies dépassent la sphère intime et constituent un véritable enjeu de santé au travail et d’égalité professionnelle. La reconnaissance des droits, le recours à la médecine du travail et des aménagements adaptés sont essentiels pour soutenir les salariées concernées.
Cliquez ici pour accéder au replay des résultats de l’enquête présentés à Préventica Bordeaux.
En savoir plus :