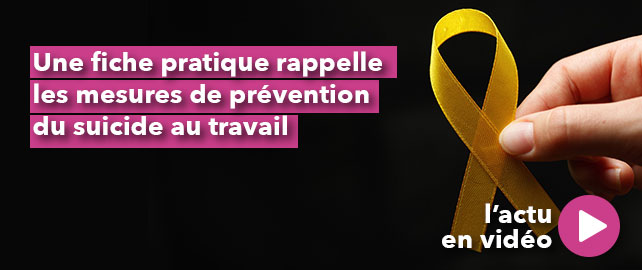Quelle est la situation actuelle du bien-être au travail
en Suisse ? Constatez-vous des différences avec la situation en
France ?
La situation actuelle a en partie péjoré les conditions de
travail. De manière générale, elles se sont durcies pendant la
pandémie, bien que le télétravail ait été favorable à certaines
personnes. Beaucoup de dispositifs de santé au travail ont été
mis en pause, notamment dans les projets de prévention, mais on
constate aujourd’hui une reprise. Actuellement, nous pouvons
observer deux mouvements : celui des entreprises qui usent leurs
collaborateurs jusqu’à la corde. Et de l’autre côté, une prise de
conscience en termes de santé au travail, et la volonté de créer
une entreprise « sanitogène », en contradiction avec « pathogène
» ; qui provoque la santé plutôt que la maladie.
Concernant les risques psychosociaux, il y a une meilleure prise
en compte au niveau gouvernemental. Les médecins et l’inspection
du travail sont également mieux formés sur ces problématiques.
Mais pour ma part, et avec mes collègues, nous préférons parler
de « facteurs » psychosociaux plutôt que de risques, car la
plupart des éléments sont neutres en soi. Par exemple, «
l’ambiance au travail » est un facteur de risques si elle est
mauvaise, mais une ressource si elle est bonne. Nous essayons
d’ouvrir un peu ce regard-là pour prendre en compte les bonnes
pratiques et les maintenir.
Je ne travaille pas en France, donc je n’ai pas vraiment de
regard sur la situation actuelle, mais j’ai le sentiment que
certaines problématiques y sont mieux prises en compte, même s’il
reste encore de nombreux chantier.
Quelles sont les évolutions à prévoir ?
Dans les grandes organisations, il y a une difficulté à mettre en
place de réelles actions de prévention. Il y a beaucoup
d’annonces pour peu de résultats visibles. Beaucoup d’entreprises
pensent que les démarches sont coûteuses, alors qu’elles ne le
sont pas tellement et les retours sur investissements sont réels.
Mais ils surviennent seulement sur le long terme. C’est pourquoi
des changements culturels doivent être réalisés dans les
entreprises.
Vous avez mis en place des « Démarches participatives
pour une analyse des conditions de travail en termes de stress et
ressources au travail (risques psychosociaux) pour des petits
collectifs ». De quoi s’agit-il ?
Concrètement, nous réalisons des entretiens avec des petits
groupes ou individuellement pour savoir comment se déroule une
journée au travail, quels sont les facteurs de stress, et les
facteurs de ressource qu’ils rencontrent. Nous nous apercevons
qu’il existe entre les collaborateurs des fils rouges importants,
et nous tirons à partir de cela des conclusions assez objectives
sur les facteurs de stress chronique en présence, mais aussi les
facteurs de ressource chronique.
L’idée est ensuite de voir comment réduire les contraintes et de
maintenir et d’augmenter les aspects positifs, en partant de
l’idée que le collaborateur est expert de son travail. Les
équipes ont beaucoup de pistes d’amélioration qu’il faut
recueillir puis accompagner les cadres dans la mise en pratique
des pistes réalistes
Préférer les « facteurs » aux « risques » psychosociaux
En Suisse comme en France et ailleurs, la crise sanitaire et l’accélération de la transformation numérique ont eu de nombreux impacts sur l’organisation du travail et le bien-être des salariés. Le point avec Nadia Droz, psychologue spécialisée en santé au travail.

Nadia DROZ
Psychologue (spécialiste en santé au travail)
Fédération Suisse Des Psychologues (Fsp)
- #RPS
- 02/03/2022