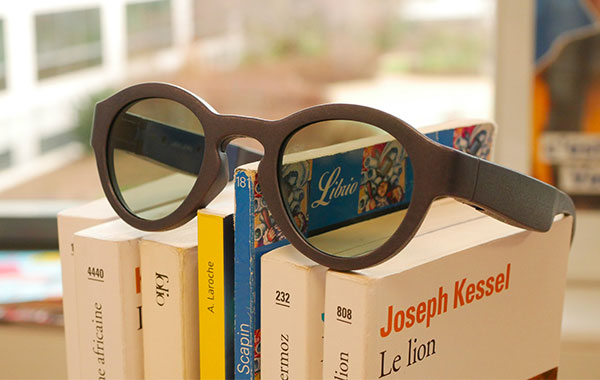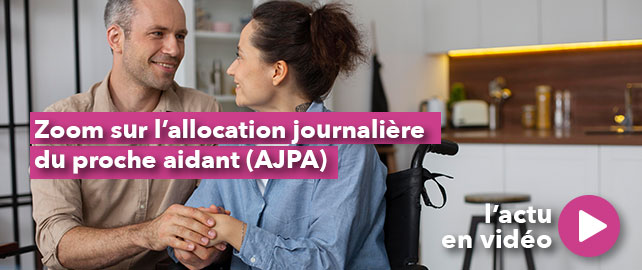La loi dite « loi handicap », adoptée sous le mandat de Jacques Chirac, a permis de mettre en lumière les difficultés concrètes que vivaient les personnes en situation de handicap en France. Lors de son abrogation, pour la première fois, les quatre familles de handicap étaient reconnues (moteur, sensoriel, cognitif, psychique) dans tous les domaines de la vie, y compris au travail. 20 ans après, voici ce qu’il reste de cette promesse d’inclusion.
La loi de 2005 : l’avènement de l’inclusion au travail

Loi du 11 février 2005 : un nouveau regard sur le handicap
La « loi handicap » a ainsi été adoptée le 11 février 2005 à l’Assemblée nationale. Elle avait pour ambition d’instaurer un principe d’égalité de traitement entre tous les citoyens, y compris ceux étant en situation de handicap. Le texte a marqué une avancée significative dans la conception du handicap en France, en s’éloignant du modèle médical traditionnel pour adopter une approche plus sociale et inclusive. Premier levier incontournable, la nouvelle définition du « handicap ». Selon les termes de la loi n°2005-102 : « constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive, d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. » Dès lors, les personnes concernées ont pu obtenir de nouveaux droits fondamentaux.
- Le droit à la compensation du handicap
- Le droit à l’accessibilité
- Le droit à la scolarisation en milieu ordinaire
- Le droit à l’emploi et à l’insertion professionnelle
Inclusion du handicap au travail : de quoi parle-t-on ?
L’un des pans du texte était donc de favoriser l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Ou plutôt, de réaffirmer cette ambition. La mesure phare, 6 % d’emplois réservés par entreprise aux personnes handicapée, était déjà présente dans la loi de 1987. Le texte de 2005, lui, a étendu cette obligation d’emploi à la fonction publique mais également renforcé les sanctions financières en cas de non-respect. Cette dynamique est toujours à l’œuvre aujourd’hui.
20 ans après : les effets en demi-teinte de la loi de 2005

De plus en plus d’inclusivité au travail
Dans les faits, la loi du 11 février 2005 a mis en place des mesures structurantes pour l’accession des personnes en situation de handicap au monde professionnel : quotas d’emploi, obligation d’accessibilité, dispositifs de maintien dans l’emploi, principe de retour dans l'entreprise en cas d'inaptitude, l’incitation à la négociation, dispositif d’aides financières destinées à faciliter l'insertion etc. Grâce à ces efforts, les recrutements des personnes concernées dans la fonction publique en France a triplé en 20 ans, atteignant plus de 34 000 embauches en 2023. Elle compte aujourd’hui 5,9 % de personnes en situation de handicap dans ses effectifs. Leur taux de chômage est passé de 17 % à 12 %, mais est encore bien loin du taux global de 7 %. Du chemin a donc bel et bien été fait, mais reste encore à faire.
Handicap : des barrières et freins à l’emploi subsistent
Cependant, 20 ans plus tard, si des avancées majeures ont été réalisées, de nombreux freins subsistent. En réalité, l’obligation est loin d’être respectée par toutes les entreprises. 55 % des entreprises d’au moins 20 salariés ne la respectent pas, selon le ministère du Travail. De plus, la réglementation d’origine a été progressivement assouplie depuis 2005. Un décalage entre les ambitions et les résultats dénoncé par de nombreuses associations et institutions, comme le Défenseur des droits et la Commission nationale consultative des droits de l’homme. Par exemple, le handicap était encore en 2023 le motif principal des saisines en matière de discrimination auprès du Défenseur des droits. Dans la même logique, le maintien dans l’emploi reste une problématique majeure, avec moins de 8 000 maintiens annuels en 2023.
Handicap au travail : aller plus loin dans l’inclusion

Le rôle des entreprises dans l’inclusivité
Des progrès restent cependant à faire. Un rapport de l’ONU dénonçait en 2021 une approche paternaliste des politiques du handicap en France. En entreprise, les biais ont également la peau dure. Il est donc de la responsabilité des employeurs, RH et managers d’appuyer avec empathie l'insertion des personnes en situation de handicap au sein des organisations. Plusieurs étapes clés, intégrées dans les démarches RSE ou QVCT peuvent le permettre.
Rendre son processus de recrutement plus inclusif (entretiens alternatifs, placer le handicap au cœur de l’expérience collaborateur)
Créer un environnement de travail adapté (encourager la reconnaissance du handicap, aménager les horaires et les postes de travail, vérifier l’accessibilité)
Nommer un référent handicap
Sensibiliser ses équipes aux formes de handicap
Si besoin, l’association OETH a publié ses étapes clés recommandées pour avancer sur cette voie.
Handicap en entreprise : aller plus loin dans l’inclusion
Malgré ces limites, l’obligation d’emploi imposée par la loi (ainsi que les autres mesures) représente une opportunité d’évolution des mentalités dans le monde du travail. De plus en plus de sociétés adoptent une démarche proactive sur le sujet. Du travail reste encore à faire pour permettre aux pratiques managériales de s’adapter pleinement. Premier enjeu : la vie sociale. Si la loi de 2005 reposait sur une approche essentiellement matérielle, le handicap implique également des interactions et des dynamiques collectives abimées par la situation. Les managers et les salariés doivent être formés sur ses questions pour permettre une inclusion pérenne. Deuxième enjeu : les troubles psychiques ou neurologiques, les « handicaps invisibles » (attention, autisme, phobies), encore trop souvent stigmatisés sur le lieu de travail. Néanmoins, comme le rappelle le ministère du Travail : « les jalons que la loi du 11 février 2005 a posés doivent être poursuivis et les efforts maintenus pour rendre la société plus inclusive ».
En savoir plus :
- « Capacité de transformation des organisations vers des futurs inclusifs et temporalités organisationnelles : de l’aménagement raisonnable à l’aménagement durable », Thèse de doctorat, Université de Poitiers.
- Loi du 11 février 2005, Légifrance
- « La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, 20 ans après », article ministère du Travail
- « L’intérêt de parler du handicap en entreprise », article Préventica, avril 2024