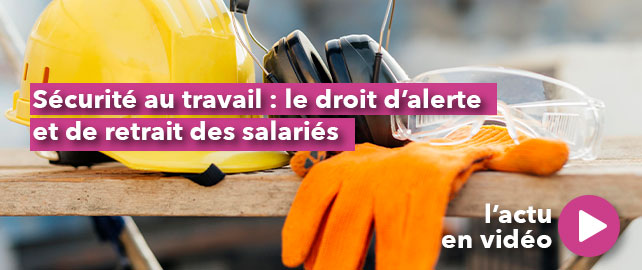Le 22 juin 1981 était adoptée à Genève la convention n° 155 de l'Organisation internationale du travail sur la sécurité et la santé des travailleurs.
Entrée en vigueur le 11 août 1983, elle a été ratifiée par 87 payés.
C’est au tour de la France, 42 ans plus tard, avec la publication d’une loi n° 2025-983 du 22 octobre 2025 (JORF du 23 octobre 2025), autorisant la ratification de la convention OIT n° 155 par le Président de la République.
1. Un aboutissement historique …
Il s’agit d’une étape majeure dans la consolidation de notre ordre juridique, qui s’inscrit dans un contexte international où la sécurité et la santé ont été érigés au 5e rang des principes socle et droits fondamentaux au travail (Conférence internationale du Travail du 10 juin 2022), aux côtés de :
- la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective ;
- l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire ;
- l’abolition effective du travail des enfants ;
- l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.
Cet acte vient parachever l’objectif pour la France de ratifier l’ensemble des 10 conventions fondamentales de l’OIT, à savoir dans l’ordre historique :
- Convention n° 29 sur le travail forcé (1930)
- Convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948)
- Convention n° 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective (1949)
- Convention n° 100 sur l'égalité de rémunération (1951)
- Convention n° 105 sur l'abolition du travail forcé (1957)
- Convention n° 111 concernant la discrimination (emploi et profession) de 1958
- Convention n° 138 sur l'âge minimum (1973)
- Convention n° 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs (1981)
- Convention n° 182 sur les pires formes de travail des enfants (1999)
- Convention n° 187 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail (2006).
A noter, sans rentrer dans le détail, qu’il existe de nombreuses autres conventions OIT dites « techniques » (C) qui intéressent le champ de la santé et de la sécurité au travail, de manière thématique, ainsi que de nombreux protocoles (P) et recommandations (R).
Au total, la France aura ainsi ratifié 129 conventions OIT, et se hisse au 2ème rang des pays en termes de ratifications. Le volontarisme est donc à la hauteur du rôle joué par la France au sein de l’OIT, dont elle est membre fondateur.
Cela témoigne d’un dynamisme du droit international, quoi qu’on en dise et malgré les atteintes actuelles portées au multilatéralisme. La France entend porter cet engagement universaliste à l’occasion du Sommet social mondial et dans le cadre de la Présidence française du G7 en 2026.
Plus que jamais, ces normes minimales de protection sont en effet indispensables dans une économie mondialisée où les déséquilibres et distorsions sont très marqués.
Il s’agit également d’un enjeu de responsabilité RSE devenu essentiel dans le droit « dur », pour les groupes et entreprises soumises au reporting en matière de durabilité et au devoir de vigilance en matière de responsabilité sociale et environnementale sur leur chaîne de valeur (cf. directives CSRD et CS3D en cours de révision dans le cadre du projet de « paquet » OMNIBUS en cours de discussion devant le Parlement européen).
2. Tout change mais rien ne change ?
En pratique, cette ratification s’avère neutre au niveau du droit français qui intègre la convention n° 155 dans toutes ses dimensions en termes de politique publique nationale de promotion de la santé et de la sécurité au travail tant pour le secteur public que pour le secteur privé.
Elle ne nécessitera donc pas de mesures d’adaptation particulières du cadre législatif et réglementaire actuel, dèjà très avancé et issu largement de transpositions du droit de l’Union européenne.
L’objectif de prévention qu’elle porte et qui constitue le consensus de référence, aura vocation à être décliné dans le nouveau plan Santé au travail pour 2026-30 (PST 5), actuellement en cours d’élaboration.
Pour autant, la portée n’est pas que symbolique, compte tenu de la place des traités et conventions internationales ratifiées dans l’ordre juridique national, qui acquièrent sous réserve de réciprocité une autorité supra-légale (cf. art. 55 de la Constitution).
Sans rentrer dans l’exégèse du texte de la convention, certaines dispositions font particulièrement écho au regard de leurs incidences pratiques, telles que :
- La définition de la « santé », qui déjà à l’époque, englobait la santé mentale au travail (de manière très visionnaire au vu du phénomène RPS) ;
- L’exigence de prévention des accidents et atteintes à la santé résultant du travail, « en réduisant au minimum les causes des risques inhérents au milieu de travail, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable » (principe de proportionnalité souvent méconnu) ;
- L’inclusion des questions de sécurité, d'hygiène et de milieu de travail dans les programmes d'éducation et de formation à tous les niveaux, y compris dans l'enseignement supérieur (parent pauvre souvent des programmes d’enseignement en amont de la vie professionnelle) ;
- L’exigence essentielle de coopération des employeurs et des travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise dans la mise en œuvre de mesures visant à garantir des milieux de travail sûrs et salubres.
3. Et après ?
Si personne ne peut contester l’importance politique et juridique de cette ratification, certaines voix dissonantes se sont toutefois exprimées, notamment dans le cadre du rapport présenté à l’Assemblée nationale au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi, parlant d’un « rendez-vous manqué ».
Si certaines réformes récentes ont pu laisser penser à un affaiblissement de la santé-sécurité au travail, on ne peut toutefois parler de régression, mais d’ajustements nécessaires pour maintenir de grands équilibres. La ratification de cette convention OIT en témoigne d’ailleurs, eu égard à son caractère juridiquement contraignant pour l’Etat.
Rappelons également que sans attendre celle-ci, l’Etat a pris l’initiative de renforcer depuis cet été sa politique de répression pénale (cf. précédente chronique), comme « bras armé » de la lutte contre les accidents graves et mortels du travail.
Cela étant, la logique d’Etat-providence interventionniste ayant largement atteint ses limites, l’effectivité dans la prévention ne peut reposer que sur une approche purement réglementaire et répressive.
Il importe que l’action publique puisse aussi favoriser l’initiative, l’innovation, l’appropriation et la facilitation de la démarche de prévention dans les organisations, face à un environnement réglementaire très complexe, exigeant, pour toutes les entreprises, notamment les TPE et PE.
En particulier, la culture sécurité ne se décrète pas par voie réglementaire, et pour l’ensemble des acteurs concernés (dirigeants, travailleurs, représentants du personnel), toutes les énergies doivent être mobilisées avec les bons leviers.