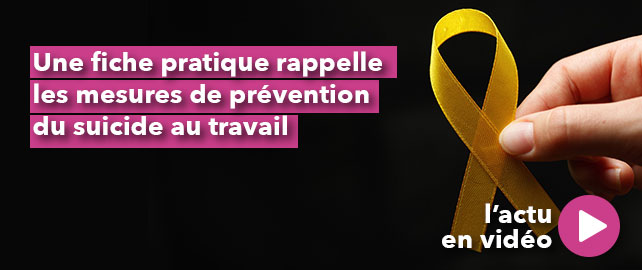« Psychologue dite ‘racialisée’, je me suis toujours sentie
concernée par cette question. Je peux d’ailleurs parfois moi-même
être soumise à l’assignation sociale comme aux discriminations
qui en découlent. La présomption d’origine reste souvent très
présente dans les rapports sociaux pour les personnes qui ne sont
pas purement blanches. Le statut social n’est pas un bouclier à
toute épreuve. Aussi, j’ai voulu montrer à travers différents
récits de patients, comment chacun en se saisissant de la
rencontre entre leur histoire professionnelle et l’histoire à
l’origine de la fabrique des stigmates parvient peu à peu à
démêler les différents fils qui le font souffrir, et ce, malgré
le piège de situations de travail qui les contraignent à produire
de manière non consciente des comportements défensifs individuels
afin de protéger leur intégrité psychique. En clair, les patients
souffrent, mais ils ne sont pas sans réaction, ils mettent en
place des comportements qui interviennent de manière clandestine,
c’est-à-dire qu’ils ne savent pas qu’ils les ont installés et ces
défenses ont surtout pour but de les préserver de la souffrance
au travail.
Ces discriminations subies au travail, comme nous le verrons dans
chacune des sept histoires que j’ai choisies parce qu’elles sont
représentatives de ce que j’entends habituellement, sont souvent
liées aux origines ou à la couleur de la peau en intersection
parfois avec le sexe ou la classe. Leur formulation toujours
douloureuse est rarement exprimée d’emblée. Les raisons sont
souvent la peur de ne pas être compris, la peur du déni. Dans
chacun des textes présentés, le lecteur entre dans un nouvel
univers, comme dans une enquête qui démêle la part intime de la
part sociétale, manière de souligner que la question de la
discrimination liée à la « race » n’est jamais binaire. La
plupart de ces patients portent en eux les traces des stéréotypes
qu’on leur colle à la peau et certains peuvent croire, malgré
eux, à la réalité du classement des humains suivant une logique
de racialisation.
Ces récits cliniques sont les récits des verbatims. Il n’y a pas
eu d’enregistrement. Chaque texte suit les dires du patient (dont
l’anonymat a été conservé) séance après séance. Cette continuité
permet de transposer la rigueur et la précision clinique d’un
suivi thérapeutique. »
Le racisme ordinaire au travail
Marie-France Custos-Lucidi, psychologue, retrace les expériences de discrimination au travail vécues par sept de ses patients.