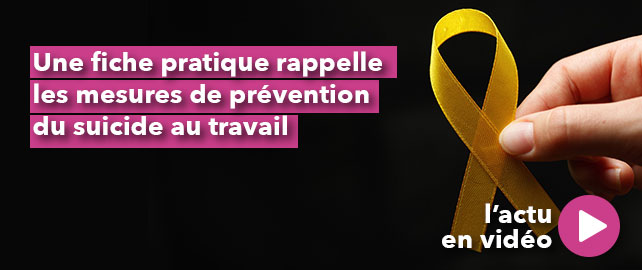Spécialiste du suicide et des souffrances au travail, Michel Debout sait que depuis 1929, il y a un lien entre crise économique et sociale et risque suicidaire. Lors de la crise de 1929, il y a eu une surmortalité par suicide dans les années 31/32. La même observation a été faite pendant la crise de 2008. Pour vérifier si cela va se produire à la suite de la crise de la Covid-19, Michel Debout et l’IFOP ont mené une étude en septembre 2020, soit entre le premier et le deuxième confinement, sur les pensées suicidaires des Français.
Qu’avez-vous constaté avec cette étude ?
Ce que j’ai remarqué c’est que ce que l’on a appelé confinement 1
et 2 n’étaient pas du tout les mêmes situations. Pendant le
confinement 1, c’était « Restez chez vous ». Personne ne
travaillait, sauf par télétravail, mais c’était encore le début.
Il y a eu un arrêt de l’activité économique et sociale. Seuls
certains métiers étaient indispensables. Pendant le confinement
2, qui à mon avis n’en était pas un, c’était « Tous au travail »,
sauf quelques métiers (de la restauration, événementiel,
culture…). Ces métiers-là ont eu l’impression de mesures
discriminatoires. Plutôt que de créer de la solidarité entre les
Français - comme au premier confinement où nous faisions front
ensemble face au virus – cela a créé du chacun pour soi. On a
créé de « l’archipellisation » des Français.
Quelles sont les conséquences d’un tel phénomène
?
Cette situation a créé des dévalorisations, des replis, des
désocialisations et derrière tout ça il y a des pensées
suicidaires.
Des groupes de la population sont plus atteints par les pensées
suicidaires que la moyenne de la population. Il s’agit des
chômeurs, des jeunes dont les étudiants et tous ceux qui
travaillent dans les activités qui sont empêchées.
Un sentiment d’injustice est né et il a deux conséquences. Une
dépressive : je ne vaux rien, je ne suis pas au niveau et une
autre colérique : on est en colère contre le système, on ne peut
pas sortir de cette précarité, on ne voit pas la fin, il n’y a
aucune perspective.
Quelles solutions à mettre en place ?
Il faudrait que chaque chômeur puisse rencontrer un médecin dans
les deux mois qui suivent sa perte de travail, pour faire un
bilan de son état et voir les conséquences de cette perte
d’emploi sur son état général et psychique. Pour dire aux
chômeurs « on ne vous laisse pas tomber ».
Pour les étudiants, il faut reconstruire les espaces de
rencontre, pour lutter contre le problème d’isolement. Quand vous
faites du téléenseignement toute la journée et que vous n’avez
plus le droit de sortir, vous n’avez plus de lieux pour échanger,
pour vivre. Il faut donc donner des espaces de rencontre aux
jeunes.
Enfin, concernant ceux qui ne peuvent plus travailler, il faut se
focaliser sur la santé des dirigeants de petite entreprise. Eux
sont très marqués par la situation économique. La perte de
l’emploi veut dire un dépôt de bilan, l’abandon d’un projet. Il
faut mettre en place, avec les chambres des métiers par exemple,
des messages de solidarité, de rencontres, « on va vous aider pas
seulement financièrement mais aussi humainement ». La réponse est
dans le lien humai, - parfois spécifique avec le médecin, un
soignant, un psychiatre ou non spécifique avec les collègues, les
confrères, les amis - qui permet de continuer de vivre dans une
société.
Ceux qui ont repris le travail sont-ils épargnés par les
pensées suicidaires ?
Pour eux, on observe des situations de travail qui sont
difficiles. Le télétravail a des côtés positifs mais est aussi
rejeté lorsqu’on le présente comme l’alternative au travail en
présentiel. Les gens veulent travailler quelque part, avec
d’autres, ils veulent voir leurs collègues, etc.
Quand l’organisation du travail ne répond pas aux attentes des
personnes vous avez des situations de sur-stress, de burn-out.
Les conditions de travail qu’on vous impose ne correspondent pas
à ce que vous attendez. Il faut produire, sur-produire même. Il
existe une pression sur la production qui donne souvent du
harcèlement moral au travail.
Que préconisez-vous ?
Il a fallu attendre novembre pour que le ministre de la Santé
parle de santé mentale et de traumatismes. Il aurait fallu
prendre des mesures dès le début de l’été 2020. Il y a un
manquement coupable des autorités sanitaires.
Il faut des mesures de prévention pour éviter les passages à
l‘acte suicidaire mais aussi des mesures pour éviter les effets
de la colère sur l’ordre social lui-même. C’est le psychisme de
l’humain qui est mis en tension. Il suffit d’une goutte pour que
tout déborde. Et cela donne de la violence. Contre soi, ce qui
conduit au suicide ou contre autrui.