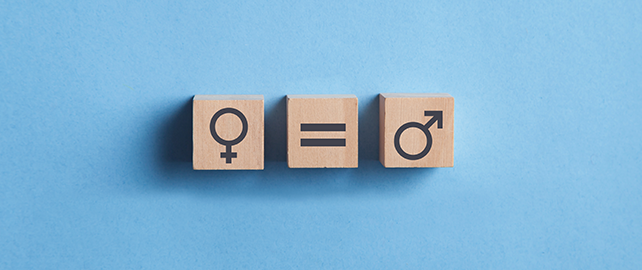Qu’est-ce qui a poussé la DARES à conduire cette étude ?
Quels étaient les constats préliminaires ?
Il existe beaucoup de travaux, notamment sociologiques, qui
mettent en évidence des différences dans les conditions de
travail entre les femmes et les hommes. Néanmoins, sur ces
questions-là, il manquait une évaluation quantitative avec un
panorama complet et une vision globale de ces inégalités.
Beaucoup d’études portent sur un métier, ou un secteur
spécifique. Ici, nous nous sommes intéressés à cette question des
conditions de travail en exploitant l’enquête « Conditions de travail » de la
Dares, qui est extrêmement riche. J’ai distingué 88 métiers et
retenu 74 items de conditions de travail qui recouvrent plusieurs
aspects de la pénibilité, ainsi qu’une gamme étendue de facteurs
de RPS, telles que les contraintes d’organisation du travail, les
exigences émotionnelles, le soutien social, le manque
d’autonomie…
L’idée était d’avoir une vision la plus globale possible, avec
une certaine neutralité dans le constat pour faire un diagnostic
quantifié, afin de savoir véritablement où situer les inégalités
de conditions de travail entre les femmes et les hommes.
Quelles sont les grandes tendances observées
?
Ce qui ressort très clairement, c’est que les hommes – quels que
soient les grands groupes de métiers auxquels ils appartiennent –
sont davantage exposés aux risques physiques, alors que les
femmes sont, elles, plus exposées aux différents facteurs de RPS.
Il y a tout d’abord une « ségrégation professionnelle », selon la
nature de l’activité. Ainsi, dans les métiers « physiques », on
retrouve essentiellement des hommes. Et dans les métiers
davantage exposés aux RPS, on retrouve surtout des femmes.
Cependant, au sein même des métiers, les femmes et les hommes
sont aussi exposés à des conditions de travail différentes.
Pour mener cette étude, j’ai essayé de répartir les métiers selon
leur prédominance sexuée, ce qui a amené à constituer cinq
groupes. Tout d’abord, deux grands groupes de métiers
masculinisés, avec un premier principalement constitué de métiers
d’ouvriers très exposés à la pénibilité physique avec peu
d’autonomie, et un autre groupe où, à l’inverse, les salariés
sont peu exposés à ces facteurs de risques. Au sein des métiers
féminisés, on peut aussi distinguer deux groupes : les métiers «
de bureau » et les métiers de service. Les salariés des métiers
de bureau sont relativement épargnés à des conditions de travail
difficiles, alors que ceux des métiers de service sont plus
exposés que la moyenne à tous les risques. Enfin, il y a un
dernier groupe, composé de métiers mixtes. Ici, on va retrouver
des salariés plutôt épargnés par les risques physiques,
modérément exposés aux risques en général, avec un peu plus
d’autonomie que les autres salariés en moyenne.
La pénibilité, le manque d’autonomie et les exigences
émotionnelles apparaissent comme les trois facteurs de risques
qui différencient le plus les métiers.
Est-il possible d’en dégager des pistes d’évolution
?
Cette étude est un premier panorama, donc il n’y a pas réellement
de point de comparaison. Elle a permis de quantifier des faits
dont on avait connaissance, mais qui n’étaient pas clairement
mesurés. En particulier, lorsqu’on compare les hommes aux femmes,
il faut bien avoir en tête que les durées de travail ne sont pas
les mêmes, les femmes occupant bien plus souvent que les hommes
des emplois à temps partiel. Et il apparait que, à temps de
travail identique, les femmes restent plus exposées aux RPS que
les hommes. Ce qui est ressorti aussi, et qui peut paraître
étonnant, c’est que dans les métiers féminisés de bureau, où plus
de 80% des salariés sont des femmes, ce sont les hommes qui sont
les plus exposés à tous les types de risque.
Nous pouvons évidemment nous interroger sur les facteurs de ces
disparités, d’autant que certaines caractéristiques des postes
occupés ne peuvent être identifiées dans les données de
l’enquête. En tout état de cause, les résultats interrogent sur
la rémunération associée aux métiers. Quand le salaire est la
réponse au travail prescrit, il n’inclut pas toutes les activités
invisibles liées pourtant au fait de pouvoir bien effectuer son
travail. Typiquement, une aide-soignante ne fait pas seulement ce
qui est inscrit sur sa fiche de poste ; elle prend parfois plus
de temps pour écouter et rassurer le patient, etc. Et c’est du
temps et une charge émotionnelle qui peuvent ne pas être
comptabilisés et justement rémunérés.
De manière générale, je m’attendais à certains résultats, mais je
ne m’attendais pas à ce qu’ils apparaissent aussi clairement.
En savoir plus
- Métiers « de femmes », métiers « d’hommes » : en quoi les conditions de travail des femmes et des hommes diffèrent-elles ?, Insee Références, mars 2022