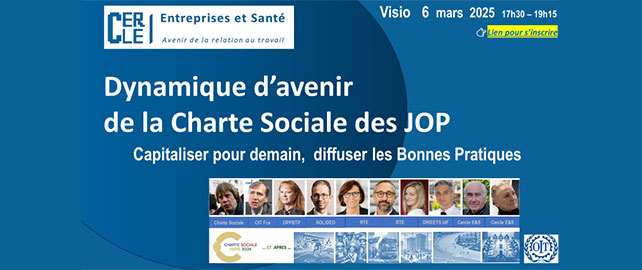Il y a quelques années, on opposait volontiers fonctionnaires attachés à un travail de bureau et salariés du privé évoluant dans un environnement industriel. Aujourd'hui le transfert de nouvelles compétences vers les collectivités a profondément modifié les métiers des fonctionnaires territoriaux et on y retrouve la plupart des risques professionnels du secteur privé.
Les chiffres des accidents du travail et des maladies professionnelle dans la Fonction Publique Territoriale
Le fonds National de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles créé par la loi du 17 juillet 2001 a notamment pour mission d'établir, au plan national, des statistiques dans le domaine des accidents de travail et des maladies professionnelles.
Pour 2012, 35 616 événements ont été recensés pour les 445 773
agents couverts.
Sur les 35 616 accidents ou maladies recensés, 67,7 % ont été à
l’origine d’un arrêt de travail.
La moyenne des jours d’arrêt s’élève à 38,6 jours.
Elle reste fortement élevée pour les maladies avec 111,5 jours et
une médiane à 74 jours.
Le taux de sinistralité pour l’année 2012 s’établit à 8,0 %.
U n événement mortel a été dénombré pour
2012.
n événement mortel a été dénombré pour
2012.
La grande majorité des évènements a eu lieu dans les communes
avec 69 % des événements (elles représentent 58 % de la
population territoriale de la CNRACL hors SDIS).
La présence de quelques cas extrêmes tire la moyenne des jours
d’arrêt vers le haut. La médiane des OPH est la plus élevée avec
17 jours. Les communautés de communes, les CCAS et les
départements ont une médiane de jours d’arrêts moins élevée que
les autres types de collectivité.
Les chutes de plain-pied et de hauteur représentent 34 %
des accidents de service et une moyenne d’arrêts de 31
jours.
Très fréquentes et beaucoup moins anodines qu’on ne le pense, les
glissades et chutes de plain-pied ou de hauteur peuvent avoir des
conséquences lourdes. Cela dépend en partie de la dangerosité de
l’environnement proche du travailleur. C’est la conjonction de
plusieurs facteurs de risques qui rend une situation
dangereuse... Il est donc important de savoir les identifier afin
d’aménager l’environnement et l’organisation du travail et de
sécuriser l’agent.
L’analyse des données statistiques de la CNAMTS met en évidence
qu’ils représentent plus d’un cinquième des accidents de travail,
occasionnent près d’un quart des journées perdues.

Comme pour 2010 et 2011, les tâches les plus accidentogènes (hors
‘autres tâches) sont ‘l’entretien, nettoyage et rangement’ avec
33 %. La ‘coordination, contrôle, surveillance accueil’ est la
deuxième tâche la plus impactée avec 25 %.
Ripeurs, trieurs, conducteurs de véhicules... Les agents
des métiers de la collecte et du tri des déchets ménagers sont
exposés à de fortes contraintes physiques et
psychiques.
Le nombre d’accidents du travail pour 1 000 salariés dans le
traitement des déchets ménagers est plus de 2 fois supérieur à la
moyenne nationale. Les accidents survenant dans les métiers de la
collecte (1 salarié sur 8 accidentés chaque année), sont les plus
graves.
Ici, la tâche ‘collecte des ordures ménagères’ recense 9,4 % des
accidents de service pour lesquels la tâche est précisée, 36,4
jours en moyenne de jours d’arrêt et une médiane de 15 jours
Comme chaque année le n° tableau 57 ‘Affections périarticulaires
provoquées par certains gestes et postures de travail’ est
prédominant dans 73,8 % des cas et une moyenne de jours d’arrêt
de 111,3 jours.
Quels sont les risques professionnels les plus importants ?
 Le risque routier
Le risque routier
Le risque routier encouru par les agents fait partie intégrante
des risques professionnels.
L’analyse des éléments matériels permet de dégager un certain
nombre d’accidents de service liés aux risques routiers.
Répartition des accidents routiers (chiffres 2012)
|
Accidents routiers |
Nombre événements |
Part avec arrêt |
Moyenne jours arrêt associés |
|
Accident de service |
999 |
71,0% |
40,3 |
|
Accident de trajet |
4 330 |
69,8% |
38,3 |
|
Total général |
5 329 |
70,0% |
38,7 |
Evolution des accidents routiers
|
Année |
Taux de sinistralité |
Taux de fréquence |
Indice de fréquence |
Taux de gravité |
|
2007 |
0,8% |
2,5 |
4,0 |
0,1 |
|
2008 |
1,0% |
3,9 |
6,3 |
0,2 |
|
2009 |
1,1% |
4,5 |
7,2 |
0,2 |
|
2010 |
1,2% |
5,0 |
8,1 |
0,2 |
|
2011 |
1,2% |
5,0 |
8,1 |
0,2 |
|
2012 |
1,2% |
5,2 |
8,4 |
0,2 |
Le taux de sinistralité pour les accidents routiers est
stable.
70 % ont été à l’origine d’un arrêt de travail.
Les risques psychosociaux (RPS)
Les risques psychosociaux tels que définis au niveau européen
incluent le stress, les violences internes dont le harcèlement
moral et sexuel, les violences externes et la souffrance ou le
mal-être au travail.
L'origine des risques psychosociaux est multifactorielle :
contenu du travail à effectuer, organisation et relations de
travail, environnement physique et socio-économique...
Il est donc difficile de les évaluer de manière chiffrée. En
effet le phénomène des RPS est complexe et encore mal défini.
Cependant au travers de quelques items des éléments matériels
(violence, contact avec personne agitée), une estimation est
possible. Elle sera à étudier sur les années à venir.
L’observation des éléments matériels permet de dégager un
certain nombre d’événements liés aux RPS : 538 événements sont
recensés, dont 62,1 % avec arrêt et une moyenne de durée congés
associée de 56 jours.
Globalement, la part des événements reliés aux RPS est de 2,2 %,
pour 2012 en augmentation par rapport à 2011 (0,9 %).
Les troubles musculo-squelettiques (TMS)
 Les TMS recouvrent un grand nombre de
pathologies et de lésions d’origine professionnelle, touchant les
membres supérieurs et inférieurs (épaule ; coude ; poignet ;
genou) ainsi que le dos (rachis lombaire) au niveau des
articulations.
Les TMS recouvrent un grand nombre de
pathologies et de lésions d’origine professionnelle, touchant les
membres supérieurs et inférieurs (épaule ; coude ; poignet ;
genou) ainsi que le dos (rachis lombaire) au niveau des
articulations.
Ces troubles sont aussi appelés affections péri-articulaires
d’hyper sollicitation du fait qu’elles sont souvent liées à des
mouvements contraignants, répétitifs et/ou forcés dans le
travail.
Douloureux, les TMS se traduisent par une gêne dans les
mouvements, une perte de dextérité, une incapacité à effectuer
certains gestes ou à adopter certaines postures, susceptibles
d’évoluer en un handicap sérieux et une invalidité physique.
Les TMS sont reconnus d’origine professionnelle en référence aux
tableaux « maladies » annexés au Code de la Sécurité sociale :
- Tableau n° 57 « affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail "
- Tableau n° 69 « affections provoquées par les vibrations et chocs ... ».
- Tableau n° 79 « lésions chroniques du ménisque ».
- Tableau n° 97 « affections du rachis lombaire liées aux vibrations ».
- Tableau n° 98 « affections du rachis lombaire liées aux manutentions »
Le FNP dans son programme d’action 2011-2013 a reconduit les TMS
dans les thèmes ou risques prioritaires.
Les TMS concernent 92,2 % des maladies professionnelles
et 94 % des jours d’arrêt pour la fonction publique
territoriale.
La prévention du risque CMR (Cancérogène, Mutagène et Reprotoxique)
 Les agents de la Fonction
publique territoriale sont amenés à manipuler des produits dont
la Fiche de Données de Sécurité (FDS) signale un caractère
toxique, nocif, corrosif, irritant, inflammable, explosif,
comburant ou dangereux pour l’environnement. Ils peuvent aussi
mélanger des produits incompatibles. Ils sont alors exposés à des
risques d’intoxication (contact avec la peau, inhalation,
ingestion), brûlure par contact avec la peau ou les yeux,
irritation. Des risques d’incendie, d’explosion, de pollution de
l’environnement, de dégagement de vapeurs nocives sont également
possibles.
Les agents de la Fonction
publique territoriale sont amenés à manipuler des produits dont
la Fiche de Données de Sécurité (FDS) signale un caractère
toxique, nocif, corrosif, irritant, inflammable, explosif,
comburant ou dangereux pour l’environnement. Ils peuvent aussi
mélanger des produits incompatibles. Ils sont alors exposés à des
risques d’intoxication (contact avec la peau, inhalation,
ingestion), brûlure par contact avec la peau ou les yeux,
irritation. Des risques d’incendie, d’explosion, de pollution de
l’environnement, de dégagement de vapeurs nocives sont également
possibles.
Les agents des espaces verts (traitement phytosanitaire), des
ateliers (peintures routières et bâtiments, stockage de produits,
mécanique, maintenance, plomberie) et d’entretien sont les plus
concernés.
La prévention du risque CMR fait partie des trois grandes
priorités identifiées par le Fonds national de Prévention de la
CNRACL.
Les CMR concernent tant la prévention que la nécessaire
traçabilité des expositions et son apport à la prévention.
Au-delà de l’amiante, cette problématique recouvre un large
spectre d’agents pathogènes, qui va des produits chimiques aux
poussières de bois en passant par les rayonnements ionisants.
Quels sont les autres risques professionnels présents dans la Fonction Publique Territoriale ?
-
 Risque machine (machines
comportant des parties mobiles ou vibrantes, outils tranchants
- couteaux, scies, tronçonneuses, cutters - vibrations - engins
de chantiers, tracteurs…) : blessure de l’agents utilisant la
machine ou de personnes circulant aux alentours par l’action
mécanique de la machine (coupure, perforation, écrasement,
entraînement,…), risque de troubles dorsolombaires. Ce type de
risque concerne essentiellement les agents des ateliers
(menuiserie, mécanique), des espaces verts, de la voirie et de
la restauration collective.
Risque machine (machines
comportant des parties mobiles ou vibrantes, outils tranchants
- couteaux, scies, tronçonneuses, cutters - vibrations - engins
de chantiers, tracteurs…) : blessure de l’agents utilisant la
machine ou de personnes circulant aux alentours par l’action
mécanique de la machine (coupure, perforation, écrasement,
entraînement,…), risque de troubles dorsolombaires. Ce type de
risque concerne essentiellement les agents des ateliers
(menuiserie, mécanique), des espaces verts, de la voirie et de
la restauration collective.
- Risques liés à l’utilisation d’engins de manutention (chariots élévateurs, ponts roulants, palans, treuils, grues,…). Risque de blessure pouvant être lié à la circulation des engins mobiles (collision, dérapage, écrasement), à la charge manutentionnée (chute, heurt, renversement), aux moyens de manutention (rupture, défaillance) ou à l’environnement (ligne électrique à proximité, manque de visibilité,…). Ces pathologies concernent les agents des ateliers mécaniques et de la maintenance, de la voirie.
- Risques liés à la manutention manuelle : port de charges lourdes, manutention effectuée de façon répétitive et à cadence élevée (stockage par exemple), charges difficiles à manutentionner, mauvaises postures prises par l’agent (dos courbé, charge éloignée du corps). Ces situations entraînent des risques de troubles dorsolombaires (lumbago, lombalgie, sciatique, hernie discale,…) musculaires (contractures, déchirures,…), d’écrasement, de choc. Tous les agents de la Fonction publique sont susceptibles d’être exposés à ces risques.
-
Risques de chute de hauteur (blessure lors de
la chute d’une personne ou causée par la chute de matériel et
d’outils). Les accidents surviennent dans des zones de
circulation présentant des parties en contrebas (escalier,
passerelle, trappe de descente, plate-forme…), lors de
l’utilisation de dispositifs mobiles (échelle, escabeau,
échafaudage…) ou de moyens de fortune (chaise, carton,…).
On rencontre ce type de risque lors de l’élagage ou la taille des arbres, de travaux sur les toitures, de nettoyage en hauteur (vitres,…) ou d’intervention sur l’éclairage public.
- Risque électrique : conducteur nu accessible au personnel (armoire électrique non fermée, ligne électrique aérienne,...), matériel défectueux, absence de consignation d’une installation électrique lors d’une intervention. Le danger d’électrisation ou d’électrocution menace les agents de maintenance (locaux, matériel, éclairage public, intervention dans des tableaux électriques, changements d’ampoules).
- Travail en tranchées : les agents de la voierie et des travaux publics sont soumis à des risques d’effondrement et d’ensevelissement.
- Travaux dans des espaces confinés. Les travaux dans les réseaux d’assainissement peuvent être à l’origine d’asphyxie.
- Travaux par points chauds : projection d’étincelles. risque de brûlure de l’agent, risque de blessure liée aux projections, d’aveuglement lié au rayonnement (soudage), d’incendie ou d’explosion si les travaux sont réalisés à proximité de produits inflammables ou de produits combustibles. Ce type de risque concerne les agents des ateliers et de la maintenance (serrurerie, soudure, meulage…).
-
Ambiances de travail :
- Bruit : risque de surdité , de fatigue ou de gêne dans l’exécution de tâches délicates pour les agents utilisateurs de machines ou d’engins (espaces verts, menuiserie, voirie, serrurerie…), les agents des cantines scolaires et même ceux des locaux d’accueil du public,
- Risque de fatigue visuelle lorsque l’éclairage est insuffisant ou inadapté à la tâche,
- Une mauvaise qualité de l’air (présence de poussières - ciment, amiante, sciures de bois - fumées de soudure, de gaz d’échappement…) peut entraîner une irritation des voies respiratoires ou le déclenchement de maladie professionnelle. Les agents des ateliers et de la maintenance (maçonnerie, menuiserie, mécanique, serrurerie) sont particulièrement exposés,
- Ambiance thermique (postes à température élevée ou basse),
- Conditions climatiques (pluie, neige, gel, froid, chaleur…).
- Travail isolé : ce risque concerne les agents polyvalents des petites collectivités
- Risques biologiques, chimiques, toxicologiques : le risque infectieux survient lors de la manipulation ou le travail à proximité de produits ou matières pouvant contenir des agents infectieux, dans des situations de manque d’hygiène (absence de moyens permettant d’assurer la propreté des agents (sanitaires, vestiaires, douches…) ou de non utilisation des moyens existants. Les services techniques en général et plus particulièrement les agents de collecte d’ordures ménagères, des espaces verts, de la voierie et de l’assainissement sont particulièrement concernés.