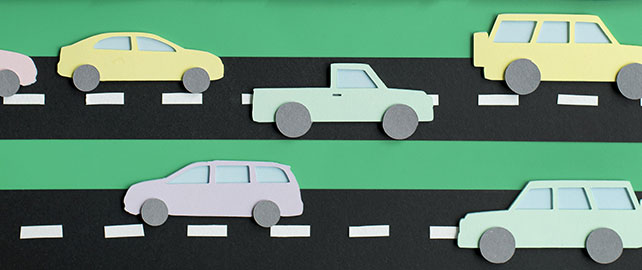En fonction de la nature du déplacement et de l’accident, les
responsabilités de l’employeur ou du conducteur peuvent être
engagées. Un bref point juridique.
En ce qui concerne le risque trajet, la loi
l’assimile à un accident du travail (article L. 411-2 du Code de la Sécurité
sociale). La responsabilité de l’employeur peut donc être
engagée s’il est prouvé que celui-ci joue un rôle dans la
survenue de l’accident. Cependant, la prévention du risque trajet
ne dépend pas d’une obligation légale. L’employeur n’est donc pas
tenu de mettre en œuvre un plan de prévention en ce sens, et ne
sera pas tenu responsable pour manquement dans le présent. Un
plan d’action peut cependant être mis en place, s’il résulte
d’une volonté partagée entre l’employeur et le salarié.
Pour ce qui est du risque mission, il s’agit
également d’un accident du travail (article L. 411-1 du Code de la Sécurité
sociale). Ici cependant, la responsabilité pénale et civile
de l’employeur peut être engagée s’il est établi un manque de
prévention de sa part à l’origine d’un accident de la route. En
effet, la prévention du risque mission s’intègre au document
unique et relève des obligations de l’employeur.
De plus, au-delà des missions de prévention, l’employeur doit prendre toutes « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l’établissement, y compris les travailleurs temporaires » (loi n°91 – 1414 du 31 décembre 1991). Il peut alors être tenu pour responsable si le véhicule de l’entreprise est défectueux ou en mauvais état, par exemple.
Bien sûr, le conducteur salarié n’est pas exempt de
responsabilité en cas d’accident. La responsabilité
pénale du conducteur peut être engagée en cas
d’infraction au Code de la route ou d’accident corporel qu’il
aurait occasionné. En fonction de la cause de l’accident, le
salarié peut également se retrouver en situation de faute grave
devant son employeur et ainsi être licencié (exemple : en cas de
consommation d’alcool au volant).