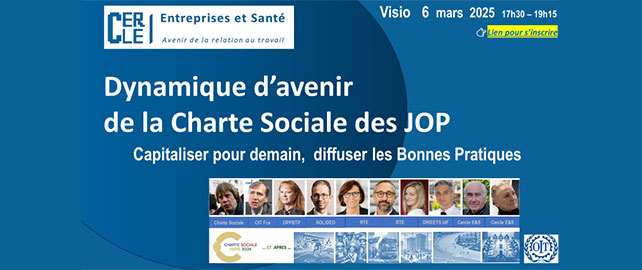Genèse d'une réforme
annoncée
Genèse d'une réforme
annoncée
Une première réforme de la médecine du travail, réalisée en 2002 et 2004, a contribué, par la création des services de santé au travail, à faire évoluer la médecine du travail vers une culture de la promotion de la santé en milieu de travail, conformément aux engagements européens de la France.
Cependant, les questions de santé au travail et de protection des salariés demeurent un enjeu social majeur en raison de l’émergence de risques professionnels nouveaux ou peu pris en compte préalablement (troubles musculo-squelettiques, risques psychosociaux, risques différés dus aux expositions professionnelles à des cancérogènes…) et du vieillissement de la population (adapter les conditions de travail pour permettre le maintien dans l’emploi).
Dans ce contexte, la place croissante accordée aux questions de santé au travail nécessite de poursuivre l’adaptation des missions et de l’organisation des services de santé au travail, alors même que la démographie des médecins du travail subit une évolution préoccupante (-30% des effectifs d’ici 2015). Des réflexions et expérimentations ont été initiées par les pouvoirs publics : large concertation de l’Etat et des partenaires sociaux en particulier, dans le cadre de la conférence tripartite sur les conditions de travail du 27 juin 2008. Le 25 juillet 2008, un document d’orientation a été transmis aux partenaires sociaux. A l’issue de sept séances de négociation, un texte a été élaboré le 11 septembre 2009 mais n’a pas reçu la signature des organisations syndicales de salariés. En l’absence d’accord collectif, le gouvernement propose une réforme des services de santé au travail dont les axes ont été communiqués lors de la réunion du conseil d’orientation sur les conditions de travail du 4 décembre 2009. Cette réforme doit faire l’objet d’un projet de loi déposé au parlement avant la fin de l’année.
 La volonté de conserver les atouts des
services de santé au travail tout en confortant les évolutions
engagées depuis 2002
La volonté de conserver les atouts des
services de santé au travail tout en confortant les évolutions
engagées depuis 2002
Les grands principes sur lesquels repose l’organisation française
du système de santé au travail se doivent d’être conservés à
savoir l’universalité (la médecine du travail doit s’adresser à
l’ensemble des travailleurs) ; la spécialisation et
l’indépendance professionnelle des médecins du travail et la
vocation exclusivement préventive du système de santé au
travail.
Les services de santé au travail constituent le réseau de
prévention le plus proche des entreprises (notamment dans les
plus petites d’entre elles) et l’expertise des médecins du
travail est reconnue.
En revanche, il faut poursuivre l’évolution des services de
médecine du travail, engagée en 2002/2004, à savoir :
- La promotion d’une politique de la santé au
travail efficace par une meilleure prévention dans
l’entreprise (actions collectives adaptées à toutes les
situations de travail et suivis individuels mieux adaptés aux
besoins). Par ailleurs, un suivi médical individuel, adapté par
voie conventionnelle ou réglementaire, prendra davantage en
compte des salariés pour l’instant exclu du système (employés de
maison à temps partiel).
- Le renforcement de la pluridisciplinarité :
accroître le recours des entreprises aux compétences
pluridisciplinaires et s’assurer de la qualité des
intervenants.
- L’assurance d’un meilleur pilotage du système
: promotion de l’échelon régional, de l’innovation pour
restructurer et redynamiser les services de santé au travail
autour d’objectifs qualitatifs et quantitatifs.
- Le développement de l’attractivité de la médecine du
travail et de la coordination entre médecins. Sur ce
dernier point et plus particulièrement sur la question de la
formation des professionnels de la santé au travail, le
gouvernement a confié une mission à Christian Dellacherie, Paul
Frimat et Gilles Leclercq.
Le point de vue du conseil national des médecins sur la
réforme
Réuni en session plénière le 25 juin 2010, le Conseil national
de l’Ordre des médecins a adopté les préconisations suivantes
sur la réforme annoncée de la santé au travail et demande à ce
qu’elles soient reprises dans le texte du projet de loi à venir
:
- L’indépendance des médecins du travail doit être
préservée,
- Le directeur du service de santé au travail doit se centrer
sur un rôle de coordination et d’organisation du travail (doit
être le facilitateur des missions que la loi confie aux
médecins du travail),
- Les objectifs locaux et orientations doivent être mis en
cohérence avec des objectifs nationaux.
- La pénurie médicale n’affecte pas que la médecine du travail
et des solutions innovantes doivent être mises en œuvre sans
porter atteinte à la qualité du service que les salariés et les
employeurs sont en droit d’attendre,
- Il faut offrir des perspectives de carrière à tous les
médecins (passerelles pour donner aux médecins et autres
praticiens de réelles perspectives de reconversion),
- Des médecins généralistes pourraient ainsi, après avis du
conseil départemental de l’Ordre des médecins, faire bénéficier
d’un suivi médical certaines catégories de salariés qui y
échappent à l’heure actuelle (travailleurs à domicile,
saisonniers…). L’accomplissement de ces missions par des
médecins généralistes pourrait s’effectuer au sein du service
de santé au travail sous forme de vacations hebdomadaires.
Le Conseil national refuse une médecine du travail au rabais et
demande que les visites médicales et examens cliniques ne
soient pas déconnectés d’une connaissance du milieu de travail
et des postes de travail.
La coopération avec d’autres professionnels de la santé au
travail serait bénéfique : le médecin du travail restant,
prescripteur, garant et coordinateur de l’équipe
pluridisciplinaire. Certaines tâches, par exemple, pourraient
être déléguées aux infirmiers : entretien de santé au travail
sur la base de protocoles mis en œuvre par les médecins,
certains actes médicaux bien identifiés dans les conditions de
l’article L.4011-1 du code de la santé, l’action en milieu de
travail également selon des protocoles établis par les
médecins. Des assistants de santé au travail (s’ils bénéficient
d’une formation standardisée et validée au plan national)
pourraient aussi réaliser des examens non invasifs, encadré par
le médecin du travail. Le rôle des IPRP ne doit pas non plus
être négligé.
Des conditions doivent être posées quant à l’accès au dossier médical personnel par le médecin du travail (même si cela est justifiable). Le salarié doit notamment donner un accord écrit et ledit dossier doit rester strictement consultable par le médecin : la confidentialité vis à vis de l’employeur doit être respectée même en cas de reprise d’éléments dans le dossier médical de médecine du travail. A l’inverse, le médecin du travail devrait pouvoir compléter le DMP pour que le médecin traitant du salarié ait connaissance des risques professionnels auxquels est exposé son patient.
 Le rapport
Dellacherie-Frimat-Leclercq
Le rapport
Dellacherie-Frimat-Leclercq
Dans un contexte de crise démographique touchant les services de
santé au travail, les Ministres du travail, de la santé et de la
recherche ont confié une mission de réflexion sur la formation
des professionnels de la santé au travail et l’attractivité de
ces métiers à 3 personnalités qualifiées : Christian Dellacherie
(Membre du Conseil économique, social et environnemental), Paul
Frimat (Professeur de médecine du travail à l’Université de Lille
II, praticien hospitalier au CHRU de Lille) et Gilles Leclercq
(Médecin conseil de l’ACMS). Leur rapport a été remis avant
l’été.
Riche de 46 propositions, ce rapport conforte le gouvernement
dans sa volonté de s’appuyer sur la professionnalisation
croissante des services de santé au travail pour rendre les
métiers du secteur plus attractifs. Il invite à poursuivre les
travaux visant à créer une voie de reconversion pérenne vers la
médecine du travail.
Le rapport comporte une quarantaine de propositions axées sur
huit préoccupations principales des auteurs :
- Le développement d’une approche intégrée
interdisciplinaire pour favoriser par la suite un
travail d’équipe de santé au travail. La culture
interdisciplinaire et la communauté d’objectifs partagée entre
les professionnels travaillant dans les services de santé au
travail évitera que la pluridisciplinarité ne se réduise à une
juxtaposition des compétences,
- Le besoin d’ouvrir des perspectives et passerelles de
carrière aux médecins souhaitant se reconvertir vers la
santé au travail,
- La reconstitution du vivier des enseignants
hospitalo-universitaires pour redynamiser la recherche
compte tenu des perspectives démographiques défavorables en
matière d’enseignement,
- Le développement de formations initiales des
professionnels de santé adaptées aux nouvelles missions
marquées par le développement de la pluridisciplinarité,
- La nécessité de valoriser la médecine du travail en
tant que discipline médicale,
- La nécessité de mieux valoriser l’action des services
de santé au travail,
- La nécessité de faire évoluer les mentalités sur la
corrélation santé au travail et performance de
l’entreprise. Renforcer les prérogatives du médecin du
travail en élevant au rang d’une obligation une réponse motivée
écrite de l’employeur qui ne prend pas en considération les
recommandations du médecin du travail.
- La mise en tension des acteurs pour le développement de
dynamiques locales.
Témoignage : Anne Barrier, présidente du Groupement des
infirmier(e)s du Travail (GIT), livre ses impressions quant au
rapport
Dellacherie-Frimat-Leclercq.
Pour elle, il s’agit d’un document pertinent au fait des
problématiques qui concernent les services de santé au travail
: « La réforme opérée en 2004 pour élargir la médecine du
travail s'est avérée très difficile à coordonner. Les
changements actuels permettront de passer d’une approche très
individuelle (c’est-à-dire du médecin au salarié) à une
approche collective: de l’équipe médicale au travailleur. Le
rapport apporte aussi une reconnaissance tout particulière aux
consultations et à l’expertise de l’infirmière […]»
Satisfaite des avancées proposées quant à formation des
différents acteurs de santé au travail, elle souligne quand
même que le diplôme interuniversitaire de santé au travail
(DIUST) devra être reconnu au niveau master au regard du
processus LMD (licence-master-doctorat).
Elle pense que « ce rapport signe une évolution primordiale en
permettant au service de santé au travail de passer de la
prévention secondaire voire tertiaire à la prévention primaire,
voire à la promotion de la santé ! Aujourd’hui on nous donne la
possibilité d’éduquer et de sensibiliser en amont… ».
Anne Barrier met également le doigt sur certaines limites du
rapport qui, selon elle, passe outre le statu de l’ensemble des
infirmières : « Il est nécessaire d’offrir un statut de salarié
protégé à l’ensemble des infirmières en entreprise […] A ce
jour, aucun statut protégeant nos règles professionnelles
n’apparaît dans le Code du travail. Cela signifie-t-il qu’elles
sont négociables ? Il est urgent d’avancer sur ce point».
Source : Aurélie Renne – Espace infirmier.com :
http://www.espaceinfirmier.com/actualites/detail/27431/
Et Finalement
Le 11 septembre 2010, la réforme du travail a fait partie des
sujets d’actualité à l’Assemblée nationale. Mais pas comme prévu.
En effet, des amendements relatifs à la réforme de la médecine du
travail ont été adopté mais dans le cadre du projet de loi sur
les retraites.
Eric Woerth, le ministre du travail, avait déjà abordé le sujet
en mai 2010, annoncant «un lien entre le texte sur la médecine du
travail et celui sur les retraites». De leur côté, les syndicats
parlent d’un «démantèlement en catimini». Les syndicats et le
Medef ne sont d’ailleurs pas d’accord avec les amendements
proposés :
- Le recours à la médecine de ville : un amendement préconise à
quelques secteurs d’activité (artistes et intermittents,
mannequins, employés de particuliers, représentants…) de recourir
à des médecins de ville dans le but d’améliorer la protection de
certains salariés.
- Le recours aux internes et aux infirmières : les internes en
médecine pourraient ainsi remplacer les médecins du travail lors
de congés. En ce qui concerne le corps infirmier, une spécialité
«Santé du travail» serait créée.
- Les syndicats : désormais seulement deux collèges de syndicats
existeraient : les syndicats de salariés et les syndicats
patronaux. Les syndicats des employeurs seraient donc
supprimés.
- Les directeurs des services de santé au travail se verront
attribuer un pourvoir supplémentaire, celui de «garants de
l'indépendance du médecin du travail».
La réforme sur la santé au travail sera donc minimisée et intégrée au projet de loi sur les retraites, ce qui n’est pas du goût des partenaires sociaux qui déplorent le manque d’importance accordé au sujet. Une colère qui a été exprimée le 15 septembre 2010 lors d’une conférence de presse du Syndicat Nationale des Professionnel de Santé au Travail (SNPST).
Source :
- Ministère du travail, de la solidarité et de la fonction
publique
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/documentation-publications,49/rapports,51/travail,900/rapports-sur-la-sante-au-travail,1803/la-sante-au-travail-vision,11814.html
http://www.espaceinfirmier.com/actualites/detail/27431/
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/espaces,770/travail,771/dossiers,156/sante-et-securite-au-travail,301/les-services-de-sante-au-travail,1657/la-reforme-des-services-de-sante,1804/mai-2010-les-objectifs-de-la,11818.html
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/espaces,770/travail,771/dossiers,156/sante-et-securite-au-travail,301/les-services-de-sante-au-travail,1657/la-reforme-des-services-de-sante,1804/mai-2010-les-objectifs-de-la,11818.html
http://eco.rue89.com/2010/09/11/medecine-du-travail-la-reforme-low-cost-deric-woerth-165889
http://lci.tf1.fr/economie/social/2010-09/derriere-la-reforme-des-retraites-celle-de-la-medecine-du-travail-6064884.html
http://www.syndicat-infirmier.com/Sante-au-travail-Demantelement-en.html
http://www.laprovence.com/article/sante/sale-temps-sur-la-medecine-du-travail