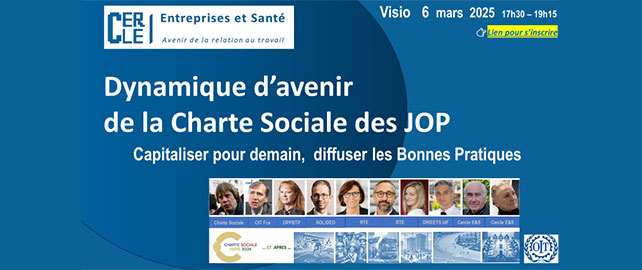Les CRAM deviennent les
CARSAT
Le 1er juillet 2010, 14 des 16 Caisses régionales d'assurance
maladie (CRAM) changent d'identité : elles deviennent des Caisses
d'assurance retraite et de la santé au travail.
La loi du 21 juillet 2009 « Hôpital, patients, santé et
territoire (HSPT) » a transféré la mission des CRAM en matière de
politique sanitaire et médico-sociale aux Agences régionales de
santé (ARS). Avec cette loi, les CRAM sont devenues les
Carsat.
Ce changement d’identité ne modifie en rien les missions
d’accueil, de conseil et d’accompagnement des CRAM devenues
Carsat. Elles continuent à instruire les demandes et assurer le
paiement des retraites, à gérer le transfert des données
sociales, ainsi que la tarification et la prévention des risques
professionnels. Elles poursuivent également leurs missions à
destination des assurés en difficulté sociale liée à la maladie,
le handicap ou le vieillissement, grâce à l’action des services
sociaux.
2 caisses conservent le nom de CRAM et leurs statuts particuliers
: celle d’Île-de-France et celle d’Alsace Moselle. Cette dernière
évoluera en Carsat le 1er janvier 2012.
Les compétences des CRAM en matière de gestion hospitalière ont
été transférées aux ARS.
Les ARS sont des établissements publics de l’État à caractère administratif. Elles se substituent aux Agences régionales de l’hospitalisation (ARH) et à d’autres institutions, dont elles reprennent tout ou partie des attributions : les Directions régionales et départementales des Affaires sanitaires et sociales (Ddrass et Ddass), les Union régionales des caisses d’assurance maladie (Urcam) et certains secteurs d’activité de la Mutuelle sociale agricole (MSA), du Régime social des indépendant (RSI) et des CRAM. Depuis le 1er avril 2010, les ARS coordonnent au niveau régional les hôpitaux, la médecine de ville et le secteur médico-social.
Loi du 10 juillet 2010
: deux mesures importantes en matière de santé et de sécurité
dans la Fonction publique
L’accord du 20 novembre 2009 est le premier conclu dans la
fonction publique sur la santé et la sécurité au travail. Il
comprend quinze actions organisées autour des trois axes suivants
: les instances et acteurs opérationnels en matière de santé et
sécurité au travail ; les objectifs et outils de prévention des
risques professionnels ; les dispositifs d’accompagnement des
atteintes à la santé. Il s’applique à l’ensemble des personnels,
quel qu’en soit le statut, des trois versants de la fonction
publique (soit 5,2 millions d’agents titulaires et contractuels
de la fonction publique).
Il prévoit un renforcement du dialogue social en matière de santé
et de sécurité au travail, notamment par la création de CHSCT
compétents sur les questions touchant aux conditions de travail.
Les partenaires sociaux ont d’autre part convenu de
l’instauration d’un droit au suivi médical dans les trois
versants de la Fonction publique : Fonction publique d’État,
Fonction publique territoriale et Fonction publique hospitalière.
Convaincus que l’amélioration des conditions de travail dans la fonction publique constitue un enjeu essentiel de la rénovation de la politique des ressources humaines et des relations sociales, le gouvernement et sept organisations syndicales ont ratifié cet accord du 20 novembre 2009. La loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la Fonction publique achève de transposer les mesures de 2009 au plan légal.
De portée très large, il comporte deux mesures phare en matière
de santé et de sécurité : la création de nouveaux CHSCT et la
mise en place d'un suivi post-professionnel.
- Création de nouveaux CHSCT (comités d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail) à la place des CHS dans la Fonction
publique d’État et la Fonction publique territoriale : les
comités d’hygiène et de sécurité voient ainsi leurs missions
élargies à la prise en compte des conditions de travail. Chaque
collectivité territoriale de plus de 50 agents pourra en
bénéficier.
- Le suivi médical post-professionnel existant dans le secteur
privé et dans les autres branches de la Fonction publique est
étendu aux agents publics territoriaux
Selon lui, le récent accord "santé et sécurité au travail" présente des avancées importantes pour la médecine de prévention pour plusieurs raisons : d’une part, parce que les dans les CHSCT, les médecins de prévention peuvent être conseillers dans les domaines de l’organisation du travail. Par ailleurs, la promotion et l’harmonisation de véritables services de santé au travail dans les trois fonctions publiques sont des points positifs. « Et puis, l’accord va permettre une meilleure connaissance des risques professionnels en renforçant les moyens et les instances de prévention ». Mais plusieurs dispositifs doivent être rapidement mis en place notamment des groupes de travail et de suivi, auxquels seront réellement associés les représentants du personnel. Enfin, un plan d’urgence concernant les risques psychosociaux est à envisager (comme dans le privé)
Concernant le rôle de la médecine de prévention notamment en période de crise, il préconise un recentrage des médecins sur la prévention de terrain et prône une pluridisciplinarité, rendu indispensable par la baisse de la démographie médicale. Néanmoins cette dernière doit s’articuler autour du médecin de prévention et ce, sous la responsabilité du chef de service. «La pluridisciplinarité restera professionnelle si elle se réalise autour des médecins, car les aspects cliniques de l’exercice médical deviendront prépondérants dans les domaines complexes de la souffrance au travail notamment. La formation et la spécialisation des médecins à la médecine du travail deviennent une urgence et devraient inciter à reprendre les équivalences mises en place dans ce domaine dans les années précédentes».
Source :
http://www.fonction-publique.gouv.fr/article1570.html?artsuite=1
Le Décret n° 2010-957 du
24 août 2010 relatif au contrôle des arrêts de
travail
Le décret du 24 août 2010 fixe les délais nécessaires à la mise
en œuvre de deux dispositions ayant pour objet de mieux contrôler
les arrêts de travail dus à une maladie ou un accident.
La première disposition concerne les salariés qui ont fait
l’objet, pendant leur arrêt de travail, du contrôle d’un médecin
mandaté par leur employeur (la « contre-visite »). Lorsque ce
médecin conclut à l’absence de justification de l’arrêt de
travail ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de
l’assuré, le médecin-conseil de l’assurance maladie peut demander
à la caisse de suspendre les indemnités journalières. Le salarié
dispose alors d’un délai de 10 jours francs à compter de la
notification de la décision de suspension des indemnités
journalières pour demander à la caisse de sécurité sociale dont
il relève un examen de sa situation par le médecin-conseil. Ce
dernier doit se prononcer dans un délai de 4 jours francs à
compter de la saisine du salarié (nouvel article D. 315-4 du code
de la Sécurité sociale).
La seconde disposition est prise pour l’application de l’article
L. 323-7 du code de la Sécurité sociale. Elle prévoit que,
lorsqu’une interruption de travail intervient dans un délai de 10
jours francs à compter d’une décision de suspension des
indemnités journalières, le service de ces indemnités est
subordonné à un avis du service du contrôle médical qui doit être
rendu dans un délai de 4 jours francs à compter de la date de
réception de l’avis d’arrêt de travail (nouvel article D. 323-4
du code de la Sécurité sociale).
Source :
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/INRS-FR/$FILE/fset.html
- Ministère du travail, de la solidarité et de la fonction
publique
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/actualite-presse,42/breves,409/decret-no-2010-957-du-24-aout-2010,12225.html
- Eurojuris.fr
http://www.eurojuris.fr/fre/collectivites/services-publics/fonction-publique-personnel/actualites/chsct-agents-fonction-publique.html
http://www.fonction-publique.gouv.fr/article1570.html?artsuite=1
- Direction générale de l'administration et de la fonction
publique :
http://www.fonction-publique.gouv.fr/article1599.html