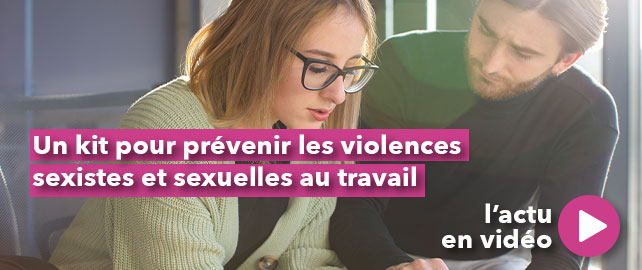Cela est valable aussi bien dans le quotidien des entreprises qu’au niveau contentieux, avec toutes la palette de nuances possibles en matière de risques psychosociaux, jusqu’aux cas de harcèlement.
A cet égard, l’employeur est tenu par deux obligations complémentaires : d’une part, l’obligation générale de protection de la santé, d’autre part l’obligation spécifique de prévenir et/ou faire cesser rapidement les agissements de harcèlement (moral et/ou sexuel) et autres agissements sexistes voire discriminatoires.
Compte tenu de l’évolution sociétale qui a permis de bannir certains comportements induisant de la souffrance au travail, jusque-là tolérés, l’entreprise se doit d’agir efficacement au plan organisationnel, humain et technique, pour prévenir durablement la survenance de situations susceptibles de porter atteintes aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l’avenir professionnel des travailleurs qu’elle emploie, sous peine d’engager sa responsabilité civile voire pénale.
Ce contexte a considérablement accru les exigences attendues auprès des personnes en charge de fonctions de direction et de management opérationnels ou de proximité, comme l’illustre notamment le développement massif des procédures d’alertes et d’enquêtes RH internes depuis quelques années, et qui ne cesse d’alimenter la jurisprudence concernant la question des bonnes pratiques (cf. précédentes chroniques : “Alertes internes en travail, santé et environnement : comment anticiper et réagir ?”, “Alertes harcèlement : les risques de l’inaction”, “Enquêtes RPS et harcèlement : sécuriser la démarche”, “Enquêtes internes en matière de harcèlement moral ou sexuel : panorama de jurisprudence en 10 décisions”).
Malgré les efforts de formation et de sensibilisation que peut (et doit) mettre en œuvre l’entreprise, le risque de dérive individuelle ou collective reste toujours possible et inhérent à l’humain.
C’est là qu’entre en jeu la question du pouvoir disciplinaire, bras armé de la prévention.
Plusieurs décisions récentes viennent rappeler que des comportements, propos ou attitudes de nature à altérer la santé psychique justifient une sanction disciplinaire.
Même si en pratique tout reste affaire d’appréciation au cas par cas, la faute grave est souvent retenue (licenciement sans préavis ni indemnités de rupture), à charge pour l’employeur de démontrer la matérialité des faits et leur gravité rendant impossible de maintien du contrat de travail.
Observons qu’au regard de la sévérité dont la jurisprudence fait preuve à l’égard de l’employeur dans l’appréciation du respect de son obligation de sécurité et de protection de la santé (notamment en termes de charge de la preuve), cette même jurisprudence lui permet en miroir de pouvoir réagir au plan disciplinaire avec sévérité, si nécessaire, en cas de manquements d’un salarié à son obligation de vigilance.
Cela paraît tout-à-fait cohérent et bienvenu car on ne peut à la fois exiger à l’employeur d’agir et dans le même temps lui interdire de mettre en œuvre ses prérogatives.
C’est le cas aussi bien en matière de non-respect des règles de sécurité (cf. précédente chronique “Quand des acteurs de la santé-sécurité sont mis en cause au titre de leurs fonctions (chronique de jurisprudence)” – cf. encore récemment Cass. Soc. 26 février 2025, n° 23-10506) que de comportement non acceptable à l’origine de troubles psychosociaux.
Rappelons que l’article L4122-1 du Code du travail énonce le principe selon lequel « conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. »
Cette exigence fondamentale ne doit pas être minimisée puisqu’elle a vocation justement à permettre de responsabiliser chaque salarié (« la prévention est l’affaire de tous »).
Voici une sélection de décisions récentes venant éclairer cette ligne jurisprudentielle :
Cas 1
Un responsable d'agence adopte à l'égard des collaboratrices placées sous son autorité un comportement lunatique, injustement menaçant, malsain et agressif ayant provoqué le départ de l'une d'elles.
Le mode de management maladroit et colérique est jugé de nature à constituer un manquement à l’obligation en matière de sécurité et de santé à l'égard de ses subordonnés en référence au L4122-1 CT.
La faute grave est qualifiée (faits rendant impossible la poursuite du contrat de travail).
A noter qu’il suffit que les faits soient de nature à constituer un manquement aux obligations contractuelles, peu important en l’espèce l’absence d’arrêts de travail des collaborateurs, d'alerte de la médecine du travail ou de l'inspection du travail, ni de courriers de plainte. Cass. Soc. 26 février 2025, n° 22-23703
|
Cas 2
En principe, un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas justifier un licenciement disciplinaire, sauf s’il est établi qu’il constitue un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail.
Etant incompatible avec ses responsabilités et de nature à porter atteinte à la santé psychique, la faute rend impossible son maintien au sein de l'entreprise (faute grave).
Peu importe ici que les faits ne soient pas qualifiés de harcèlement sexuel ou que l’intéressée ne se trouve pas sous sa subordination directe.
Cass. Soc. 26 mars 2025, n° 23-17544
|
Cas 3
La persistance d'un management inadapté (comportement excessivement autoritaire, dénué d'empathie, rigide et rugueux, dévalorisant, avec pression importante sur certains salariés dont le travail est jugé pas satisfaisant), en dépit d’un précédent avertissement du salarié, est jugée de nature à caractériser un comportement rendant impossible son maintien dans l'entreprise en référence à la violation de l’article L4122-1 CT.
Compte tenu des répercussions (situation de souffrance au travail dénoncée par plusieurs salariées, les syndicats et le médecin du travail), peu importe ici le fait que l'attitude de l'employeur ait pu être ambiguë voire flottante ainsi que les modalités d’enquête ou d’accompagnement (absence d’audit social, d’appel à des intervenants extérieurs, de médiation, de coaching et de contrôle dans l’exercice des fonctions managériales). La sanction était justifiée, « quelle qu'ait pu être l'attitude de l'employeur tenu à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ».
Cass. Soc. 6 mai 2025, n° 23-14492
|
Cas 4
Le fait pour un directeur commercial de tenir à l'égard de certains collaborateurs, sur le lieu de travail et à plusieurs reprises des propos à connotation sexuelle, sexiste, raciste et stigmatisants en raison de l'orientation sexuelle, de nature à porter atteinte à dignité et à la santé psychique d'autres salariés, rendait impossible son maintien au sein de l'entreprise (faute grave), en référence à la violation de l’article L4122-1 CT.
Peu importe ici la connotation « humoristique » alléguée ou le fait que l'intéressé soit apprécié d'un grand nombre de ses collègues.
|
Au-delà de ces situations symptomatiques mais déviantes, l’art managérial reste un exercice exigeant notamment du point de vue de l’exemplarité, d’autant plus qu’il peut aujourd’hui facilement être déstabilisé par des mises en cause ou accusations parfois injustifiées, et face auxquelles l’employeur doit veiller à faire preuve d’impartialité pour ménager tous les intérêts en présence.
Il n’en reste pas moins qu’au-delà du solutionnement des cas individuels, la protection du collectif de travail constitue un objectif légitime à prioriser en termes de plan d’actions.