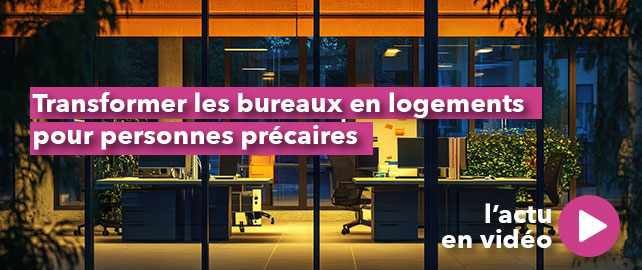Les lecteurs auront accès à une traduction inédite d’un très beau texte de la grande sociologue américaine Arlie Russell Hochschild. La manière dont le discute Christophe Dejours met en saillie les différences de préoccupations et de concepts entre sociologie et psychanalyse. En outre, plusieurs chercheurs et praticiens disent comment la prise en compte des émotions s’articule avec les corpus de leur discipline. Sociologues, anthropologue, historienne, cliniciens nous livrent la manière dont ils et elles s’appuient sur l’existence des émotions dans le travail pour fonder leurs repères, leur approche et leur contribution à l’analyse des mondes sociaux et particulièrement du travail. Ainsi, la visibilité des émotions ou son invisibilité peuvent constituer un indicateur très pertinent pour l’historienne, nous explique Arlette Farge.
Les émotions jouent comme révélateur des conditions de travail et
participent activement des spécificités professionnelles.
L’expression des émotions est sociale et genrée (Angelo Soares).
Elles peuvent être prises dans des rapports de domination et
instrumentalisées par autrui pour conduire à des comportements
particuliers, ainsi qu’en témoigne Patricia Paperman. Elles
supposent toujours une activité de travail spécifique pour les
assumer, les mettre à distance, les exprimer ou les taire selon
les contextes et les situations. Cela peut conduire, lorsque
l’organisation du travail est pathogène, à une désaffection,
risquée pour le sujet (Thomas Périlleux). On pense couramment à
la dimension individuelle de ce travail sur les émotions mais
l’ouvrage montre qu’il fait l’objet d’une appropriation
collective (Julien Bernard) et parfois institutionnalisée comme
dans les hôpitaux (Michel Castra), ce qui permet de penser qu’une
prise en charge organisationnelle des émotions est possible. À
quand sa généralisation ?