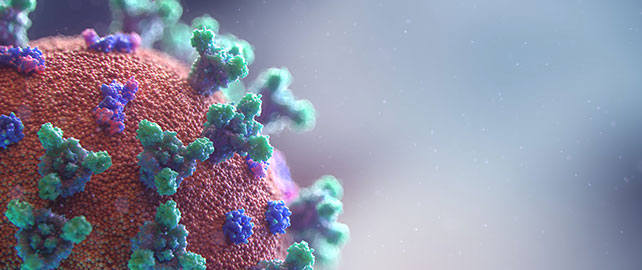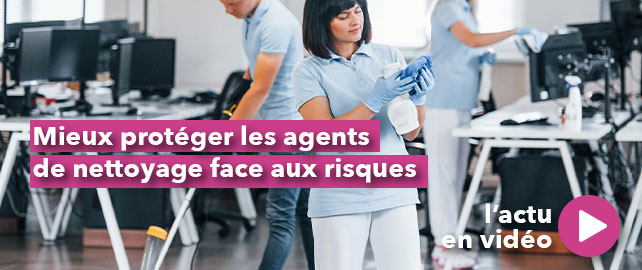« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité et protéger la santé physique et mentale des
travailleurs » - Article L.4121-1 du Code du travail. Cette
obligation est la base des principes généraux de prévention parmi
lesquels figure l’hygiène. Ainsi, l’employeur est tenu
d’entretenir les locaux et les équipements de travail, d’en
assurer la propreté et de mettre à disposition des salariés
certaines facilités (installations sanitaires, point d’eau…) :
L’employeur doit mettre «à la disposition des travailleurs les
moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment des
vestiaires, des lavabos, des cabinets d’aisances et, le cas
échéant, des douches » (article R. 4228-1 du Code du
travail).
Le Code du travail impose à l’employeur des dispositions très
générales relatives à l’entretien des lieux de travail. « Les
locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus
et nettoyés. Ils sont exempts de tout encombrement. Le médecin du
travail et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail, ou, à défaut, les délégués du personnel, émettent un
avis sur les mesures à prendre pour satisfaire à ces obligations
» (article R. 4224-18).
Les vestiaires collectifs doivent être isolés du lieu de travail,
mais placés à proximité du passage des salariés. Les armoires
permettent de suspendre deux vêtements de ville. Elles
comprennent un compartiment réservé aux vêtements de travail
susceptibles d’être souillés de matières dangereuses, salissantes
ou malodorantes (article R. 4228-6 du Code du travail). En cas de
personnel mixte (hommes et femmes), les vestiaires et les
installations sanitaires doivent être séparés. À la demande de
l’employeur, l’Inspection du travail peut accorder des
dérogations concernant l’aménagement des installations sanitaires
(vestiaires collectifs, lavabos ou douches), si les locaux ne
permettent pas de répondre aux obligations du Code du travail
(article R. 4228-16).
L’amiante
Depuis le 1er janvier 1997, la loi interdit l'importation, la
fabrication et la mise sur le marché de toutes les variétés de
fibres d'amiante incorporées ou non dans des matériaux ou autres
produits (décret no 96-1133 du 24 décembre 1996).
Arrêté du 17 mars 1998 : il fixe une liste de catégories
d'exceptions à l'interdiction et indique la norme à laquelle
doivent répondre les produits textiles à base d'amiante. Il
remplace le premier arrêté d'interdiction du 24 décembre
1996.
Décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des
travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussière
d'amiante : il fixe les conditions dans lesquelles la protection
des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de
poussières d'amiante doit être organisée dans l'entreprise.
Concernant le désamiantage, deux types d'entreprises sont à la
disposition des chefs d'établissements : celles chargées de
l'évaluation (réaliseront un travail d'expertise et de mesure de
la qualité de l'air) et celles chargées du désamiantage effectif.
En cas d'amiante friable (faux plafonds déflocage,
décalorifugeage…), l'entreprise intervenant doit posséder la
qualification Qualibat 1513.
À compter du 1er mars 2008, les entreprises qui effectueront des
travaux de retrait d'amiante non friable en milieu intérieur
devront être certifiées.
Arrêtés du 4 septembre 2007 (parus au Journal Officiel du 13
septembre 2007) concernant l'allocation amiante : ils modifient
et complètent, pour deux d'entre eux, la liste des établissements
de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles
d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité
des travailleurs de l'amiante ; pour le troisième, la liste des
établissements et des métiers de la construction et de la
réparation navale susceptibles d'ouvrir droit à cette même
allocation.
Le plomb
La prévention des risques liés au plomb s'intègre dans le
dispositif plus général de prévention du risque chimique qui
concerne toutes les activités exposant à des agents chimiques et,
pour certaines dispositions, aux CMR (cancérogènes, mutagènes et
reprotoxiques) pouvant présenter un risque pour la santé et la
sécurité des salariés.
Les articles R4412-156 à R4412-160 du Code du travail fixent des
dispositions spécifiques au plomb et prévoit une valeur limite
pour le plomb métallique et ses composés: interdiction de
l'emploi dans les travaux de peinture, mise à disposition de
vestiaires et de douches pour les salariés, stockage et
l'entretien des vêtements contaminés, respect de règles d'hygiène
et enfin modalités de la surveillance médicale spéciale à mettre
en œuvre.
La réglementation sur le plomb continue à évoluer. L'utilisation
du plomb est sévèrement limitée dans les produits électroniques
ainsi que dans les véhicules automobiles.
Les rayonnements ionisants
La réglementation prévoit un certain nombre de mesures risques
liés aux rayonnements ionisants en milieu professionnel :
responsabilité du chef d'établissement, respect des principes de
radioprotection, évaluation des risques par l'analyse des postes
de travail, évaluation prévisionnelle des doses susceptibles
d'être reçues par les travailleurs, définition de zones de
travail en cas de source de rayonnement dans l'entreprise, suivi
des personnes potentiellement exposées, contrôles techniques de
radioprotection, comprenant un contrôle régulier des sources et
appareils émetteurs de rayonnements ionisants, ainsi qu'un
contrôle des dispositifs de protection et d'alarme, et des
dispositifs de mesure , traçabilité complète des matières
radioactives…
Par ailleurs, tous les travailleurs intervenant en zone contrôlée
ou surveillée doivent recevoir une formation à la radioprotection
et une " personne compétente " doit être désignée pour assister
l'employeur dans l'organisation de la prévention.
Valeurs limites d'exposition et classement
La notion de «travailleur exposé», à la base du dispositif
réglementaire concernant les travailleurs, est définie à l'annexe
du Code du travail : «tout travailleur, salarié ou non, soumis
dans le cadre de son activité professionnelle à une exposition
aux rayonnements ionisants susceptible d'entraîner des doses
supérieures à l'un quelconque des niveaux de doses égaux aux
limites de dose fixées pour les personnes du public».
L'exposition «environnementale» de la population générale, du
fait des activités humaines impliquant la radioactivité, ne doit
pas dépasser la dose efficace de 1 milliSievert par an (mSv/an),
ou des doses équivalentes de 15 mSv/an au cristallin et de 50
mSv/an en valeur moyenne pour tout cm2 de peau exposé (doses
fixées pour les personnes du public aux termes des articles R.
1333-8 et R. 1333-9 du Code de la Santé publique)