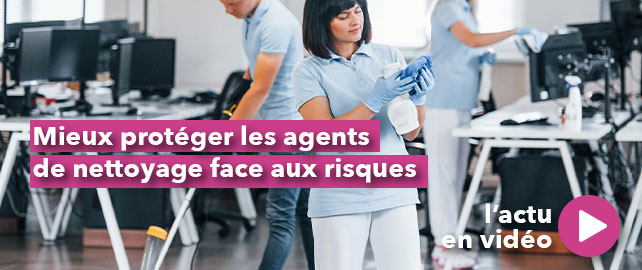Comme dans de nombreuses branches d’activité, l’intensification de la concurrence fait que les entreprises doivent lutter face à des impératifs de qualité (hygiène, traçabilité), de développement durable et de performance. On observe une professionnalisation des métiers du nettoyage ainsi qu’une évolution de la culture professionnelle. En effet, celle-ci vient s’axer sur la performance, le respect des règles économiques, sociales et environnementales, le respect de la santé des personnels et des exigences sanitaires qui s’accentuent.
Priorité au développement durable
Le thème du développement durable s’est imposé dans les préoccupations de tous les acteurs de la planète, de l’enfant de 14 ans suivant avec attention son cours de biologie au patron d’une usine de production de sacs recyclés en passant par les employés d’une PME du secteur de l’agroalimentaire. « Préserver la planète », voici le mot d’ordre. Quand on pense développement durable, on pense écologie. Bien que le développement durable passe aussi par des aspects économiques et sociaux, le versant environnemental occupe en effet beaucoup de place et concerne largement le secteur de la propreté. Adopter un mode de croissance respectueux de la planète et ses habitants suppose de combiner des principes de précaution (pour agir avant qu’il ne soit trop tard), de bonne gestion (pour arrêter les gaspillages), de responsabilisation (pour que chacun se sente concerné) et de solidarité avec les générations futures.
 La Fédération des Entreprises de Propreté et
Services Associés (FEP) joue un rôle crucial dans la
sensibilisation des entreprises à cette problématique. Elle a
voulu aller encore plus loin en aidant concrètement les
entreprises de nettoyage. Lors de la semaine du développement
durable de 2009, la FEP a lancé un programme de 51 actions pour
accompagner de nombreuses PME du secteur. Une formation de 8
jours leur est proposée. Ces 51 actions prioritaires s’organisent
autour de 5 grands thèmes :
La Fédération des Entreprises de Propreté et
Services Associés (FEP) joue un rôle crucial dans la
sensibilisation des entreprises à cette problématique. Elle a
voulu aller encore plus loin en aidant concrètement les
entreprises de nettoyage. Lors de la semaine du développement
durable de 2009, la FEP a lancé un programme de 51 actions pour
accompagner de nombreuses PME du secteur. Une formation de 8
jours leur est proposée. Ces 51 actions prioritaires s’organisent
autour de 5 grands thèmes :
- Renforcer l’engagement social : égalité des chances, lutte contre la discrimination, amélioration des conditions de travail, développement des compétences des salariés.
- Préserver l’environnement : diminuer les déchets à la source, rationaliser les consommables et diminuer les consommations, développer l’achat de produits éco-labellisés et leur bonne utilisation, augmenter l’efficacité énergétique et le caractère recyclable des matériels.
- Etablir et renforcer les partenariats avec les parties prenantes : clients, fournisseurs, sous-traitants, collectivités territoriales, associations ou ONG.
- Améliorer la gouvernance des entreprises : transparence, instauration d’indicateurs, analyse des risques.
- Assurer le développement économique durable : anticiper les risques et les coûts, anticiper les évolutions réglementaires.
Près de 200 entreprises sont engagées dans cette démarche
aujourd’hui. On note que le pilier social tient une place
importante. Cela se justifie par le fait que le capital
humain prend une grande place dans ce secteur. On le remarque
également au développement important de la formation depuis
quelques années.
La prévention des TMS
 La thématique de la santé au travail
concerne particulièrement le secteur de la propreté. Physiques et
intenses, les métiers du nettoyage peuvent être
considérés comme pénibles. Ils sont responsables d’un
grand nombre de troubles musculo-squelettiques qui touchent en
majorité les membres supérieurs. En effet, les extensions, les
mouvements répétitifs, les postures difficiles et les poids à
soulever causent des problèmes physiques. Les TMS sont la
première cause de maladie professionnelle dans ce
secteur. En 2011, plus de 1 300 cas ont été
déclarés, soit 96% des maladies professionnelles du secteur de la
propreté et 89% du coût global des maladies pour la branche
professionnelle.
La thématique de la santé au travail
concerne particulièrement le secteur de la propreté. Physiques et
intenses, les métiers du nettoyage peuvent être
considérés comme pénibles. Ils sont responsables d’un
grand nombre de troubles musculo-squelettiques qui touchent en
majorité les membres supérieurs. En effet, les extensions, les
mouvements répétitifs, les postures difficiles et les poids à
soulever causent des problèmes physiques. Les TMS sont la
première cause de maladie professionnelle dans ce
secteur. En 2011, plus de 1 300 cas ont été
déclarés, soit 96% des maladies professionnelles du secteur de la
propreté et 89% du coût global des maladies pour la branche
professionnelle.
Lorsque des problèmes surviennent, les employeurs sont tenus de prendre les mesures qui s’imposent pour protéger les salariés. Il est cependant préférable de pouvoir agir en amont et identifier les risques avant l’apparition des premiers problèmes et symptômes tels que des picotements, des engourdissements, des douleurs ou encore des spasmes musculaires, ceux-ci pouvant se déclarer soudainement ou plus progressivement. Une invalidité permanente peut même survenir si les mesures nécessaires ne sont pas prises. En cela, le personnel a un rôle important à jouer en signalant par exemple le plus rapidement possible la survenance de symptômes. Cela permet de bénéficier d’un traitement médical plus efficace pour soigner de façon durable les affections et diminuer l’arrêt de travail.
Pour lutter contre les TMS, un programme de prévention a été lancé en 2010 par la Fédération des entreprises de propreté et le Fonds d’Action pour la Réinsertion et l’Emploi. Celui-ci s’appuie sur un comité de parties prenantes constitué du Ministère du travail, de la CNAM TS, de l’Arseg, de l’ANACT et de la médecine du travail. Il s’agit d’un accompagnement constitué de la formation de tous les acteurs de l’entreprise de nettoyage (dirigeant, préventeur, personnel) ainsi que de la sensibilisation des donneurs d’ordres et des concepteurs de bâtiment. Ce dernier point est en effet important dans la mesure où les salariés des entreprises de propreté doivent intervenir dans des établissements variés qui ne considèrent souvent pas assez l’accessibilité des zones à nettoyer, les horaires décalés, le choix des revêtements, le traitement des agents, etc. A cette occasion, des guides ont été édités spécialement pour les donneurs d’ordres. Ils sont disponibles sur le site de la FEP. Le programme intègre également une aide aux entreprises qui veulent développer un plan d’action pour cette lutte contre les TMS.
Lors de l’Assemblée Générale de la FEP qui s’est tenue à
Marseille au mois de juin 2013, le président de la Commission
paritaire nationale santé et sécurité au travail (CPNSS) a
annoncé la mise en place d’un plan global santé et
sécurité au travail déployé sur trois ans.
 Le Bionettoyage
Le Bionettoyage
Le bionettoyage consiste à limiter le développement des micro-organismes sur les surfaces et empêcher la contamination des personnes lors d’une opération de nettoyage. En effet, de nombreux micro-organismes tels que les bactéries, les champignons ou encore les virus, peuvent se propager à cette occasion. Un nettoyage en trois temps est donc primordial. Dans un premier temps, le nettoyage est effectué avant de procéder à l’évacuation des salissures et des produits utilisés. Ensuite, vient l’étape de rinçage. Et enfin, une désinfection est effectuée par des personnels spécialement formés et même parfois sous le contrôle d’un biohygiéniste. Cette personne intervient dans les secteurs d’activité dans lesquels les personnes ou les produits sont plus ou moins sensibles à la présence des micro-organismes : laboratoires, secteur médical, paramédical et hospitalier, industries agroalimentaires, restauration collective, blanchisserie, etc.
Dans ce domaine particulier, on distingue 4 zones de risques.
- Zone 1 – Risque faible : hall, établissement médico-social, crèche, halte-garderie, bureau, service administratif ou économique, service technique, local ménage...
- Zone 2 – Risque moyen : maternité, établissement de santé, SSR, SLD, psychiatrie, cure médicale…
- Zone 3 – Haut risque : pédiatrie, structure d’accueil des urgences, laboratoire, radiologie, cuisine, espace sanitaire…
- Zone 4 – Très haut risque : bloc opératoire, néonatologie, service des brûlés, des greffés, des immunodéprimés, chimiothérapie, oncologie…
Ces zones sont délimitées géographiquement et des procédures de nettoyage différentes en découlent. C’est notamment pour cela que le bionettoyage peut s’effectuer en une ou plusieurs étapes, suivant les produits à utiliser. Petit guide pratique pour s’y retrouver dans les abréviations :
- d : détergeant
- dT : détartrant
- D : désinfectant
- dD : détergeant-désinfectant
L’assurance de la qualité et la traçabilité des procédures sont un véritable enjeu. Des contrôles bactériologiques sont parfois nécessaires, la plupart du temps dans un but pédagogique. La qualité d’un bon nettoyage repose sur 4 facteurs interdépendants regroupés au sein de ce que l’on appelle le Cercle de Sinner :
- Action chimique : action d’un produit détergeant, alcalin ou acide. Le respect d’un certain niveau de dilution du produit influe sur le résultat.
- Action mécanique : action apportée par le matériel (frottement ou pression) à réguler selon le support.
- Température de l’eau : le niveau de température influence la détergence du produit, ses différents résultats.
- Temps d’action (ou temps de contact) : il agit sur le pouvoir nettoyant d’un produit ou d’une machine.
Si l’un des facteurs est moins présent, il faut le compenser par un ou plusieurs autres.