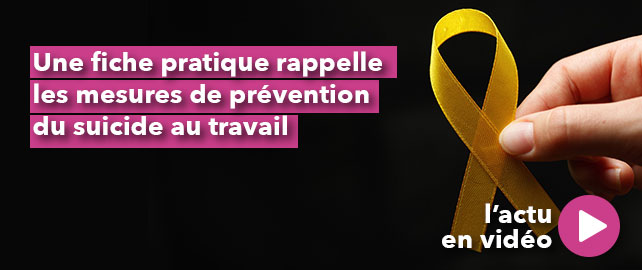Comment est venue cette idée d’Etats généraux sur la
promotion de la santé psychique et du bien-être au travail
?
Cette tribune est née progressivement. J’ai déjà collaboré avec
Jean-Christophe Sciberras, Patrick Legeron et Jean-François Naton
dans le cadre de l’étude de la Fondation Pierre Deniker sur la
santé mentale des actifs en 2018. Nous avons décidé, suite à
notre débat au Cnam en décembre dernier sur « travail et santé
mentale dans le contexte de la crise COVID-19 » d’écrire cette
tribune pour alerter de l’urgence qu’il y a à prendre plus au
sérieux la problématique des RPS et la santé psychique de manière
générale. Il faudrait s’attaquer aux problèmes à la source, aux
causes organisationnelles pour être plus efficace et ne plus se
contenter d’attendre que les problèmes surviennent avant
d’agir.
Que proposez-vous pour améliorer les stratégies de
prévention primaire ?
Intervention terrain, formation des acteurs et élaboration d’un
index. Ce sont les trois gros projets.
Parlez-nous un peu plus de cet index ?
Comme il existe un index égalité femme-homme, il faut créer un
index de santé psychique et bien-être au travail qui permettra
aux entreprises de se positionner sur leur niveau de RPS et ainsi
d’évaluer leurs marges de progrès à accomplir.
Les Etats généraux que nous demandons permettront de réunir des
experts sur le sujet des RPS pour établir ensemble des
recommandations sur comment mieux faire face à ce phénomène.
L’index sera à construire avec et pour les entreprises. Il s’agit
d’une approche scientifique avec une démarche participative
permettant de concevoir un « GPS de santé psychique et bien-être
au travail », dont le rôle serait d’orienter les entreprises vers
les pistes d’amélioration des efforts et des moyens de prévention
des RPS.
Qu’en est-il des aspects de votre projet d’intervention
sur les RPS ?
Le projet d’intervention sur les RPS consiste à orienter les
entreprises vers les facteurs psychosociaux à privilégier, selon
sa taille et son activité, pour baisser le niveau de stress au
travail. Basé sur les preuves scientifiques et d’un diagnostic
terrain, ce projet doit être piloté par un comité
pluridisciplinaire ad-hoc pour permettre un choix et une conduite
des actions les mieux adaptées au contexte de l’entreprise. Nous
aurons donc un rôle de conseil notamment sur les indicateurs de
santé et de sinistralité qu’il serait pertinent de recueillir et
de monitorer dans le temps afin d’évaluer les fruits des actions
implémentées et pouvoir identifier les leviers d’action pour
lutter efficacement contre les RPS et indirectement, sur les TMS
d’origine non-traumatique.
Et l’aspect formation ?
Nous avons construit ensemble – et avec d’autres experts – un
MOOC sur les RPS qui sera dispensé gratuitement ce printemps sur
la plateforme FUN. Il sera complété en 2022 par deux projets de
formations des managers en entreprises qui souhaiteraient
acquérir une expertise en gestion et prévention des RPS.
Vous supervisez depuis 2015 le programme de recherche de
la chaire partenariale « Entreprises & Santé ». Pouvez-vous nous
en dire plus ?
Ce partenarial entre le Cnam et le groupe Malakoff-Humanis,
repose sur un programme pédagogique, de recherche et prospective
d’intérêt commun dans le champ de la santé au travail. Il a
permis la création d’une réelle synergie et le développement
d’outils innovants à destination des entreprises, tels que
l’évaluation du degré d’implication en prévention ou le
retour-sur-investissement et l’efficacité de programmes de
e-coaching en santé, ou encore l’identification des déterminants
de l’absentéisme au travail qui sont l’objet des travaux d’une
thèse que j’ai co-encadrée avec mes collaborateurs. A ce sujet,
le but était de concevoir des outils opérationnels à destination
des managers leur permettant d’améliorer la prévention et la
gestion des arrêts maladie.
La chaire « Entreprise & Santé » nous a offert un terrain
d’échange fructueux qui a fait émerger des solutions innovantes à
destination des entreprises. C’est une belle initiative pour
soutenir la recherche et l’enseignement et œuvrer au
décloisonnement entre le monde académique et le monde
socio-économique. Personnellement, j’ai fait des rencontres
enrichissantes et inspirantes qui m’ont permis de m’approprier
des terrains d’étude et de concevoir des programmes innovants
pour répondre ensemble à des vrais besoins terrain.
« Il y a urgence à prendre plus au sérieux la problématique des RPS et la santé mentale de manière générale »
Mounia N. Hocine a co-signé un appel à des Etats généraux sur la promotion de la santé et du bien-être au travail avec Patrick Legeron, psychiatre, fondateur du cabinet Stimulus, Jean-François Naton, vice-président du Conseil économique, social et environnemental et Jean-Christophe Sciberras, DRH, ancien président de l’Association nationale des directeurs de ressources humaines (ANDRH). Nous avons voulu en savoir plus.

Mounia N. HOCINE
Enseignante-Chercheuse en Prévention des Risques Sanitaires
Conservatoire National Des Arts Et Métiers (Cnam)
- #RPS
- 05/05/2021