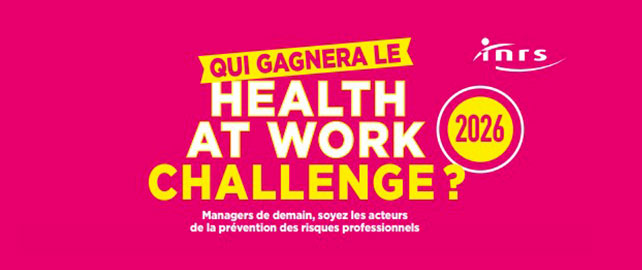Que contient cette formation ?
Notre diplôme s’articule autour d’un référentiel de cinq
compétences :
- L’analyse des risques
- La maîtrise de ces risques
- La réponse aux situations d’urgence et de crise
- L’animation des démarches
- L’accompagnement de la direction dans son management QHSSE, à partir de la deuxième année
Il s’agit d’une formation accessible avec un niveau bac, qui
accorde un niveau licence, donc BAC+3, sur tout le domaine HSE.
Donc en santé travail, sécurité des installations, maîtrise de
l’impact environnemental, protection des populations… Sur ses
fondamentaux, ce BUT reste assez similaire à son prédécesseur,
mais nous avons ajouté une dimension « management » en plus de la
formation technique.
L’enseignement repose sur trois piliers majeurs : un aspect
scientifique pour l’analyse et la compréhension des risques et de
leurs causes, un volet juridique et règlementaire, et enfin tout
ce qui tourne autour des relations humaines.
À noter que nous sommes un diplôme national, construit avec 18
départements HSE, mais avec un tiers d’adaptation locale dans
l’enseignement. Cela permet d’orienter le diplôme en fonction du
territoire où il est obtenu, mais aussi en fonction des experts
de l’université concernée pour mettre à profit leurs
connaissances.
À qui s’adresse-t-elle ?
Le secteur HSE, ce sont tout d’abord des métiers tournés vers les
relations humaines, l’empathie et la communication. Il est
important d’en avoir conscience. Ce sont aussi des métiers qui
plairont à ceux qui aiment comprendre des situations, mener des
enquêtes, chercher des solutions pour améliorer les choses. Pour
ceux qui souhaiteraient postuler, nous sommes ouverts au bac
général, mais nous exigeons généralement au minimum une
spécialité scientifique, qui nous semble nécessaire pour cette
formation. Nous ouvrons également nos portes aux bacs
technologiques comprenant un enseignement scientifique (STI2D,
STL, et dans une moindre mesure ST2S).
Quelles sont les particularités de ce BUT ?
Nous sommes une formation universitaire et nous en sommes fiers.
Nous avons une grande vigilance sur le contenu de nos
enseignements, et les entreprises sont agréablement surprises
quand elles découvrent tout ce que nous traitons avec nos
étudiants.
Mais la spécificité du BUT HSE repose essentiellement sur son
organisation. Nous avons travaillé avec un laboratoire de
l’université de Liège, spécialisé dans l’implémentation de
l’approche par compétences dans le monde universitaire, pour
concevoir son fonctionnement. L’idée, c’est qu’à la fin de chaque
année, l’étudiant peut valoriser un niveau de
professionnalisation.
Pour cela, nous orientons la première année sur les types de
situations locales, et durant la deuxième année nous commençons à
réfléchir à l’entreprise. En fin de deuxième année, les étudiants
sont en théorie capables de gérer tous les aspects HSE d’une
petite PME. Et enfin, en troisième année, nous montons d’un cran
avec le côté organisationnel, les risques spécifiques, les
rapports avec la direction, etc. Ce fonctionnement par paliers
permet chaque année de mettre en application, dans des mises en
situation professionnelles, le contenu théorique abordé. Lorsque
les étudiants arrivent dans le monde du travail, ils ont donc
déjà un bagage solide. L’avantage par rapport à avant, c’est
qu’avec un stage, l’expérience dépendait beaucoup de l’entreprise
hôte. Désormais, la formation exige clairement que les étudiants
soient passés par toutes les situations typiques que le
préventeur peut rencontrer.
Que deviennent vos élèves à l’issue de cette formation
?
Conformément à la consigne donnée par le Ministère, nous
poursuivons l’objectif d’avoir une moitié d’élève qui décide de
poursuivre ses études pour acquérir une spécialisation en master,
et l’autre moitié qui se dirige vers l’insertion
professionnelle.
Pour celles et ceux qui poursuivent jusqu’au bac+5, les écoles
d’ingénieur en gestion des risques leur sont ouvertes, mais aussi
des masters qui leur permettront de se spécialiser par exemple en
ergonomie, génie de l’environnement ou sécurité globale.
Beaucoup d’étudiants deviennent des préventeurs généralistes.
Cela les amène à gérer les aspects santé travail, la sécurité des
installations, etc. Avec souvent d’autres missions
complémentaires confiées par l’entreprise, car le domaine HSE est
à la croisée de nombreuses disciplines.
Mais il y a aussi des postes plus spécialisés, avec des étudiants
qui vont aller sur des chantiers par exemple, avec une «
casquette » SST ou Environnement. Nous sommes également approchés
par les bureaux de contrôle, qui cherchent à remplacer les
nombreux coordinateurs sécurité protection de la santé qui
partent à la retraite, et considèrent que les profils HSE sont
très adaptés pour ce métier-là.
Certains se préparent également aux concours d’officiers
sapeurs-pompiers professionnels, qui historiquement sont très
liés à notre formation.




![Colloque Work in Progrès[s] : construire le travail de demain](/medias/news/2025-11-12/69149dea31d34_colloque-work-in-progres.jpg)