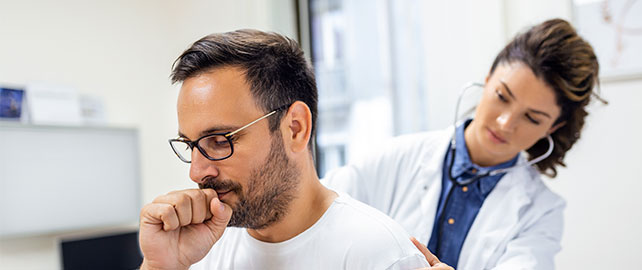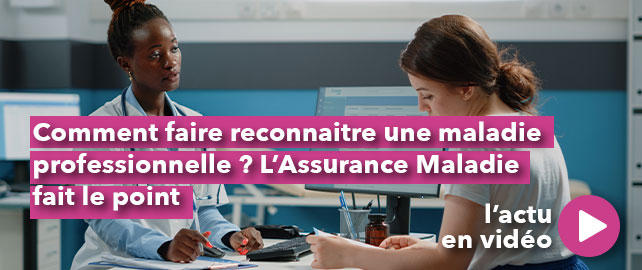Si le principe est celui de la responsabilité de chaque chef d'entreprise dans l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu'il emploie (CT, L4511-6), cela n’exclut pas la possibilité d’une mise en cause du donneur d’ordres au plan pénal et/ou civil en cas d’accident du travail survenant à des travailleurs extérieurs.
*Précisons que ce type de situation est à bien distinguer du cas de mise à disposition (à but non lucratif) de personnel, dans lequel l’entreprise d’accueil est au contraire réputée responsable des conditions d’exécution du travail en matière de santé-sécurité notamment selon le même modèle que l’intérim (CT, L8241-2), et a qualité de « substitué dans la direction » à l’employeur (CSS, L452-1 et L412-6).
Concernant la responsabilité civile, bien qu’ici l’entreprise cliente soit considérée comme un tiers à la relation de travail (CSS, L454-1), sa responsabilité peut être engagée par la victime sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile.
En général, le salarié ou ses ayants droits préfèreront opter pour une action en reconnaissance de faute inexcusable (RFIE) dirigée contre l’employeur, compte tenu des avantages que ce régime peut offrir (charge de la preuve, solvabilité de la CPAM assurée, etc.).
Toutefois, il existe des situations d’accident dans lesquelles par exemple, aucun manquement à l’obligation de sécurité et de protection de la santé ne peut être reproché à l’employeur.
La jurisprudence évolue avec plusieurs décisions récentes venant ouvrir le champ à de telles actions.
Deux décisions (publiées au bulletin de la Cour de cassation) retiennent en particulier l’attention ici, en raison de leur portée :
- Concernant le contentieux du travail, la Chambre sociale de la Cour de cassation énonce que :
« 11. Les dispositions des articles R. 4511-4, R. 4511-5 et R. 4511-6 du code du travail qui mettent à la charge de l'entreprise utilisatrice, une obligation générale de coordination des mesures de prévention qu'elle prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement et précisent que chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel, n'interdisent pas au salarié de l'entreprise extérieure de rechercher la responsabilité de l'entreprise utilisatrice, s'il démontre que celle-ci a manqué aux obligations mises à sa charge par le code du travail et que ce manquement lui a causé un dommage.
12. La cour d'appel, qui a relevé que l'Office public ne justifiait, pas plus que l'entreprise extérieure, de l'organisation d'une inspection commune et de l'établissement du plan de prévention, obligations auxquelles ces entités étaient toutes deux tenues, a légalement justifié sa décision. » (Cass. Soc. 15 mars 2023, n° 20-23694).
Dit autrement, l’entreprise cliente ne peut se retrancher derrière le fait qu’elle n’est pas l’employeur du salarié pour s’exonérer s’il est établi qu’elle a pu manquer à des obligations réglementaires en matière de coordination générale de la prévention des risques.
Le raisonnement est somme toute assez classique ; l’originalité porte ici sur la condamnation solidaire avec l’employeur, devant les prud’hommes, à verser des dommages et intérêts au titre de préjudices résultant de l'exposition au risque d'amiante et de l'absence de formation.
Le cas de l’amiante (toujours !) avait d’ailleurs déjà conduit à reconnaître la responsabilité pour faute extracontractuelle d’une entreprise cliente, au titre du préjudice d’anxiété découlant d’un manquement aux obligations mises à sa charge en matière de coordination générale de la prévention (Cass. Soc. 8 février 2023, n° 20-23312 ; cf. précédente chronique).
- Concernant le contentieux du préjudice corporel, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation vient d’ajouter une pierre importante à l’édifice, en jugeant à propos d’une intoxication accidentelle de 2 vigiles effectuant une ronde dans l’établissement de l’entreprise cliente (Cass. Civ. 2ème 5 septembre 2024, n° 21-23442 et 21-24765) :
- D’une part, que la responsabilité civile de celle-ci peut être engagée conformément au droit commun sur le fondement de la responsabilité du fait des choses (à moins de démontrer qu’elle en aurait transféré la garde):
« Selon l'article 1384, devenu 1242, alinéa 1, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. (…) la société, propriétaire et exploitante de l'usine où l'inhalation du produit toxique a eu lieu, est gardienne, au sens juridique du terme, des substances qui peuvent émaner en son sein et qu'elle est responsable des dommages subis par les victimes.
13. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a caractérisé que le nuage toxique, émanant de la société et dont elle avait la garde, était à l'origine des symptômes présentés par les victimes, a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'elle avait engagé sa responsabilité. »
Il s’agit ici d’un cas de responsabilité dite objective, non fondée sur la faute (CCiv, art. 1240) ni sur la négligence ou l’imprudence (CCiv, art. 1241), ce qui constitue une évolution notable appelant à une vigilance renforcée pour les entreprises faisant intervenir des prestataires de services.
D’autre part, concernant les relations d’affaires entre les deux sociétés, elle juge inopérante la clause du contrat de prestation de services par laquelle l’employeur des salariés s’engageait à garantir financièrement et relever indemne son client en cas de condamnation :
« Vu les articles L. 451-1, L. 452-5 et L. 482-4 du code de la sécurité sociale:
17. En application des deux premiers de ces textes, sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l'entreprise, qui a indemnisé la victime d'un accident du travail pour tout ou partie de son dommage, n'a pas de recours contre l'employeur de celle-ci.
18. Selon le troisième, est nulle de plein droit toute convention contraire au livre IV du même code, relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles.
19. Il en résulte que l'employeur ne peut renoncer à l'immunité dont il bénéficie en application de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale.
20. Pour condamner l'employeur à relever et garantir la société des condamnations mises à sa charge au profit des victimes, l'arrêt retient qu'il résulte de la convention du 12 novembre 2008, conclue entre la société et l'employeur, que le prestataire est totalement responsable des agissements de son personnel dans le cadre des missions qui lui sont confiées et garantit le client de toute action, notamment de ses propres salariés contre le client (…).
22. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la convention du 12 novembre 2008 était nulle de plein droit comme contraire aux articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale et que l'employeur n'avait pas commis une faute intentionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
L’employeur des salariés victimes d’AT se voit ainsi dégagé de son obligation contractuelle de garantir son client au titre de condamnations mises à sa charge et dont celui-ci est déclaré seul responsable.
Cette décision vient prendre le contrepied d’un précédent arrêt, resté jusqu’à lors isolé, qui avait validé la clause d’un contrat de sous-traitance par laquelle le client dégageait sa responsabilité, dans un contexte de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur avec partage de responsabilité reconnue puisque l'accident du travail trouvait son origine dans le dysfonctionnement d'un équipement de travail relevant du contrôle et de la responsabilité du client (Cass. Civ. 2ème 12 juillet 2012, n° 11-19564) :
« Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour dire que la société A. sera tenue de relever et garantir la société H. à concurrence de 50 % de toutes les sommes restées à sa charge, (…) il convient de relever que; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de prestation de service (…) prévoit en son article 6-1 qu'"A. dégage totalement sa responsabilité des biens comme des activités du fournisseur" et en son article 6-2 que "le fournisseur déclare renoncer à tout recours contre A. pour les dommages que pourraient subir dans les lieux objets des présentes et d'une manière générale dans l'enceinte de l'établissement, ses agents, ses biens et marchandises", la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces clauses, a violé le texte susvisé. »
Cette solution, neutre pour les victimes mais favorable aux clients, paraît donc désormais obsolète.
Les pratiques rédactionnelles des contrats commerciaux vont-elles évoluer pour autant ? Rien n’est moins sûr …
En tout état de cause, on peut y voir en creux une volonté judiciaire de sévérité pour responsabiliser les donneurs d’ordres en matière de prévention des risques liés aux interventions d’entreprises extérieures (= « votre risque, c’est aussi le nôtre »), sans pouvoir compter sur un rapport de force économique souvent déséquilibré.
Cela d’autant que l’enjeu est souvent principalement d’ordre assurantiel en la matière …
*Rappelons que dans un autre registre similaire, côté employeur, il a été jugé récemment en matière de faute inexcusable que « l'employeur ne peut s'affranchir de son obligation de sécurité par la conclusion d'un contrat prévoyant qu'un tiers assurera cette sécurité » (Cass. Civ. 2ème, 16 novembre 2023, n° 21-20740 ; cf. précédente chronique : https://www.preventica.com/actu-chronique-obligation-securite-protection-sante.php).
Ce message s’inscrit dans l’air du temps avec le sujet de la durabilité et du renforcement des obligations de vigilance pour les donneurs d’ordres auprès de toute leur chaîne de valeur (cf. précédente chronique : https://www.preventica.com/actu-chronique-donneurs-d-ordres-entreprises-exterieures-vigilance-sociale-environnementale.php )
- D’une part, que la responsabilité civile de celle-ci peut être engagée conformément au droit commun sur le fondement de la responsabilité du fait des choses (à moins de démontrer qu’elle en aurait transféré la garde):