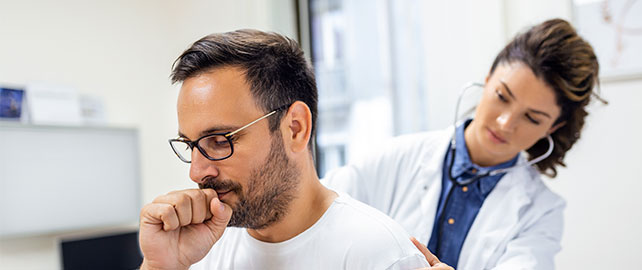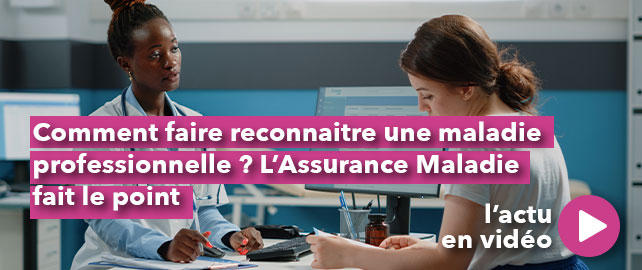Dans l’ANI du 15 mai 2023, les partenaires sociaux au niveau national ont souhaité réaffirmer ces principes au travers d’une amélioration du cadre existant.
S’agissant du volet indemnisation, jugé insatisfaisant sans son fonctionnement, l’objectif posé a été de faire en sorte que les victimes bénéficient d’une réparation rapide, automatique et adéquate (afin éviter une judiciarisation des démarches).
Dans ce cadre, un point de débat particulier a porté sur l’objet de la prestation en espèces allouée par les organismes sociaux en cas d’AT-MP sous forme de rente (ou de capital).
Au terme d’une évolution sur plusieurs années, la jurisprudence s’est attachée à améliorer l’indemnisation en matière d’AT-MP, pour se rapprocher de celle des victimes de préjudices corporels en droit commun, sans toutefois aboutir à une réparation intégrale.
L’aboutissement de ces développements a conduit à un revirement de jurisprudence aux conséquences majeures : selon ce nouveau paradigme, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est réputée ne plus réparer le déficit fonctionnel permanent (dit « DFP »), en sorte que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation complémentaire du préjudice causé par ses souffrances physiques et morales (cf. Cass. Ass. Plénière 20 janvier 2023, n° 21-23947, 20-23673 – confirmé depuis).
D’un trait de plume, les enjeux financiers autour de la reconnaissance de faute inexcusable s’en sont trouvés considérablement impactés :
Positivement, pour les assurés sociaux en cas de faute inexcusable (tandis que paradoxalement, les victimes courantes d’AT-MP perdent de facto l’indemnisation du DFP, sauf à établir une faute inexcusable de leur employeur) ;
- Négativement, pour les employeurs et leurs compagnies d’assurance (rappelons par ailleurs que dans ce domaine, le risque d’insolvabilité est tout-à-fait virtuel pour le salarié, puisque c’est la caisse de Sécurité sociale qui lui avance le montant des dommages et intérêts alloués).
Bien évidemment, la possibilité d’assurance contre la faute inexcusable, autorisée par la loi (cf. L452-4 CSS), aura fortement contribué à cette logique indemnitaire. Il n’en reste pas moins que cet effet de bascule peut donner le sentiment que l’on a pu passer d’un extrême à l’autre, et ne s’avère pas satisfaisant au plan conceptuel…
En creux, il s’agissait aussi d’un message à l’attention du législateur pour provoquer une évolution.
Prenant acte de cette jurisprudence, un consensus s’est dégagé dans le cadre de l’ANI du 15 mai 2023 pour inviter expressément le législateur à prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir que la nature duale de la rente AT/MP ne soit pas remise en cause, à savoir un volet à la fois patrimonial et extrapatrimonial.
C’est chose faite, avec le vote tardif de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, publiée le 28 février 2025 (cf. LFSS n° 2025-199 du 28 février 2025).
Son article 90 (non examiné par le Conseil Constitutionnel) prévoit plusieurs évolutions, dont l’entrée en vigueur est différée au 1er juin 2026 au plus tard (selon date à fixer par décret) :
- Le principe acté de la dualité de l'indemnisation de l'incapacité permanente en cas d’AT-MP est posé, avec :
- Une part due au titre de l’incapacité permanente professionnelle (le taux de l'incapacité permanente professionnelle étant déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge et les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, à partir d'un barème indicatif d'incapacité professionnelle des accidents du travail et des maladies professionnelles déterminé par arrêté interministériel) ;
- Une part due au titre de l’incapacité permanente fonctionnelle (dont le taux est ici déterminé en fonction des atteintes persistant après la consolidation qui relèvent du DFP, à partir d'un barème indicatif déterminé par arrêté interministériel).
- Sur cette base, la prestation de Sécurité sociale sera constituée de cette double composante, à savoir schématiquement :
Une part professionnelle, correspondant à la perte de gains professionnels (« PGPF ») et à l'incidence professionnelle de l'incapacité (« IP ») ;
Une part fonctionnelle et extrapatrimoniale, correspondant au DFP de la victime (qui recouvre à la fois, post-consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence au quotidien).
Chaque composante sera calculée, revalorisée, et révisée selon des modalités propres et distinctes selon qu’il s’agit d’une indemnisation sous forme de capital (L434-1 CSS), ou de rente (L434-2 CSS).
Dans ce cadre, la référence à des barèmes réglementaires pour ces chiffrages permettra de bien refléter cette dimension duale de manière claire (contrairement à la situation antérieure au revirement de jurisprudence, pour laquelle cette dualité était présumée, mais sans que cette ventilation ne soit réellement objectivée).
Pour autant, les textes réglementaires d’application à venir vont s’avérer déterminants pour permettre à tous les acteurs de mesurer l’impact de cette réforme, sachant que le principe doit respecter le deal d’origine, à savoir celui d’une réparation automatique, mais forfaitaire des AT-MP.
L’enjeu sera ne pas peser trop lourdement sur les comptes de la branche AT-MP et la mutualisation ; mais si la barémisation de la part fonctionnelle est jugée trop faible, il faut s’attendre à un probable recours pour excès de pouvoirs contre les arbitrages ministériels …
- Ensuite, sur le volet de réparation complémentaire des préjudices non pris en charge au titre du Livre IV du Code de la Sécurité sociale, le régime d’indemnisation en cas de faute inexcusable de l’employeur se voit adapté en cohérence.
En particulier, il est prévu au nouvel article L452-2 CSS que la majoration de rente pour faute inexcusable portera sur la part professionnelle ainsi que la part fonctionnelle précitées, avec une double limite :
Le montant de la majoration de la part professionnelle sera fixé de telle sorte que la part professionnelle majorée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
Le montant de la majoration de la part fonctionnelle sera également plafonné, de sorte que la part fonctionnelle majorée ne puisse excéder le montant total correspondant au nombre de points d’incapacité fonctionnelle multiplié par la valeur du point fixée par le référentiel.
Sous certaines conditions (à définir), la victime pourra demander à convertir en capital le montant de sa majoration de part fonctionnelle, afin d’augmenter l’indemnisation perçue à court terme pour répondre à ses besoins immédiats d’adaptation de son environnement.
Afin d’intégrer dans la loi le principe posé par le Conseil constitutionnel dans sa grande décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, il est ajouté à l’article L452-3 CSS qu’indépendamment de sa majoration de rente, la victime sera fondée à demander à l’employeur devant la juridiction de Sécurité sociale au titre de la faute inexcusable, « la réparation de l’ensemble des préjudices ne faisant pas l’objet d’une réparation forfaitaire au titre du présent livre [IV], notamment du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées avant la date de consolidation, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Ce faisant, la loi distingue clairement les souffrances endurées, selon qu’elles sont évaluées avant consolidation (= réparation complémentaire) ou après consolidation (= inclusion désormais via la part fonctionnelle de la rente majorée).
A horizon du 1er juin 2026, l’incapacité permanente au titre d’un AT-MP sera donc mieux indemnisée sur le long terme par la Sécurité sociale. Au plan légal, tous les assurés victime d’un AT-MP seront ainsi globalement mieux lotis qu’avant le revirement de jurisprudence de 2023, de manière automatique.
Par contre, le DFP, ne sera plus réparable que de manière forfaitaire, au travers de la rente/ capital (éventuellement majorée en cas de faute inexcusable), ce qui devrait être tout de même moins avantageux qu’aujourd’hui concernant ce poste de préjudice. Le juge n’aura en tout état de cause plus compétence pour allouer ici des dommages et intérêts en complément.
A noter que les consolidations intervenues avant la date d’entrée en vigueur ci-dessus ne sont pas concernées ; néanmoins, les pratiques judiciaires vont devoir s’adapter et anticiper cette nouvelle donne, en demande comme en défense.
Ces mesures de rééquilibrage permettront-elles pour autant d’atteindre l’objectif de déjudiciarisation affiché ? Rien n’est moins sûr …