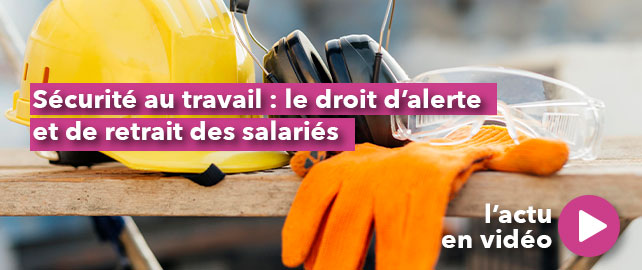Pour remédier à cette situation, une proposition de loi vient d’être présentée à l’Assemblée nationale le 16 septembre, en vue d’instituer un socle universel minimal de prévoyance complémentaire au bénéfice de tous les salariés du secteur privé, sur le même modèle que celui mis en place dans le cadre de la généralisation des complémentaires santé entre 2013 et 2016.
1. Les grands axes du projet de généralisation
Le séquençage proposé interviendrait en 3 temps :
- Une première phase ouverte à la négociation obligatoire dans les branches avant le 1er juillet 2026, pour équiper celles qui ne le sont pas. Entre autres, cette négociation sera l’occasion de définir les modalités selon lesquelles des contributions d’assurance peuvent être affectées au financement de l’objectif de solidarité, notamment en faveur d’actions de prévention ;
- Suivie d’une seconde phase d’un an (1er juillet 2026 - 1er juillet 2027), pendant lesquelles toutes les entreprises disposant de délégués syndicaux et non couvertes auront l’obligation de négocier la mise en place d’une couverture conforme ;
- In fine, à compter du 1er juillet 2028, tout employeur aurait l’obligation d’offrir une couverture collective à adhésion obligatoire de prévoyance complémentaire (sous réserve d’éventuels jeu de cas de dispenses d’affiliation à définir par voie réglementaire).
Le socle minimal de garanties obligatoires, inspiré de la garantie interprofessionnelle applicable aux cadres (cf. anciennement art. 7 de la CCN du 14 mars 1947, transposé dans l’ANI du 17 novembre 2017), porterait sur la couverture a minima des risques incapacité, invalidité et décès, selon un montant de la cotisation plancher de 1,5 % de la tranche 1 (= plafond de la Sécurité sociale).
L’employeur devrait participer a minima à hauteur de 50% de la cotisation d’assurance, comme en matière de complémentaire santé (cf. CSS, L911-7).
Libre bien entendu à chaque entreprise d’adapter ce dispositif dans un sens plus avantageux concernant les garanties et/ou le financement, par voie d’accord collectif ou le plus souvent en pratique, de décision unilatérale du chef d’entreprise (« DUE »).
Précisons en effet que selon les statistiques, on estime qu’environ :
- 7 actifs sur 10 sont concernés par des défauts ou insuffisances de couverture ;
- 2 sur 10 ne sont pas couverts,
- 1 sur 2 le serait insuffisamment.
Bien qu’assez sommaire, ce projet de réforme, s’il aboutit, constitue néanmoins une avancée sociale majeure.
2. La dualité indemnisation/ prévention : le rôle parfois sous-estimé de la protection sociale complémentaire et du dialogue social
Dans un contexte de forte attentes sociétales sur le thème de la « justice sociale », la généralisation des couvertures de prévoyance complémentaire paraît constituer, derrière son apparence « technique », un levier tout-à-fait significatif, permettant de renforcer concrètement la protection des travailleurs et de leurs revenus contre les aléas de l’existence (y compris dans le cadre professionnel), à un coût raisonnable grâce aux mécanismes de mutualisation assurantielle et de solidarité.
Surtout lorsque celle-ci est organisée au niveau du périmètre d’une branche professionnelle.
Ce point est essentiel dans un contexte où le coût du travail est très élevé en France, ce qui nécessite de ménager la trésorerie des entreprises.
Même si l’assurance a une vocation indemnitaire en première intention, la prévention des risques est en fait l’enjeu essentiel.
Les entreprises auront toujours intérêt à intégrer la dimension « prévoyance » dans leur démarche non pas pour se déresponsabiliser, mais ne serait-ce que parce qu’au plan financier, une sinistralité forte entraîne toujours mécaniquement un effet inflationniste sur le compte technique du régime et une hausse annuelle des cotisations d’assurance (à l’instar de la tarification AT-MP même si les mécanismes sont différents).
Au-delà des obligations de sécurité et de protection de la santé pour ce qui concerne strictement la sphère du risque professionnel, il est ainsi toujours pertinent pour l’entreprise d’aller au-delà et de déployer des actions en faveur de la prévention selon l’idée de la santé (approche « one health ») : sport, sommeil, alimentation, addictions, etc.
ROI social à la clé : meilleur engagement, réduction de l’absentéisme, attractivité de l’emploi, etc.
Il s’agit d’un levier important pour les employeurs, et disons-le incontournable en termes de politique responsabilité sociale (RSE), sachant qu’il est ici question de protéger les collaborateurs et leurs proches contre les risques les plus lourds, et que paradoxalement, ce sont souvent les populations de travailleurs les plus exposées en termes de pénibilité ou d’accidents qui sont les moins bien couvertes et/ou ayant les niveaux de revenu les plus faibles.
Précisons à ce sujet que dans le cadre des garanties conventionnelles de branche, une qu’une partie des cotisations peut être fléchée en faveur du financement notamment d’actions de prévention par le biais d’un organisme assureur recommandé (CSS, L912-1).
Le seuil dit de « haut degré de solidarité » est alors franchi à partir d’une enveloppe dédiée représentant 2% du montant des cotisations.
Ces actions de prévention concernent les risques professionnels, propres au champ professionnel ou interprofessionnel concerné, et visent à réduire les risques de santé futurs et à améliorer les conditions de vie au travail et la santé des salariés.
Elles peuvent également suivre d’autres objectifs de la politique de santé, relatifs notamment aux comportements en matière de consommation médicale, et peuvent ainsi venir relayer des actions prioritaires, notamment via des campagnes nationales d’information ou de formation.
Nous évoquions déjà ce sujet en 2014 (cf. précédente chronique) ; il reste pleinement d’actualité en 2025.
Si cette réforme vient à se concrétiser, elle constituera une évolution majeure, pour laquelle de nombreuses entreprises devront alors se mettre en conformité.
Observons toutefois qu’avec le recul, la généralisation des couvertures santé a été parfaitement digérée par les entreprises et fait aujourd’hui « partie du décor » ; il n’y a pas de raisons que cela ne soit pas le cas pour la prévoyance...