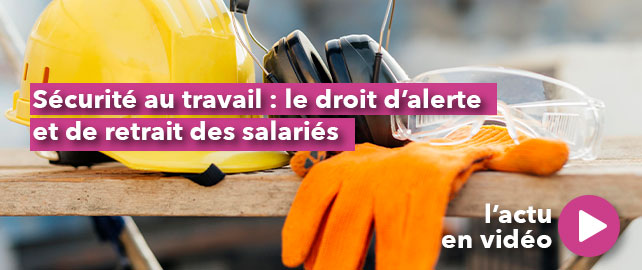Jusqu’à présent, l’action de groupe était cantonnée à certaines thématiques sectorielles, et il faut le dire quasiment « virtuelle » en pratique, d’où la volonté de faire évoluer son cadre juridique en cohérence avec le droit de l’Union européenne.
*Selon les rapporteurs de la proposition de loi en 2022, seules 32 actions de groupe avaient été intentées en France depuis 2014, très majoritairement dans le domaine de la consommation.
A compter du 3 mai 2025, un nouveau régime unifié et élargi est applicable (même s’il doit encore donner lieu à l’importantes précisions réglementaires).
Sur le papier, ce nouveau cadre s’avère potentiellement puissant (on peut d’ailleurs faire ici un parallèle avec le renforcement légal du cadre sur les lanceurs d’alertes), il faut donc anticiper quels pourront être les nouvelles stratégies judiciaires sur le sujet, et donc, pour les entreprises et leurs assureurs, les nouveaux risques associés.
Sans entrer dans tout le détail assez technique du dispositif, notamment sur le plan procédural, voici un panorama d’ensemble d’incidences en lien avec la thématique de santé, sécurité et conditions de travail :
Nouveau régime unifié (article 16 de la loi)
| Incidences SSCT | |
Qu’est-ce que l’action de groupe ?
| Définition légale : une action de groupe est exercée en justice par un demandeur habilité pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, résultant d'un même manquement ou d'un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par une personne agissant dans l'exercice ou à l'occasion de son activité professionnelle, par une personne morale de droit public ou par un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public. L'action de groupe est exercée afin d'obtenir soit la cessation du manquement, soit la réparation des préjudices, quelle qu'en soit la nature, subis du fait de ce manquement, soit la satisfaction de ces deux prétentions. | |
Quels sont les domaines possibles de l’action de groupe ?
| Abrogation des régimes sectoriels (consommation, environnement, discriminations, protection des données personnelles).
Plus de limitation thématique, notamment dans le domaine du droit du travail.
| Typiquement, on imagine immédiatement un « champ des possibles » très vaste, notamment dans le domaine SSCT.
L’environnement n’est pas en reste, puisqu’il s’agissait déjà d’un des 4 domaines réservés à l’action de groupe (cf. L142-3-1 C. Env. abrogé), et qui subsiste dans le nouveau socle commun.
Idem s’agissant de la santé publique, mais sous réserve de quelques règles spécifiques.
|
Quels sont les auteurs susceptibles d’être mis en cause ?
| L’action de groupe peut viser :
Particularité : en cas de manquement à des obligations légales ou contractuelles résultant du Code de la Santé publique (CSP), l'action de groupe ne peut être exercée qu'à l’encontre d’auteurs limités (producteur, fournisseur de produits de santé ou prestataire utilisant l'un de ces produits). | En l’absence de liste limitative, on peut imaginer dans le champ de la SSCT, des actions dirigées contre des personnes (morales ou physiques) ayant qualité :
|
Quels sont les types de manquements concernés ?
| Manquement à des obligations légales ou contractuelles. | Pourront logiquement être ici concernés des manquements aux obligations :
|
Quels sont les plaignants ?
| Il peut s’agir de personnes physiques ou morales (au moins 2).
Exigence d’un lien entre les personnes concernées : similarité de situation (plus souple qu’identité), résultant d'un même manquement ou d'un manquement ou d'un manquement de même nature.
On parle de « dommage sériel ».
NB : toute clause ayant pour objet ou pour effet d'interdire à une personne de participer à une action de groupe est inopérante et réputée non écrite. | Typiquement, l’action de groupe peut concerner des cas où un collectif de travailleurs (entendu au sens large cf. L4111-5 CT) serait concerné par un manquement à l’obligation de sécurité et de protection de la santé, sous réserve qu’il s’agisse d’un manquement de même nature (ce qui peut poser question si les personnes n’ont pas un même lien de droit avec l’entreprise mise en cause).
|
Par qui peuvent-ils être représentés à l’action de groupe ?
| La réforme élargit les entités habilitées à porter une action de groupe au contentieux. Citons ici en particulier :
NB : la décision volontaire d’adhérer au groupe (« opt-in ») n'implique pas l’adhésion automatique à l'association ou à l'organisation syndicale mandatée.
| Si les organisations syndicales (justifiant d’une représentativité) sont en première ligne, elles n’auront pas de monopole puisque des associations pourront également diligenter une action de groupe contre un employeur (si elles remplissent les conditions et notamment que leur objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte).
A noter que ces acteurs pourront exercer l’action de groupe conjointement ou intervenir volontairement à une instance en cours.
Les inspecteurs du travail n’ont pas qualité à pouvoir agir en action de groupe (ils disposent d’autres prérogatives en SSCT). De même s’agissant des CSE.
En revanche, la possibilité d’intervention du Ministère public pour exercer en qualité de partie principale une action de groupe en cessation du manquement est une évolution importante (reste à voir si elle sera mobilisée ou non, par exemple concernant des problématiques d’exposition collective à des risques).
Celui-ci peut également demander, indépendamment des préjudices subis, la condamnation du responsable à une sanction financière en cas de faute dolosive délibérée en vue d'obtenir un gain ou une économie indu, qui n’est pas assurable (C. Civ. Art. 1254 nouveau). D’esprit quasi-« punitif », cette sanction civile peut être cumulable avec une amende pénale ou administrative, sous respect du principe de proportionnalité, et dans la limite d’une somme pouvant atteindre jusqu’à 5 fois le gain réalisé pour une entreprise.
|
Quels types de demande en justice ?
| L’action de groupe peut rendre à 2 types de demandes (éventuellement cumulables), et soumises à des règles procédurales spécifiques :
| En matière de droit du travail, la procédure en cessation de manquement est toutefois soumise à un préalable procédural obligatoire :
En matière d’action de groupe en réparation, tous types de préjudices peuvent être indemnisables (tels que préjudice d’anxiété par exemple).
A noter que les dommages corporels sont soumis à des règles particulières :
Le demandeur à l'action peut agir en indemnisation directement contre l'assureur garantissant la responsabilité civile du responsable (C. Ass., L124-3). |
| Devant quelles juridictions ? | En matière judiciaire, des tribunaux judiciaires spécialisés doivent être désignés (compétence territoriale spécifique).
| L’action de groupe vient donc compléter les stratégies possibles d’action judiciaire existantes : - au plan collectif (contentieux collectif du travail devant les TJ),
- au plan individuel (Conseils de prud’hommes, Pôle social des TJ).
L'adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation de préjudices restant non visés au jugement définitif.
|
| Quelles sont les mesures de publicité ? | Outre la liste des entités qualifiée au niveau de l’UE, les associations son soumise à une obligation de transparence et d’information du public sur leur fonctionnement et leurs actions.
Par ailleurs, un registre public sur les actions de groupe sera ouvert auprès du Ministère de la Justice (attendre décret d’application).
En parallèle, les décisions judiciaires donnent lieu à publicité, soit à la charge du défendeur condamné, soit du demandeur en cas d’action déclarée irrecevable.
| Dans la mesure où l’action de groupe peut être désormais facilitée par un financement en provenance de tiers, l’exigence de prévention de conflits d’intérêts est essentielle (garanties d’indépendance), afin notamment d’éviter toute forme d’instrumentalisation de l’action de groupe (entités concurrentes notamment).
La publicité élargie qui sera faite à ces actions constitue toutefois un enjeu réputationnel fort pour les entreprises (cf. RSE et durabilité notamment). |
Reste maintenant à attendre le train de textes d’application et surtout, de suivre la mise en œuvre de nouvelles actions de groupe, qui ne manqueront pas de donner lieu à d’importants débats sur leur recevabilité procédurale, avant même d’aborder la responsabilité sur le fond !