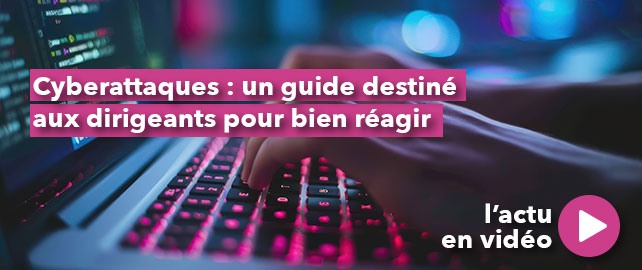Ces informations peuvent revêtir un caractère sensible, notamment lorsqu’elles portent sur sa stratégie économique ou la mise en oeuvre de projets technologiques ou de réorganisation.
Il est donc nécessaire d’encadrer et de réguler l’accès à ces données, ainsi que leur usage.
La loi n° 2018–670 du 30 juillet 2018 (JORF du 31 juillet 2018) est venue transposer en droit français la Directive européenne n° 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites (cf. C. Com., L151-1 et s. nouveaux). Ce nouveau cadre juridique permet d’améliorer la protection des secrets d’affaires, pour laquelle les instruments juridiques disponibles jusqu’alors étaient insuffisants.
Les polémiques relatives au risque d’atteinte à la liberté d’expression et d’information n’ont finalement pas eu raison d’un texte qui s’avère globalement équilibré et dont aucune disposition n’a été jugée non-conforme à la Constitution (cf. Cons. Const., décision n° 218-768 DC du 26 juillet 2018).
Des dispositions spéciales sont prévues concernant, notamment, le cas des représentants du personnel.
Même si celles-ci visent les « représentants » des salariés au sens large, il semble utile d’appréhender les modalités de protection du secret des affaires, dans un contexte de déploiement du nouveau CSE (comité social et économique) dans les entreprises au plus tard d’ici le 1er janvier 2020, en remplacement des CE, CHSCT et délégués du personnel qui seront fusionnés dans cette instance unique.
La protection du secret des affaires, qui relève du droit
commercial, doit désormais être superposée au régime de la
confidentialité des informations transmises aux représentants du
personnel (notamment au travers de la BDES – base de données
économiques et sociales), qui relève quant à elle du droit du
travail.
1) Le cadre général de l’obligation de secret ou de
discrétion
Pour resituer les choses, le Code du travail prévoit, s’agissant des membres du CE, une double obligation, d’une part, de secret professionnel, « pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication » ; d’autre part, de discrétion, « à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur » (cf. art. L2325-5 et L4614-9 anciens). Lorsqu’elles sont transmises via la BDES, les informations qui revêtent un caractère confidentiel doivent être présentées comme telles par l'employeur (soumises à l’obligation de discrétion) à charge pour celui-ci d’indiquer la durée du caractère confidentiel de ces informations (C. Trav., R2323-1-8 ancien). Dans certains cas particuliers (ex : documents comptables, droit d’alerte économique, etc.), les documents fournis par l’employeur sont réputés confidentiels, de plein droit en vertu de la loi.
Ces dispositions sont transposées dans le cadre du nouveau CSE (cf. notamment C. Trav., L2312-36, L2315-3).
La violation du secret professionnel est pénalement répréhensible, tandis que la violation de l’obligation de discrétion n’engage que la responsabilité civile de son auteur (outre la possibilité de sanctions disciplinaires), à un moindre niveau. Dans ce domaine, le mandat de représentation ne confère aux représentants aucune immunité, hormis l’obligation pour l’employeur de solliciter une autorisation administrative préalable en cas de licenciement pour faute.
Mettons de côté la question des secrets de fabrication ; la marge d’appréciation n’est pas toujours aisée pour définir s’il est pertinent de considérer une information comme ayant un caractère confidentiel.
Or, la confidentialité ne se décrète pas et il appartient à l’employeur de spécifier au cas par cas (et de s’en ménager une preuve), que telle ou telle information est soumise à confidentialité, et le cas échéant selon quelles modalités. Le principe étant que les élus doivent pouvoir communiquer avec le personnel, il ne saurait être question, sous peine de délit d’entrave, de soumettre l’ensemble des informations données à la confidentialité (précisons notamment que c’est parce que les informations peuvent être soumises à confidentialité que l’employeur ne peut refuser de les communiquer aux représentants, lorsqu’il s’agit des documents relevant de l’obligation d’information nécessaires en vue d’une consultation).
Pour autant, la jurisprudence donne quelques points de repères ; ainsi, il est possible de considérer qu’une information mérite la confidentialité lorsqu’elle est susceptible de nuire aux intérêts de l’entreprise si elle venait à être divulguée (même si aujourd’hui, l’extension du régime de protection des lanceurs d’alerte vient bouleverser quelque peu cette approche … ).
En pratique, même si dans l’immense majorité des cas les acteurs font preuve de responsabilité sur les sujets confidentiels, il paraît néanmoins important de sensibiliser les partenaires sociaux sur leurs obligations, liées aux enjeux de sécurité du patrimoine immatériel de l’entreprise.
Des clauses particulières peuvent être insérées en ce sens, prioritairement dans le cadre de l’accord collectif régissant la mise en place et le fonctionnement du CSE, sachant que le fonctionnement de la BDES est désormais négociable en grande partie (on s’intéressera en particulier à la question sensible des modalités d’enregistrement des réunions, étant précisé que selon l’article D2315-27 du Code du travail : « (…) Lorsque cette décision émane du comité social et économique, l'employeur ne peut s'y opposer sauf lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel au sens de l'article L. 2315-3 et qu'il présente comme telles. Lorsqu'il est fait appel à une personne extérieure pour sténographier les séances du comité, celle-ci est tenue à la même obligation de discrétion que les membres du comité social et économique »).
Précisons à ce sujet que dans un autre registre, le législateur a
heureusement considéré que tout ne pouvait être
« transparent » même si cela constitue une tendance de
fond de l’évolution de la société. Ainsi, à défaut d’un acte par
lequel les parties à un accord collectif prévoient que celui-ci
ne sera pas publié en version intégrale, « l'employeur peut
occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques
de l'entreprise », unilatéralement et préalablement à la
transmission de l’accord en vue de sa publication via la nouvelle
base de données nationale (C. Trav., L2231-5-1, R2231-1-1).
2) Le cadre particulier du secret d’affaires
De la même manière que toutes les informations figurant parmi la
masse d’informations mises à la disposition des représentants du
personnel ne peuvent être déclarées
« confidentielles », toutes ne peuvent pas non plus
être considérées comme des secrets d’affaires.
La définition du secret d’affaires protégé par la loi est large mais également restrictive puisqu’elle suppose la réunion de 3 critères cumulatifs.
Selon l’article L151-1 du Code de commerce, « est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
- Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
- Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
- Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret ».
Dès lors que ces critères sont réunis, la protection s’applique
de plein droit en vertu de la loi sans que l’employeur, détenteur
légitime d’un secret d’affaires, n’ait à spécifier que ces
informations ou données sont confidentielles (cela étant, en
pratique, « qui peut le plus peut le moins »).
Il appartiendra à la jurisprudence d’apporter des précisions sur cette qualification, notamment sur l’interprétation de ce qu’il faut entendre par « valeur commerciale effective ou potentielle ».
S’agissant des représentants du personnel, cette question revêt une importance particulière puisque bien souvent, ceux-ci ont accès à des informations sensibles relatives à la stratégie de l’entreprise par exemple, qui n’ont pas directement de valeur commerciale mais pourraient par exemple intéresser fortement des entreprises concurrentes dans le cadre d’actions d’« intelligence économique ».
La particularité de ce régime légal est de définir les modes d’obtention et de détention légitime d’un secret des affaires ; et à l’inverse, de prémunir son détenteur légitime contre toute forme d’obtention, d’utilisation ou de divulgation illicite.
Dans ces cas, la loi ouvre la possibilité au détenteur légitime du secret d’affaires d’agir en justice pour engager la responsabilité civile de toute personne ayant obtenu, utilisé ou divulgué de manière illicite le secret d’affaires (aucune infraction pénale nouvelle n’est toutefois créée dans ce domaine), mais également pour obtenir de la juridiction saisie la mise en place de mesures conservatoires afin de prévenir ou de faire cesser une atteinte au secret des affaires.
Sur ce terrain, les représentants du personnel disposent toutefois d’une protection particulière (cf. C. Com., L151-9).
Ainsi, et par dérogation, lorsqu’une instance relative à une atteinte au secret des affaires est engagée, le secret des affaires n’est pas opposable dans 2 situations (peu importe a priori que l’employeur soit en demande, ou en défense dans le cadre d’un contentieux engagé par des salariés ou des institutions représentatives du personnel) :
- Soit lorsque l’obtention du secret des affaires est
intervenue dans le cadre de l’exercice du droit à l’information
et à la consultation des salariés ou de leurs
représentants : dans ce cas, l’employeur ne peut invoquer
une obtention illicite par les représentants du personnel, ce qui
paraît assez logique par exemple lorsque les informations ont été
mises à disposition d’informations dans la BDES. Tel que le texte
est libellé, cela est toutefois limité aux procédures
d’information et de consultation. Particularité, le texte
envisage la consultation des représentants, mais également celle
des salariés, ce qui pourrait par exemple s’appliquer à des cas
de consultation par voie de référendum (cf. nouvelles hypothèses
de négociation collective dans les TPE), même si on imagine assez
mal qu’il puisse traiter d’un secret d’affaires.
- Soit lorsqu’une divulgation du secret des affaires par des salariés à leurs représentants est intervenue dans le cadre de l’exercice légitime par ces derniers de leurs fonctions, pour autant que cette divulgation soit nécessaire à cet exercice. On pense ici par exemple à l’exercice du droit d’alerte. Dans ce cas, l’employeur ne peut opposer aux salariés concernés une divulgation illicite. Encore faut-il que celle-ci soit strictement liée et nécessaire à l’exercice des fonctions des représentants concernés, ce qui dépend de la nature du mandat en cause, les attributions n’étant pas les mêmes selon qu’il s’agit par exemple d’un membre élu du CSE, d’un représentant de proximité ou d’un délégué syndical.
Précisons que ce mécanisme a été contesté après le vote de la
loi, notamment en ce qu’il violerait le principe constitutionnel
de participation des travailleurs à la détermination collective
des conditions de travail, faute de protéger également
l'utilisation du secret des affaires légalement obtenu par les
salariés ou leurs représentants, ainsi que la divulgation de ce
secret aux salariés par leurs représentants.
Dans sa décision précitée (cf. Considérants n° 29 à 35), le Conseil constitutionnel a toutefois considéré que la loi n’était ni contraire aux exigences constitutionnelles, ni à la directive européenne : « (…) l'information obtenue ou divulguée légalement, en vertu des 1° et 2° de l'article L151-9 du code de commerce, dans le cadre de l'exercice du droit à l'information et à la consultation des salariés ou de leurs représentants ou dans celui de l'exercice légitime par ces derniers de leurs fonctions, peut être utilisée aux mêmes fins, sous réserve, en vertu du dernier alinéa de l'article L151-9, qu'elle demeure protégée au titre du secret des affaires à l'égard des autres personnes ».
C’est là le point important : la loi prend en effet le soin de préciser ici que « l’information ainsi obtenue ou divulguée demeure protégée au titre du secret des affaires à l’égard des personnes autres que les salariés ou leurs représentants qui en ont eu connaissance ». La dérogation au secret d’affaires n’est donc pas générale ; celui-ci reste protégé à l’égard de ces « tiers », y compris en interne au sein de l’entreprise.
A fortiori, cette disposition n’autorise pas des salariés ou leurs représentants à divulguer des secrets d’affaires à l’extérieur de l’entreprise, sous peine d’engager de plein droit leur responsabilité civile (précisons à ce sujet que, contrairement à la jurisprudence habituelle de la Chambre sociale de la Cour de cassation, la loi n’impose pas ici l’exigence d’une faute lourde du salarié).
Il convient toutefois de réserver l’hypothèse où la personne concernée pourrait se prévaloir d’une exception au secret des affaires au titre des autres dérogations légales (C. Com., L151-8), en cas d’obtention, d’utilisation ou de divulgation :
- Soit pour exercer le droit à la liberté d’expression et de
communication, y compris le respect de la liberté de la presse,
et à la liberté d’information ;
- Soit pour révéler, dans le but de protéger l’intérêt général
et de bonne foi, une activité illégale, une faute ou un
comportement répréhensible, y compris lors de l’exercice du droit
d’alerte défini à l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9
décembre 2016 (« Un lanceur d’alerte est une personne
physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de
bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste
d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé
par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation
internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la
loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour
l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.
Les faits, informations ou documents, quels que soient leur forme
ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale,
le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et
son client sont exclus du régime de l’alerte défini par le
présent chapitre ») ;
- Soit enfin pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national.
En cas d’obtention, de divulgation ou d’utilisation jugée
illicite, le fait que la loi n’envisage que la responsabilité
civile n’empêche bien naturellement pas l’employeur d’agir sur le
terrain disciplinaire.
En cas de contestation de la sanction par le salarié, la question de l’opposabilité du secret peut alors rebondir devant la juridiction saisie, étant précisé que la loi prévoit de nouvelles dispositions permettant de préserver le secret des affaires dans le cadre de procédures devant les juridictions civiles (ex : Conseils de prud’hommes) ou commerciales. Objectif : éviter qu’un procès puisse être instrumentalisé au nom du principe du contradictoire, afin d’obtenir la communication de pièces susceptibles de porter atteinte à un secret d’affaires.
D’une part, le juge dispose de nouveaux pouvoirs lui permettant
de cantonner les informations à communiquer et de prendre au cas
par cas des mesures préventives (C. Com., L1513-1) ;
d’autre part, toute personne ayant accès à une pièce considérée
par le juge comme étant susceptibles d’être couvertes par le
secret des affaires, est tenue à une obligation de
confidentialité lui interdisant toute utilisation ou divulgation
des informations qu’elle contient (C. Com., L153-2).
3) Quid de l’expert du CSE ?
Cette question est sensible en pratique, d’autant que les
désignations d’experts donnent très fréquemment lieu à litiges
sur l’étendue des documents à transmettre à l’expert.
Au regard du droit du travail, celui-ci est soumis à la même obligation, tantôt de secret, tantôt de discrétion, que les membres de l’instance qui le mandate (CE, cf. C. Trav., L2325-42 ancien ; CHSCT, cf. L4614-13 ancien ; CSE, cf. L2315-84 nouveau).
Peu importe qu’il soit Expert-comptable ou expert habilité, les
obligations étant ici identiques.
Au regard du droit commercial, l’Expert peut en outre tomber sous
le coup de la protection du secret d’affaires. Encore faut-il
qu’il puisse à la base justifier que sa mission nécessite d’avoir
accès à un tel secret compte tenu de la définition précitée.
Le cas échéant, si l’obtention illicite d’informations paraît
relever de l’hypothèse d’école au regard de la définition qu’en
donne l’article L151-4 du Code de commerce, le scénario d’une
utilisation ou d’une divulgation illicite n’est en revanche pas
totalement improbable, sachant que selon l’article L151-5 du Code
de commerce, celle-ci peut intervenir lorsque son auteur
« agit en violation d’une obligation de ne pas divulguer le
secret ou de limiter son utilisation » (d’où l’importance de
faire adapter si besoin les termes de la lettre de mission
proposée).
Cela pose toutefois la question de la portée de l’obligation de
confidentialité de l’expert vis-à-vis du CSE (son mandant), qui
constitue une « zone grise ».
En tout état de cause, l’expert désigné ne pourra se prévaloir
des dérogations visées à l’article L151-9, 1° ou 2° du Code de
commerce relatives à la divulgation du secret d’affaires aux
représentants, faute de figurer parmi les personnes visées par
ces textes. De ce point de vue, les informations couvertes par le
secret d’affaires paraissent mieux protégées que celles soumises
à la simple confidentialité.