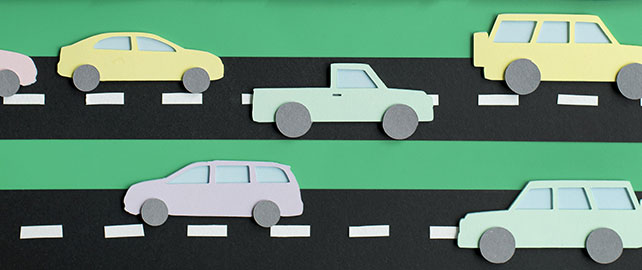Pourquoi cette mission Sandy que vous avez menée aux
Etats-Unis en mars dernier ?
J’étais aux Etats-Unis lorsque la tempête Sandy a touché New York
et j’ai été frappé de constater l’efficacité avec laquelle les
Américains ont su gérer cette crise. J’ai donc proposé au SGDSN
(Secrétariat Général à la Défense et à la Sécurité Nationale)
d’organiser une mission d’étude sur place avec des représentants
de la défense civile, des pouvoirs publics et du secteur privé
français.
Quel était l’objectif de cette mission et comment
s’est-elle déroulée ?
Notre objectif était de comprendre la façon dont les Américains
ont géré cette crise avec leurs forces et leurs faiblesses et
d’en tirer des enseignements, sur la gestion d’une crise liée à
l’inondation d’une mégapole.
En Ile-de-France, de tels scenarii sont à l’étude dans
l’hypothèse d’une crue centennale de la Seine.
Nous avons visité un certain nombre d’infrastructures vitales
pour comprendre comment elles avaient été touchées et les
procédures de gestion de crise qui ont été mises en place :
une usine de traitement des eaux usées, le centre de pilotage de
l’électricité, l’aéroport de la Guardia et nous avons rencontré
également les responsables des services majeurs concernés par
cette crise : la FEMA (Federal Emergency Management Agency)
, les Sapeurs Pompiers et la Police de New York, le NYS OEM
(New York State Office of Emergency Management), la Metropolitan
Transportation Authority, …
Quels sont les principaux enseignements que vous avez pu
tirer de cette mission ?
Nous ne pouvons que saluer la façon dont les autorités
américaines ont su gérer cette crise majeure. Aux Etats-Unis le
dimensionnement de la gestion de crise est beaucoup plus
important qu’en France, à périmètre égal en nombre
d’habitants. Pour des raisons historiques : le pays est
par nature beaucoup plus vulnérable aux grands aléas climatiques
mais aussi du fait d’un système de fonctionnement
particulier : la FEMA est alimentée par des dons et les
Américains sont fortement mobilisés sur ce point.
Ensuite nous avons pu constater une interconnexion très forte
entre secteur public et secteur privé en situation de crise. Les
grands acteurs du secteur privé ont tous une cellule de crise
immédiatement opérationnelle et en lien direct avec les cellules
de crise publiques, ce qui permet une réaction rapide et efficace
pour remettre en route l’économie.
Enfin Sandy est la première crise complètement numérique !
Cet événement a mis en lumière le rôle désormais majeur des
réseaux sociaux dans la communication de crise, à la fois en
termes de communication descendante mais aussi entre les
populations. Un outil simple, réactif, peu consommateur de bande
passante qui a permis aux populations d’être informées de ce qui
se passait à l’échelle de leur quartier.
Quelles recommandations peut-on en tirer à l’échelle de
la France ?
Même si les infrastructures de gestion de crise américaines ont
des dimensions que nous n’atteindrons jamais en France, leur
modèle de gestion de crise est riche d’enseignements et nous
avons émis un certain nombre de recommandations qui font l’objet
d’un rapport qui devrait être rendu public prochainement.
Pour moi trois idées majeures sont à retenir :
Tout d’abord la formation préalable des acteurs de la crise qui
doivent être préparés et entraînés à divers scenarii.
Ensuite une plus forte intégration entre privé et public pour
fluidifier la communication et la gestion de la crise
Enfin, utiliser au maximum le potentiel des réseaux sociaux en
communication.