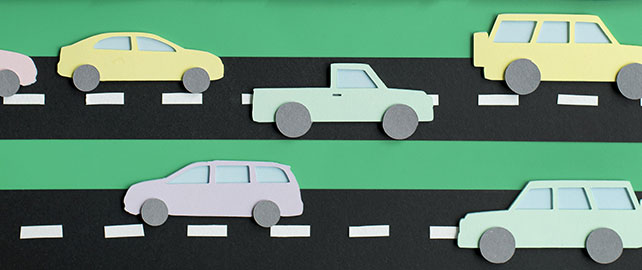Parlez-nous de l’organisation des services de prévention des
risques professionnels de la Ville de Paris et de vos
missions.
La Mairie de Paris est la plus importante de France avec plus de
45 000 agents titulaires et 10 à 15 000 vacataires
selon les saisons. La prévention des risques professionnels a
donc dû se structurer très tôt. L’organisation, mise en place à
partir du décret de 1985, y est complexe. Revenons tout d’abord
sur l’organigramme de la Ville : un secrétariat général est
complété par 20 directions transversales ou thématiques. Chaque
Direction prend en charge l’hygiène-sécurité de ses propres
services. Les directeurs et cadres, chargés de la mise en œuvre,
s’appuient sur un réseau de proximité (ACMO, relais et
animateurs : agents de terrain formés à la prévention des
risques) et un réseau de ressources animé par les
Bureaux Prévention. Les Directions les plus importantes ont
leurs propres bureaux, les autres font appel à des bureaux
mutualisés. Le réseau de ressources réunit des conseillers
prévention, médecins du travail, hygiénistes, ergonomes… qui
soutiennent les services dans la mise en œuvre de leur politique
de maîtrise des risques. De plus, chaque Direction dispose d’un
CHS (amené à se transformer en CHSCT au cours de l’année
2011).
Par ailleurs, au niveau central, la DRH comprend un Pôle Santé
(service de santé au travail et bureau de prévention) qui
coordonne cette politique et un CHS central qui pilote l’ensemble
de la politique en santé-sécurité au travail de la Ville de
Paris. Pour ma part, je dirige l’inspection hygiène et sécurité
rattachée fonctionnellement au secrétariat général de la
Ville : elle a pour vocation de contrôler la bonne mise en
œuvre des politiques de prévention de l’ensemble des services. Le
taux d’AT/MP de la Ville de Paris reste élevé malgré les mesures
prises. Aussi, des inspecteurs se déplacent dans les services
pour effectuer des vérifications périodiques des plans d’action.
Quelles sont vos problématiques de
prévention ?
L’importance numérique de la Ville de Paris laisse imaginer que
ses agents œuvrent dans un très grand nombre de fonctions. Les
différentes Directions ne font vraiment pas le même métier et ne
sont pas forcément exposées aux mêmes dangers ! Une
politique commune de prévention des risques est donc complexe à
mettre en place et d’ailleurs nous n’avons pas pris le problème
dans ce sens-là : les plans d’action sont partis des
Directions et vont, dans un second temps, être rassemblés dans un
programme global (DU).
Néanmoins, nous sommes confrontés, comme tout le secteur public,
à un certain nombre de problématiques générales liées aux
organisations du travail : responsabilisation de
l’encadrement à la santé-sécurité au travail, réflexion sur les
contraintes liées aux nouvelles technologies et aux nouveaux
enjeux du management, vieillissement de la population, pénibilité
des tâches et bien vieillir au travail.
Que mettez-vous en place pour y
pallier ?
Nous avons agi dans plusieurs directions pour tenter de réduire
l’exposition aux risques de nos agents.
Les risques psychosociaux, qui retiennent l’attention de toutes
les organisations professionnelles, sont abordés depuis plusieurs
années : nous avons pris des mesures concernant les
violences sur la voie publique, l’agressivité des usagers, les
violences internes, le stress… et une commission harcèlement
soutient les difficultés de nos personnels. En outre, les
fonctionnaires qui éprouvent des problèmes de souffrances au
travail peuvent faire appel aux services de santé de la Ville (un
psychologue du travail les accueille) et le service interne
d’urgence psychologique peut intervenir sur le terrain en cas de
grave souci.
Les services de prévention de chaque Direction s’intéressent
également au risque chimique : les données, centralisées,
donnent ensuite lieu à des initiatives transversales. Enfin, tous
les services travaillent à la mise en place du Document Unique
depuis plusieurs années. Un programme d’actions global est
actuellement en discussion avec les syndicats.
La Ville souhaite rester dans cette dynamique de structuration de
sa politique de prévention des risques. Ainsi, le dernier CHS, en
novembre 2009, a présenté un plan d’action pluriannuel. Sa mise
en œuvre sera l’occasion de discussions entre l’administration
centrale de la Ville de Paris, les services et les partenaires
sociaux. Ce plan rappelle les principes généraux, valeurs et
objectifs que nous souhaitons appliquer, en totale cohérence avec
le contexte national (accords de novembre 2009). La première
partie de l’année 2011 sera consacrée aux négociations concernant
la politique globale santé-travail (plusieurs volets :
management et outils de santé-travail ; maîtrise des risques
professionnels prioritaires – TMS, RPS, risques chimiques,
risques liés aux situations de travail sur la voie publique,
prévention des addictions…), les objectifs à atteindre et les
moyens pour y arriver.
Qu'est-ce que les accords de novembre 2009 vont changer
pour vous ?
Notre ampleur et notre importance stratégique ont imposé de nous
organiser très tôt en matière de maîtrise des risques. Aussi, les
valeurs fondamentales de ces accords ont déjà cours chez nous ou
vont faire l’objet de discussions prochaines. Pour le reste, tels
les CHSCT, nous allons bien évidemment nous conformer à ce qui
sera décidé. Alors que nombre de collectivités se structurent,
l’antériorité de notre organisation en matière de prévention nous
permet de déjà fixer des objectifs quantitatifs de résultats (au
regard de l’évaluation des actions menées par les réseaux).
Nous travaillons à l’analyse des indicateurs à notre disposition,
impliquant tous les niveaux de la hiérarchie dans une démarche
commune et prônons le développement du dialogue social.
De quelle manière Préventica peut-il s’inscrire dans ces
futurs développements ?
Une précision tout d’abord : j’ai connu l’événement en tant
que Président de Respect et en 2011, c’est au nom de la Ville de
Paris que je serai présent.
Pour en revenir à mes fonctions : j’ai participé à la mise
en place des services prévention de la Ville avant de répondre
des missions d’inspection et, fort de cette expérience unique en
France en terme de structuration d’une collectivité, je souhaite
partager ce savoir-faire. En outre, je considère que Préventica
est incontournable pour les préventeurs du privé comme du
public : le Congrès/Salon regroupe les acteurs et les
prestataires de tous les secteurs d’activité. Il est un lieu
d’échanges exceptionnel. J’incite mes agents à y participer
depuis plusieurs éditions connaître ce qui se fait ailleurs. Même
si la prévention des risques est ancienne à la Ville de Paris,
nous ne pouvons pas rester autocentrés : l’expérience des
autres nous permet aussi de progresser.