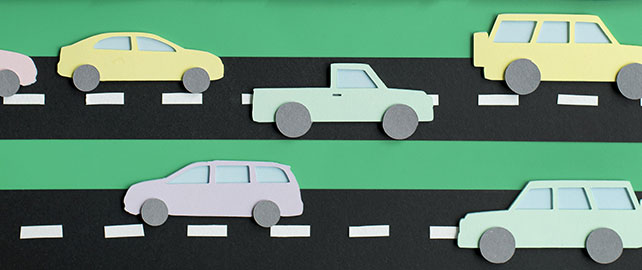Qu’apporte l’approche ergonomique en matière de
formation ?
Les formations à la prévention des TMS, et notamment la formation
« Gestes et Postures » telle qu’elle était dispensée
par le passé, ne prennent pas suffisamment en compte le travail
réel de l’opérateur, ce qui entraîne par la suite des difficultés
à mettre en pratique les apports de la formation, décalée par
rapport aux réalités du métier.
L’introduction de la dimension ergonomique dans les modules de
formation permet d’enrichir les contenus. L’ergonome va d’abord
observer la réalité du travail pour mettre en débat les
savoir-faire, les pratiques de prudence et les compromis
opératoires qui doivent y être réalisés.
Ce travail d’observation va ensuite pouvoir être restitué et
permettra d’adapter le contenu de la formation aux situations
réelles de travail.
La mise en place de nouvelles gestuelles de travail ne peut être
effective que si un débat est possible au sein du collectif de
travail.
Cette dimension ergonomique est-elle désormais mieux
intégrée par les collectivités et les entreprises dans leurs
demandes de formation pour leurs salariés ou
agents ?
Oui. Nous observons que de plus en plus de DRH et de directions
dans les collectivités créent des bureaux de prévention avec des
préventeurs, des ergonomes, des psychologues du travail…
L’intégration de ces compétences fait que les exigences de
formation ont évolué, que ce soit en prévention TMS ou pour ce
qui concerne la pénibilité ou les risques psychosociaux.
Il y a eu beaucoup de confusion lors de la mise en place du
référentiel PRAP qui a pu être interprété comme une alternative à
la formation « Gestes et Postures ». En réalité le
référentiel PRAP a plutôt pour objectif de former des acteurs de
prévention au sein des entreprises, y compris parmi les
opérateurs, qui ont pour mission de s’intéresser à l’adaptation
des postes ou situations de travail.
Cette démarche vient compléter, mais pas remplacer, la prise en
compte du travail quotidien des opérateurs dans leur engagement
individuel ou en collectif de travail (équipe, binômes) et la
réflexion sur les options et compromis susceptibles de faciliter
leur tâche dans un environnement contraignant.
Aujourd’hui nous revenons, dans cet esprit, à des formations
Gestes et Postures mais avec l’apport supplémentaire de l’analyse
ergonomique.
Vous intervenez actuellement auprès de la direction des
espaces verts de la Ville de Paris, dans quel
contexte ?
Comme dans d’autres directions, nous avons effectivement bâti
différents modules de formation « Gestes et Postures »
pour les jardiniers de la Ville de Paris. L’objectif était
d’intégrer les spécificités de leur activité et les pratiques
professionnelles afin d’adapter la formation au plus près de
leurs besoins réels. Nous avons pour cela d’abord réalisé des
temps d’observation pour bien appréhender les contextes
professionnels de ces corps de métiers, comprendre les gestes de
travail, leurs contraintes et ce qui les détermine, et identifier
les stratégies opératoires.
Nous avons ensuite construit et validé les contenus de formation
au sein de groupes de travail composés d’agents de terrain et de
conseillers en prévention de la Direction des Espaces Verts et de
l’Environnement.
Les formations sont maintenant déployées dans leurs propres
locaux de travail, sur des sites permettant des mises en
situation réelles et en s’appuyant sur les outils qu’ils
utilisent, par petits groupes de 8 à 10 personnes maximum, afin
de favoriser l’émergence du débat et des échanges notamment
autour des savoir-faire de prudence.
Il est difficile de mesurer aujourd’hui l’impact de ces
formations car il ne peut se mesurer qu’à moyen ou long terme.
Mais nous avons un premier retour des opérateurs et d’autres
directions de la Ville de Paris ou d’autres collectivités dans
lesquelles des projets similaires ont été menés, sur le bénéfice
que ces formations ont pu apporter en ouvrant le débat sur le
travail réel, ce que nous appelons dans notre jargon d’ergonome
« les disputes sur le métier ».
- Jardinier, un métier en mutation : mieux vivre au travail, mieux vivre la ville – Etude de la Mutuelle Nationale Territoriale, novembre 2012