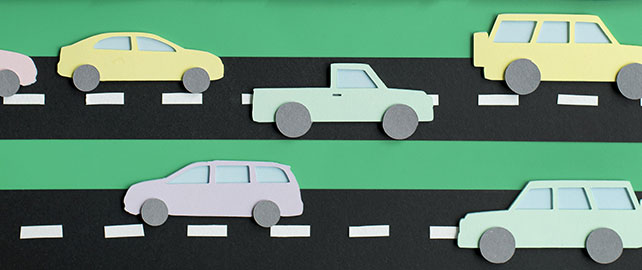Tout d’abord, pourquoi ce colloque dédié aux risques
professionnels du secteur de la conservation et de la
restauration du patrimoine ?
Les métiers de la conservation-restauration du patrimoine sont
particulièrement exposés aux risques professionnels : risque
mécanique, fréquemment illustré par des coupures, risque TMS avec
la manutention de charges lourdes et l’absence de postes de
travail ergonomiques, risque oculaire dû notamment à
l’utilisation intensive des microscopes, risque chimique avec
l’emploi de produits dangereux pouvant contenir des agents CMR,
risque biologique lorsque nous devons manipuler des objets
composites susceptibles d’être attaqués par des agents
biologiques… Aujourd’hui on voit également émerger de plus en
plus le risque psychosocial ainsi que le risque routier, dans un
contexte où nous sommes amenés à parcourir des dizaines de
kilomètres du fait de l’éloignement de nos clients et de leurs
exigences de plus en plus fortes sur un service « à
domicile ».
Or ces risques ont souvent été minimisés voire carrément
occultés.
Pourquoi le secteur de la conservation-restauration du
patrimoine a-t-il si peu mis en œuvre des actions de prévention
des risques professionnels ?
Pour de multiples raisons. La première tient à la diversité des
statuts des professionnels du secteur : peu sont sous statut
salarié de droit privé, la majorité est non salariée avec un
statut artisan ou libéral. Cette hétérogénéité est clairement un
frein pour identifier un groupe sectoriel de personnes soumises
aux mêmes risques professionnels et engager un suivi médical
approprié.
Deuxième raison, un secteur traditionnellement masculin jusque
dans les années 1970 et donc avec des pratiques et des outils
typiquement masculins et une minimisation des moyens de
prévention. Aujourd’hui la tendance est totalement inversée avec
plus de 80% de femmes dans les métiers de la
conservation-restauration du patrimoine mais des pratiques qui
ont peu évolué.
Enfin, les structures sont toutes de très petite taille avec de
petits moyens. Quand le professionnel doit choisir entre un
investissement qui servira la prévention et un investissement en
production, il aura tendance à privilégier la production.
Quelles sont vos préconisations pour améliorer la
prévention des risques professionnels dans les métiers de la
conservation-restauration du patrimoine?
Au-delà de la sensibilisation des professionnels eux-mêmes, nous
devons engager une réflexion avec les donneurs d’ordres pour que
les règles de santé et de sécurité au travail soient plus
intégrées aux appels d’offres et missions. Leur faire connaître
le quotidien de nos activités leur permettrait de mieux
comprendre les risques auxquels nous sommes exposés et nos
exigences en termes de conditions de travail.
Nous participons au programme européen "JOCONDA / Leonardo da
Vinci – Lifelong Learning Programme" (2011-2013) qui regroupe 8
pays européens en tant que chef de file français dont la
thématique porte précisément sur la santé au travail en
conservation-restauration du patrimoine.
Par ailleurs, il y a tout un travail de recherche et d’innovation
à engager sur les matériels/outils avec lesquels nous travaillons
qui sont, la plupart du temps, inadaptés par rapport à nos
besoins et donc potentiellement générateurs de risques pour la
santé et la sécurité.
Prenons l’exemple des opérations de dégangage
d’objets divers (petites pièces, fibules, miroirs…). Nous
sommes amenés à utiliser des micropercuteurs pneumatiques. Ces
derniers sont particulièrement inadaptés à un temps de travail de
trois à sept heures en continu. Le risque vibratoire est élevé et
génère des affections potentielles au bras et à l’épaule.
Nous attendons des fabricants qu’ils nous proposent des solutions
ergonomiques adaptées aux spécificités de notre métier.
Interview réalisée avec la participation de Françoise
Mielcarek, Conservatrice-Restauratrice métal/matériaux
composites, LC2R
- Colloque “Conservation-Restauration et Santé/ Sécurité des personnes et de l’environnement” – 17-21 juin 2013 Figanières-Draguignan