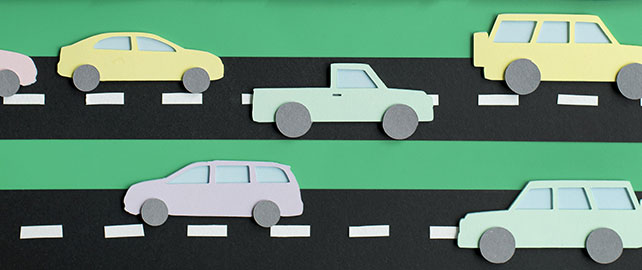Expliquez-nous comment fonctionne la législation en
matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles en
Italie ?
Comme partout en Europe, l’Italie a
connu après la 2nde guerre mondiale, une période de forte
croissance économique aussi bien dans l’industrie que le
bâtiment. Cette période de croissance que nous pourrions presque
qualifier d’effrénée s’est malheureusement accompagnée d’une
hausse exponentielle des accidents du travail. L’Etat s’est alors
employé à mettre en place des lois très strictes pour sanctionner
les entreprises.
C’est en 1994 que ces premières lois ont été révisées avec un
arrêté fondamental pour la santé et la sécurité au travail :
l’arrêté n° 626. Cet arrêté a vraiment posé les bases de notre
politique de santé et de sécurité au travail aujourd’hui et a
permis d’améliorer considérablement l’environnement de
travail.
En 2008, un nouveau texte unique a vu le jour : l’arrêté
n°81 / 2008.
Ce décret transpose en Italie, la directive européenne sur la
protection de la sécurité et la santé des travailleurs, et qui
prévoit des sanctions spécifiques en cas de non-respect par les
sociétés.
L’histoire de l’Italie a été marquée par des procès retentissants
en matière de catastrophes industrielles ? Quels ont été
leur impact ?
La première catastrophe
industrielle d’après-guerre qui a bouleversé le pays est celle de
Seveso en 1976. Un nuage toxique de dioxine sorti d’une usine a
ravagé le territoire. Compte tenu de l’importance de cette
catastrophe, elle a donné son nom à la directive européenne
96/82/CE, dite Seveso, qui impose aux États membres de l'Union
européenne d'identifier les sites industriels présentant des
risques d'accidents majeurs.
Dans le domaine de l’amiante, le procès Eternit en 2011 a donné
lieu à une instruction de près de 7 ans pour déterminer où se
situaient exactement les responsabilités dans ce désastre
sanitaire. La décision qui a été rendue est une avancée sans
précédent puisqu’elle a clairement mis en cause les donneurs
d’ordre et la politique générale de l’entreprise, voire le cartel
mondial de la chimie, plutôt que les seuls dirigeants des usines
concernées.
A la même époque, s’est déroulé le procès Thyssenkrup : le
6 décembre 2007, sept ouvriers de la ThyssenKrupp
mouraient brûlés vifs des suites d’un incendie sur la
ligne 5 de l’usine, celle du laminoir. L’aciériste, qui
entendait fermer à terme son usine turinoise, avait décidé de ne
plus investir dans la sécurité sur le lieu de travail :
extincteurs vides, absence d’installation anti-incendie…
Dans cette affaire, c’est le directeur général de la branche
acier du groupe qui a été condamné le plus lourdement pour
« homicide volontaire ».
La justice italienne a joué un rôle précurseur dans le domaine de
la sécurité au travail en liant l’accident à l’organisation même
de l’entreprise, et à sa recherche de profits au détriment de la
sécurité de ses salariés.
Ces grandes décisions de justice ont profondément impacté
l’esprit de la législation, en impliquant la responsabilité des
hauts dirigeants de l’entreprise dans les politiques de santé et
de sécurité au travail menées à tous les niveaux.
Aujourd’hui, quels sont les axes sur lesquels travaillent les
organismes de prévention en Italie ?
Culturellement l’Italie est le « pays de l’automobile
« et l’usage de la route y est très répandu que ce soit
pour le transport de marchandises ou les déplacements
professionnels. Nous travaillons donc beaucoup sur la prévention
du risque routier et plus particulièrement des accidents de
déplacement.
Ensuite, il y a une vraie culture de la sécurité qu’il faut
arriver à ancrer dans les mentalités, tout cela est encore
fragile. Avec la crise actuelle et les contraintes budgétaires en
découlant, nous devons veiller à ce que la santé et la sécurité
au travail restent des postes d’investissement prioritaires et à
préserver les progrès réalisés tout au long de ces années.