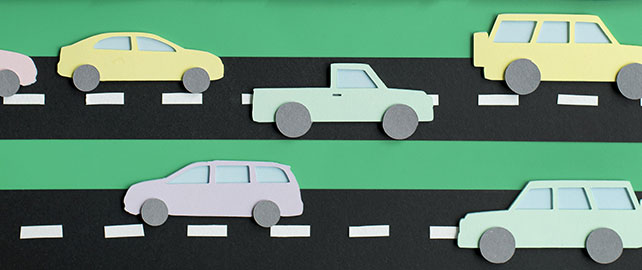Comment avez-vous commencé à vous intéresser à la
question de l’amiante dans les bâtiments ?
Très tôt dans ma carrière d’architecte, je me suis spécialisé
dans les pathologies du bâtiment. Dans des logiques de mise en
conformité et de réhabilitation, il fallait donc que j’analyse la
structure du bâtiment pour décider s’il fallait réparer, remédier
ou isoler ce qui constituait un handicap. Au début des années 90,
malgré les alertes des années 70, les dangers de l’amiante
n’étaient absolument pas intégrés à leur juste valeur : on
prescrivait encore des matériaux et des produits amiantins
partout, sans se soucier des conséquences.
C’est en février 1996 que sont parus les premiers décrets de la
Nouvelle Réglementation sur l’amiante et que s’est révélée la
nécessité de procéder au désamiantage d’un nombre incalculable de
bâtiments.
Je me suis dès lors étroitement impliqué dans les instances
professionnelles, normatives* et réglementaires, pour tenter de
donner un cadre clair et précis à ces opérations, avec l’appui et
le soutien de mon ordre professionnel**.
Aujourd’hui, la protection des salariés en contact avec
l’amiante est clairement définie et les opérations bien
encadrées. Comment envisagez-vous le rôle de votre association,
résoa+, dans ce contexte ?
Notre association a toute sa raison d’être. En effet il reste de
nombreuses zones d’ombre dans la réglementation du désamiantage,
notamment du fait des multiples réglementations auxquelles cela
touche. Nous militons pour que les maîtres d’œuvre en démolition
et réhabilitation de bâtiments anciens soient formés à
l’expertise amiante. En effet, lorsque l’on touche à un bâtiment
contenant de l’amiante, il va falloir prendre des décisions par
rapport aux zones contaminées : doit-on encapsuler, doit-on
enlever ? Seul un maître d’œuvre clairement positionné et
formé est apte à arbitrer. Les architectes, de par leur formation
et leur expérience, seraient parfaitement habilités pour endosser
ce rôle. De leur côté, les entrepreneurs devraient poursuivre
leur effort de formation engagé en 2012.
Mais nous nous attachons également à exiger la mise en œuvre
d’une formation des maîtres d’ouvrage privés et publics, ainsi
qu’une information claire des occupants et usagers.
Est-il possible d’envisager un jour que toute trace
d’amiante soit éradiquée des bâtiments
existants ?
Difficilement et en tout cas pas à court terme. Le diagnostic du
patrimoine est d’une ampleur considérable, pour deux raisons. La
première est la conséquence de l’existence de nombreux
diagnostics incomplets, voire erronés. L’absence de schémas de
repérage efficients est la cause la plus récurrente de
l’obligation de reprendre les diagnostics existants. La seconde
est l’obligation des propriétaires de tenir à jour leur Dossier
Technique Amiante à l’occasion de la vente, ainsi qu’avant tous
travaux et au plus tard avant février 2021. A cette occasion, ils
découvrent au fur et à mesure, des produits amiantins non repérés
lors des inspections antérieures.
Par ailleurs, les moyens manquent pour envisager
sereinement des opérations de désamiantage correctement
conduites. Seules les actions de curage intégral permettraient de
considérer un immeuble « asbestos free ».
Si l’on prend les bailleurs sociaux par exemple, le parc de
logements à désamianter est tel qu’il faut se poser les bonnes
questions avant d’envisager le désamiantage. Nous avons un manque
cruel d’informations objectives sur le sujet amiante en France et
notamment sur les produits contenant de l’amiante qui ont pu être
utilisés, d’où la nécessité de constituer un groupe d’experts
indépendants pour travailler sur ce sujet.
En termes d’échéances, une directive européenne est en cours
d’élaboration afin d’harmoniser les opérations d’éradication de
l’amiante sur l’ensemble des pays de l’Union, pour 2028.
De notre côté, nous estimons qu’en France la seconde vague
réglementaire pourrait être harmonisée en 3 ans, d’ici fin 2015,
sous réserve de voir édicter une grande loi cadre sur l’amiante,
abordant la question financière, notamment en instaurant un
dispositif de bonification de la présence d’amiante.
Pour l’éradication de l’amiante des immeubles bâtis en France, il
semble plus raisonnable de prévoir 30 ans, donc rendez-vous en
2043.
Quant aux déchets amiantifères, en extrapolant les données de
l’ADEME, il faudra attendre 300 ans avant que l’amiante ait
totalement disparu des décharges mais aussi des terrains
naturels.
*Luc Baillet a participé à la commission AFNOR X46D entre
2000 et 2010, et notamment à la rédaction des normes sur les
diagnostics amiante (NFX 46-020, 021 et 023).
**En 1998, le conseil de l’ordre des architectes, avec
l’appui de la Région Nord Pas de Calais, organisait le premier
Colloque Régional sur l’Amiante.
En savoir plus
- Forum destiné à recenser les sites amiantifères et bâtiments amiantins
- Amiante, le BTP toujours mobilisé – OPPBTP, avril 2013