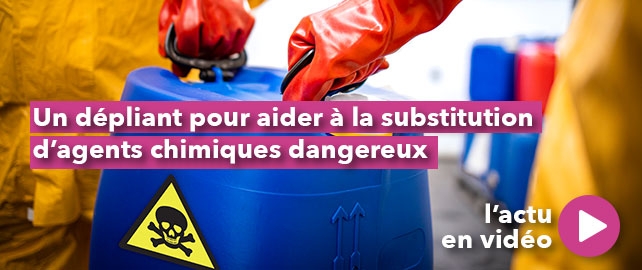Dans une nouvelle décision récente qui concernait l'exposition d'un salarié au benzène (Cass. Soc. 13 octobre 2021, n° 20-16584), la Cour de cassation confirme cette approche et rappelle les principes désormais applicables de manière pédagogique, au triple visa de l'obligation générale de sécurité, des principes généraux de prévention et du principe de responsabilité contractuelle en cas d’inexécution d’obligations contractuelles :
- Règle n° 1 > En application des règles de droit commun
régissant « l'obligation de sécurité » de l'employeur, le salarié
qui justifie d'une exposition à l'amiante ou à une autre
substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de
développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur
pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité ;
- Règle n° 2 > Le salarié doit justifier d'un préjudice
d'anxiété personnellement subi résultant d'un tel risque (réalité
et lien de causalité) ;
- Règle n° 3 > Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés.
La Cour vient toutefois modérer la portée de cette évolution
jurisprudentielle favorable aux travailleurs exposés, en se
montrant exigeante sur le terrain probatoire.
Elle considère ainsi que le seul établissement d'une attestation
d'exposition informant les salariés de la possibilité de mise en
place d'un suivi post-professionnel est insuffisant à
caractériser le préjudice d'anxiété personnellement subi et
résultant du risque élevé de développer une pathologie grave.
Une simple attestation d’exposition délivrée en vertu de
l’article D461-23 (ou du D461-25) du Code de la Sécurité sociale
ne suffit donc pas pour condamner l’employeur.
A tort dans cette affaire les juges ont donc condamné la société
à payer aux salariés une indemnité en réparation de leur
préjudice d'anxiété, au motif que la réalité de ce préjudice
d'anxiété serait la conséquence directe de l'appréciation de la
situation par les autorités médicales et sanitaires résultant de
l'établissement d'une attestation d'exposition à une substance
nocive et dangereuse évoquant un suivi post-professionnel (qui
reste facultatif pour l’assuré).
Dit autrement, il en faut plus pour justifier d'une inquiétude
permanente générée par le risque de déclaration à tout moment
d'une pathologie particulièrement grave pouvant être la cause
d’un décès.
Les faits concernaient ici l’exposition au benzène, intermédiaire
de synthèse qui présente un caractère de toxicité (substance
cancérogène avéré de catégorie 1, dont l’exposition est
susceptible d’entraîner des conséquences médicales variables
selon que l’intoxication est aigüe ou chronique, notamment par
inhalation ou contact cutané).
A noter que dans une décision du même jour, la Cour de cassation
reprend ces principes au sujet de l’amiante (Cass. Soc. 13
octobre 2021, n° 13-16585).
De son côté, la Cour d’appel de Douai avait, dans un arrêt du 29
janvier 2021 (nº 21/480), indemnisé le préjudice d’anxiété de
salariés mineurs, au titre de l'exposition à l'inhalation de
poussières d'amiante employé dans les cokeries et de silice, de
fumées et de gaz, de produits et de liquides toxiques (peintures
aux braies, huiles et trichloréthylène) générant un risque élevé
de développer une pathologie grave indépendamment de la durée
d'exposition.
Sur la question de l’exposition à des substances nocives ou
toxiques, rappelons que la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour
renforcer la prévention en santé au travail vient renforcer le
dispositif de prévention, en prévoyant notamment :
- L’obligation de répertorier dans le document unique
d’évaluation des risques professionnels l’ensemble des risques
professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et
d’assurer la traçabilité collective de ces expositions (C. Trav.,
L4121-3-1, I nouveau - application différée au 31 mars 2022)
;
- L’obligation de conservation du document unique d’évaluation
des risques professionnels dans ses versions successives, et de
tenue à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs
ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier d’un
intérêt à y avoir accès, pendant une durée minimum de 40 ans
(selon des modalités à définir, notamment en ce qui concerne la
future plateforme numérique nationale – C. Trav., L4121-3 V,
différé) ;
- Une obligation de prendre en compte les situations de
polyexpositions de toute nature pour définir les règles de
prévention des risques pour la santé et la sécurité des
travailleurs exposés à des risques chimiques (C. Trav., L4412-1
mod. – application différée au 31 mars 2022) ;
- Une extension de l’examen médical obligatoire par le médecin du travail prévu pour les travailleurs bénéficiant ou ayant bénéficié d'un suivi individuel renforcé (SIR) au titre de l'exposition à des risques particuliers avant leur départ à la retraite, au cas de la cessation d’exposition intervenant en cours de carrière, celui-ci devant alors intervenir dans les meilleurs délais (C. Trav., L4624-2-1 mod. – application différée au 31 mars 2022).
Autant de dispositions nouvelles qui viendront donc faciliter la
traçabilité des expositions, et potentiellement, alimenter ce
type de contentieux concernant les pathologies à effet
différé.
Plus que jamais, il sera essentiel pour les entreprises d’agir en
prévention primaire !