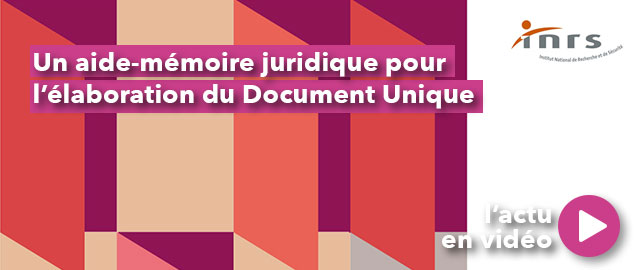Le Grand Paris Express c’est un ensemble de 200 km de lignes
nouvelles de métro et de RER, 68 gares en majorité sous terre et
une multitude de chantiers pour créer ce grand ensemble de réseau
de transport public parisien.
Loïc Thévenot, quelle est la particularité du Grand Paris
Express ?
Le Grand Paris Express est composé de plein de chantiers qui
compte chacun entre 750 et 1000 personnes. On y recense jusqu’à
20 tunneliers. C’est un chantier qui n’a pas d’équivalent dans le
monde. Il a commencé en 2017 et la première phase va s’achever
avec la partie sud de la ligne 15 fin 2021.
Comme sur tous les chantiers souterrains, nous travaillons dans
un univers qui est très différent. C’est contraint, il y a peu de
place. Il y a aussi des contraintes de ventilation, c’est un
milieu qui est souvent très hétérogène, pas forcément bien connu.
Et il y a aussi énormément de matériel, en termes de vigilance
c’est beaucoup plus contraignant que des travaux à l‘air.
Quels sont vos principaux axes de vigilance
?
Il y a quatre gros sujets aujourd’hui en matière de sécurité.
D’abord au niveau des heurts avec engin. Aujourd’hui nous
arrivons à équiper nos matériels avec des systèmes de détection,
nous mettons des caméras qui font de l’analyse d’image pour dire
à l’opérateur « attention là il y a un piéton », avec un signal
visuel. Ensuite, il y a l’éclairage. Avant nous avions des néons
qui éclairent moins bien, maintenant nous avons les LED qui
offrent un confort visuel plus grand.
Sur les chantiers qui utilisent la méthode traditionnelle – qui
ne mobilisent pas de tunneliers mais plutôt des explosifs – nous
faisons de plus en plus appel à des engins robotisés. Nous allons
de moins en moins dans la zone pas encore sécurisée, ce sont des
bras articulés ou engins téléguidés qui y vont.
Enfin, là où nous avons encore un peu de boulot c’est sur la
qualité de l’air. Il y a une bonne ventilation mais c’est vrai
qu’en méthode traditionnelle on peut avoir de la poussière. Il y
a aussi les gaz de tir. La règlementation abaisse les VLE -
valeur limite d'exposition professionnelle - en permanence, nous
sommes donc contraints d’évoluer.
Avec la Covid-19 et les mesures sanitaires, comment
avez-vous adapté vos pratiques ?
Nous nous conformons aux directives gouvernementales et aux
recommandations de l’OPPBTP. Nous avons mis en place tout un
système de distanciation. Mais sur les chantiers, les gens se
contaminent très peu, même en souterrain. Avec la ventilation, il
y a une circulation d’air en permanence. Pour éviter que les gens
soient tassés les uns contre les autres nous faisons des relèves
d’équipe en deux ou trois fois plutôt qu’une. Pour descendre au
fond des puits, nous avons de gros ascenseurs mais nous ne
mettons pas plus de quatre personnes, au lieu de 20, ce qui nous
prend plus de temps.
Nous avons désormais trouvé notre rythme de croisière et ces
mesures n’entrainent pas de baisse de productivité.
Pour conclure, remarquez-vous des différences concernant
la sécurité des chantiers souterrains entre vos débuts et
maintenant ?
Depuis 30 ans, nous avons fait de très gros progrès en matière de
sécurité. Lors de ma formation, le taux de fréquence était à 88,
il y avait un mort au kilomètre, un décès toutes les 450 000
heures de travail. Aujourd’hui, en 2020, le taux de fréquence est
inférieur à 5. Il se passe des millions d’heures sans le moindre
décès.
Nous sommes arrivés à creuser des tunnels sans que ça soit une
catastrophe. Nous avons tous été marqués par les accidents que
nous avons pu voir et nous sommes une génération d’ingénieurs qui
se dit « on ne peut plus voir ça ». Aujourd’hui nous sommes
fiers, même si ça reste un métier avec des conditions parfois
délicates.
Retour d’expérience : quelle sécurité sur un chantier souterrain comme le Grand Paris Express ?
Chantier souterrain colossal, sans équivalent dans le monde, le Grand Paris Express impressionne. Comment gérer la sécurité sur un chantier sous terre qui regroupe autant d’opérateurs ? Nous avons posé la question à Loïc Thévenot, directeur Grands Travaux Souterrains pour Eiffage Génie Civil en charge de ce grand chantier.

Loïc THÉVENOT
directeur Grands Travaux Souterrains (président du SPETSF)
Eiffage Génie Civil
- #Document Unique
- 24/03/2021