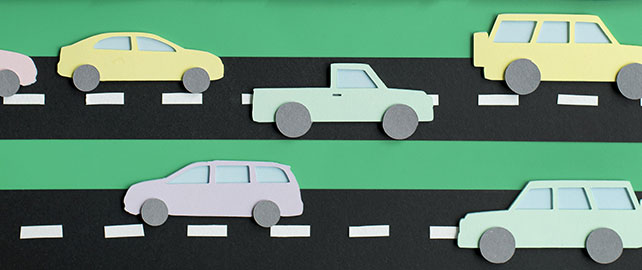Pour commencer, quelle définition peut-on donner de la
cybercriminalité ?
Du point de vue de la justice, la cybercriminalité englobe
plusieurs types d’infractions. D’une part, on trouve des
infractions strictement informatiques telles que le piratage
informatique, les attaques réseaux… D’autre part, on assiste à un
développement considérable des infractions classiques qui sont
démultipliées via les réseaux numériques, par exemple les
escroqueries en bande organisée commises par internet, ou
l’usurpation d’identité.
Quels sont les chiffres de la cybercriminalité
aujourd’hui ?
Une certitude, ces chiffres explosent ! Diffamation en
ligne, vols d’éléments immatériels, atteinte à l’e-réputation,
cybercontrefaçon … les plaintes des entreprises se
multiplient.
Néanmoins, nous avons des difficultés à établir des statistiques
précises des faits de cybercriminalité. En effet, en matière de
justice, les infractions telles que l’escroquerie ou l’usurpation
d’identité utilisant les outils numériques ne sont pas
comptabilisées en tant que faits cybercriminels. Un important
chantier est en cours pour mettre en place de nouveaux outils
permettant de mieux évaluer ces phénomènes et d’améliorer leur
traitement judiciaire.
En France, quels moyens ont été mis en place pour lutter
contre les cybercriminels ?
En France, de nombreuses structures institutionnelles, telles que
les services d'enquête spécialisés, tant au niveau police que
gendarmerie, ou l'OCLCTIC (Office Central de Lutte
contre les infractions liées aux technologies de l'information et
de la communication), la CNIL (Commission Nationale
Informatique et Libertés), l’ARJEL (Autorité de
Régulation des jeux en Ligne), sont impliquées dans ces
domaines.
Dans le domaine de la justice, nous n’avons pas encore de
service officiellement spécialisé dans la cybercriminalité.
La cyberdélinquance est une matière en évolution constante et
très rapide, et nous nous devons de mettre en place des
structures très réactives et spécialisées.
Une justice nationale luttant contre une criminalité
mondiale, n’y a-t-il pas là aussi des limites ?
Tout à fait. C’est un obstacle majeur. En effet, le droit pénal
relève de la souveraineté étatique. Mais la cybercriminalité,
elle, n’a pas de frontières.
Seule une quarantaine de pays a adhéré à la Convention de
Budapest du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité en 2001.
Cette convention a défini pour principal objectif de
« créer un cadre législatif commun destiné à
protéger la société contre la cybercriminalité, notamment par
l'adoption d'une législation appropriée et la stimulation de la
coopération internationale ».
Au niveau européen, nous avons établi des passerelles. Des
directives récentes permettent de renforcer la coopération entre
les forces de justice et de mutualiser les actions.
Ainsi, en janvier 2013, un centre de lutte contre la
cybercriminalité directement rattaché à Europol a été créé.
Mais il y a encore beaucoup à faire pour endiguer et mieux lutter
contre ces nouvelles formes de délinquance.
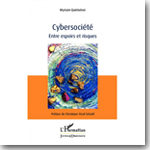 En savoir
plus
En savoir
plus
- Cybersociété, entre espoirs et risques par Myriam Quémener – Editions l’Harmattan, octobre 2013
- Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité – Budapest, décembre 2001