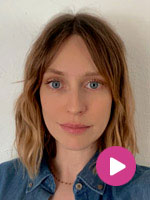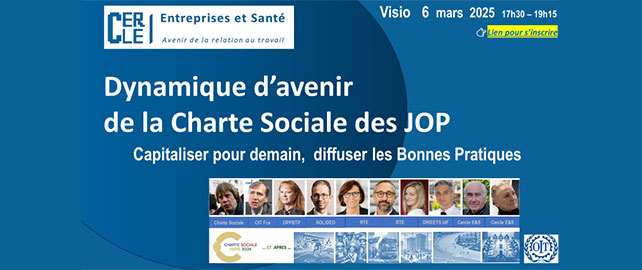Comment est née l’idée de cet exercice de prospective
?
En 2016, nous avions mené un premier exercice de prospective sur
le futur du travail en 2040 et ses implications en termes de
santé et sécurité au travail. Dans le cadre de ce premier
travail, la question de la plateformisation du travail avait
émergé comme l’un des bouleversements majeurs des années à
venir.
L’exercice que nous venons de mener avec de nombreux partenaires
tels que l’Anact, la CNAM, l’OPPBTP, le CREDOC, le CJD nous a
permis de construire différents scénarios sur les évolutions
possibles du travail via des plateformes et d’évaluer leurs
conséquences en termes de santé et sécurité.
Un focus sectoriel a également été réalisé sur trois secteurs
d’activités : le commerce de détail, le second œuvre du bâtiment
et la santé.
Quelles sont les caractéristiques spécifiques du travail
plateformisé qui impactent la prévention ?
Les plateformes déploient des formes d’organisations qui
échappent complètement au cadre classique du travail. Il devient
donc très difficile d’appliquer les principes généraux de
prévention. Par exemple, certaines plateformes d’intermédiation
ne s’appuient que sur des travailleurs indépendants. Il n’y a
donc plus de relation employeur / salariés. Le levier
réglementaire sur lequel s’appuie notamment la prévention
(obligation de sécurité de résultat) devient inopérant, le levier
incitatif via les taux de cotisation AT-MP également.
Par conséquent, intégrer la prévention dans le cadre du travail
relève essentiellement de la bonne volonté des plateformes.
Quels effets de la plateformisation du travail sur la
santé avez-vous identifiés ?
Ce mode de travail est potentiellement générateur de risques.
L’intensification du travail, la faible autonomie laissée aux
opérateurs, l’absence de collectif social et l’insécurité des
situations de travail sont autant de facteurs engendrant des
risques psychosociaux et propices à la survenue d’accidents.
Mais nous avons aussi identifié des aspects potentiellement
positifs. Dans le second œuvre du bâtiment, par exemple, les
plateformes pourraient contribuer à l’amélioration des conditions
de travail des artisans. En effet, en prenant en charge tous les
aspects administratifs, elles leur permettent de se concentrer
sur leur cœur de métier. Les plateformes peuvent également
favoriser et mutualiser les achats d’équipements de protection
individuelle et d’outils ergonomiques.
Quelles recommandations émettez-vous à la suite de cet
exercice ?
La concurrence entre ces plateformes est de plus en plus
exacerbée et la fidélisation des travailleurs indépendants va
devenir un enjeu majeur dans les années à venir pour garantir des
prestations de qualité. Les engagements en termes de protection
de la santé des travailleurs pourraient alors devenir un
atout pour les attirer et les fidéliser.
Après s’être focalisées sur l’expérience client, nous les
invitons à davantage s’intéresser à l’expérience travailleur.
Nous devons anticiper les conséquences de l’ubérisation sur la santé et la sécurité au travail
L’INRS a conduit un exercice de prospective sur la plateformisation du travail visant à évaluer les impacts potentiels de ces nouvelles formes d’organisation sur la santé et la sécurité au travail à horizon 2027.Zoom sur les principaux enseignements de cette étude.

Marc MALENFER
Responsable de la mission Veille et Prospective
- #Politique & Prospective SST
- 22/02/2018