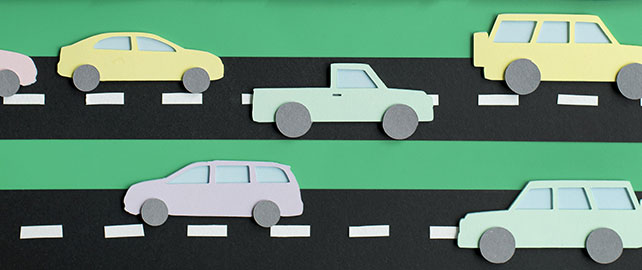Tout d’abord, très simplement, pouvez-vous nous donner
votre définition d’une crise ?
Il faut bien séparer les notions d’urgence et de crise. Une
urgence est un problème immédiat et bien spécifique pour lequel
nous avons le mode d’emploi. Il suffira d’une intervention rapide
et compétente pour traiter l’urgence.
Le cœur de la crise c’est la destruction des références, il n’y a
plus de mode d’emploi… Et les crises du 21e siècle sont très
différentes de celles des années 80/90 qui étaient dans la lignée
de l’urgence – un événement qui déclenchait des effets
dominos. En réponse, on a pu construire des méthodes bien rodées,
combinant organisation, coordination, communication.
Désormais, nos crises prennent place dans un milieu lui-même
hautement volatil : interactions globales entre réseaux,
contaminations foudroyantes en raison d’interdépendances très
serrées, et surtout, perte de consistance des fondamentaux, des
socles, des armatures. Les crises sont moins liées à des
événements qu’aux propriétés mal connues des milieux
pulvérulents, qui appellent d’autres logiques de pilotage.
D’où vient la difficulté à gérer ces crises d’un genre
nouveau ?
Nous sommes confrontés à des défis inédits dans leur acuité et
leur fréquence : montée aux extrêmes, vitesse, inconnu,
hypercomplexité, « inconcevable »… Et surtout au fait
que les milieux où se développent les crises sont immédiatement
des caisses d’amplification explosive, et non plus des terrains
tout de même absorbants. Ces dynamiques sont « hors
dimensionnement ». Elles ne sont pas dans nos hypothèses
fondamentales de référence – événements relativement limités
en gravité, indépendants, rares, dans des contextes globalement
stables. Nous sommes appelés ici à faire œuvre d’invention. Car
si l’on se trompe de cosmologie, comme dirait Sun Tsu,
« nous serons défaits à chaque bataille ».
Quelle stratégie de gestion de crise adopter dans ce
contexte ?
Il nous faut tolérer un basculement dans les visions : non
plus avoir des plans pour ne pas être surpris, mais apprendre à
être surpris ; non plus prévoir l’imprévisible, mais se
préparer à y faire face ; non plus avoir toutes les
réponses, mais être capables de forger des réponses dans
l’inconnu et le mutant.
Sur le terrain, cela veut dire : l’implication forte des
dirigeants, car ce sont des défis vitaux, et non plus accidentels
à la marge ; l’implication des tissus sociétaux, à tous les
niveaux, car ce sont des tissus qui doivent pouvoir répondre,
loin des logiques top-down ; une autre préparation des
experts ; des préparations et des enseignements autrement
moins anecdotiques, tactiques, répétitifs qu’actuellement.
Il y avait un peu de tout cela dans la réponse américaine à
l’ouragan Sandy, autrement mieux approché que Katrina. Reste à
accepter de mettre ces nouveaux horizons à notre agenda
– avant qu’ils ne s’y inscrivent de la façon la plus
brutale. Et à y travailler de façon créative, pour inventer de
nouveaux repères, loin de tout repli Maginot.
Vous prônez, en situation de crise, la mise en œuvre
d’une « Force de Réflexion Rapide », de quoi s’agit-il
exactement ?
Fondamentalement, face à ces crises qui sortent des territoires
connus, il faut basculer d’une logique de réponse à une logique
de questionnement, d’une logique d’application de scripts et de
procédures déjà fixées à l’invention de nouvelles initiatives
d’action. C’est ce à quoi répondent la méthode et la pratique de
« Force de Réflexion Rapide ». Concrètement, il s’agit
d’un groupe de personnes venant d’horizons divers, entraînées, et
qui – en continu, et a fortiori en début de crise – vont
travailler autour sur quatre lignes d’interrogation : De quoi
s’agit-il ? Quels sont les pièges éviter ? Quels
sont les acteurs ? Quelles initiatives injecter ? Il
s’agit autant d’un think-tank que d’un appui opérationnel direct.
Pareil appui, bien entendu entraîné au préalable, est en mesure
d’apporter du sens, de la protection contre des réflexes
aggravants, des marges de liberté, et plus encore des débuts de
réponses qui pourront contribuer à une stabilisation immédiate et
à l’invention de futur qui est le défi crucial des crises
d’aujourd’hui.
Les retours d’expérience soulignent clairement l’importance cruciale de deux axes d’entrée :
- la capacité du leadership à ne pas être tétanisé et à jouer effectivement sa partition (ce qui suppose que les dirigeants se soient effectivement impliqués sur ces terrains avant l’épreuve) ;
- l’aptitude à injecter de la confiance du haut en bas de la chaîne pour permettre et susciter une créativité collective à la mesure des défis à traverser.
En savoir plus
- Risques : les dirigeants doivent passer du déni à la stratégie – Contribution de Patrick Lagadec au Cercle Les Echos
-
Du risque majeur aux mégachocs, Editions
Préventique, Collection Les Cahiers de Préventique, septembre
2012, 224 pages - Version numérique, augmentée, janvier 2013,
382 pages
- Articles de Patrick Lagadec pour la revue
Préventique :
-
Pilotage des crises
– Feuille de route pour les dirigeants
- Le citoyen dans les crises - Nouvelles donnes, nouvelles pistes
-
L'ouragan Sandy -
Éléments et questions pour un retour d'expérience
- Aide au pilotage des crises - La force de réflexion rapide
-
Pilotage des crises
– Feuille de route pour les dirigeants