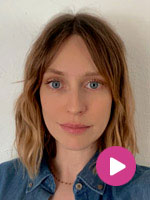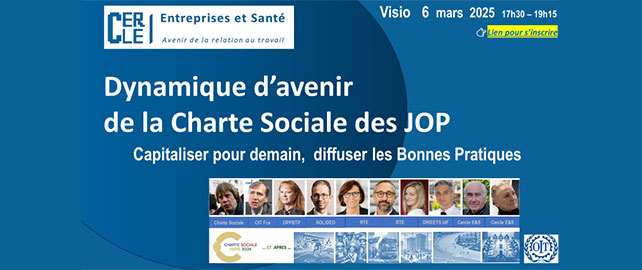Comment la notion de Qualité de Vie au Travail peut –elle
faire sens dans le cadre de projets de réorganisation
?
Engager une démarche de Qualité de Vie au Travail, c’est engager
des actions qui vont contribuer à la fois à la performance et à
l’amélioration des conditions de travail. Ça ne se limite pas à
proposer une table de ping-pong ou des massages aux salariés.
C’est agir, en concertant avec les salariés, sur le contenu du
travail, l’organisation, les conditions de sécurité, la
conciliation avec la vie privée, les possibilités de
développement professionnel, etc. Dès lors qu’un projet de
réorganisation, ou de prévention, apporte des changements sur ces
éléments, alors la démarche QVT est possible.
Au-delà d’une « terminologie » qui permettrait de
positiver la prévention des risques psychosociaux, la QVT
est donc une approche globale et encadrée qui a été définie dans
l’ANI de 2013, promue dans le plan Santé au travail 2016-2020 et
qui est, depuis la loi Rebsamen, un objet de négociation.
Pour simplifier, travailler dans une optique QVT, c’est réfléchir
aux conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail
et ouvrir un dialogue participatif sur le sujet. A partir de là,
le bénéfice de la QVT sur un projet de réorganisation est
évident.
Quels sont les fondements méthodologiques de cette
approche ?
Pour nous, un projet QVT doit s’inscrire dans un cadre de
référence reposant sur 3 piliers.
Le premier pilier est le décloisonnement : le groupe de projet
doit rassembler des interlocuteurs issus des différents domaines
clés de l’entreprise (RH, Qualité, Santé-Sécurité au Travail,
Management) et assurer une cohérence entre ces différents
domaines, quel que soit le type de projet.
Ensuite, on doit introduire dans la conduite de projet la
participation des salariés concernés bien sûr mais également
l’expérimentation continue. L’idée est de travailler dans une
optique de co-construction et d’amélioration continue, avec une
logique d’évaluation permanente et de retour en arrière possible.
La finalité étant de parvenir au modèle d’organisation le plus
optimal, en termes de conditions de travail pour les salariés et
de performance pour l’entreprise.
Enfin, travailler sur un projet QVT permet de dépasser le cadre
réglementaire pour aller vers un cadre négocié. Dans la
négociation avec les partenaires sociaux, une fois que les
discussions réglementaires portant sur le temps de travail, la
formation ou la sécurité au travail parmi d’autres sont abouties,
on va pouvoir aller plus loin dans un cadre négocié plus souple
pour l’ensemble des partenaires du dialogue social.
Pouvez-vous nous donner un exemple d’intervention dans
lequel l’approche QVT a donné une valeur ajoutée ?
Nous sommes intervenus récemment dans un service déconcentré de
l’Etat sur une problématique double. Il s’agissait d’une part de
travailler sur le réaménagement architectural d’un service et
d’autre part d’agir pour tenter de régler des tensions fortes
entre les salariés et l’équipe dirigeante. Lors de la phase de
diagnostic, nous avons identifié que les problèmes de stress et
de charge de travail étaient étroitement liés à des
dysfonctionnements dans les process et la conduite des projets.
Nous avons donc proposé d’aborder le sujet du réaménagement
architectural en travaillant de manière plus globale sur
l’organisation du travail et surtout en y associant les
salariés. Ce travail participatif a permis de dégager un
plan d’actions portant aussi bien sur l’amélioration des
conditions de travail et la prévention des RPS, que sur la
conduite de projet, l’animation d’équipe, le contenu du travail,
dans une optique de performance globale et de qualité de
service.
En savoir plus
- Venez échanger avec Marion BRUNET & Gilles STAQUET lors de leur conférence « QVT : mythe ou réalité ? Pourquoi et comment la QVT contribue à la performance globale des organisations » le mercredi 21 juin à Préventica Paris