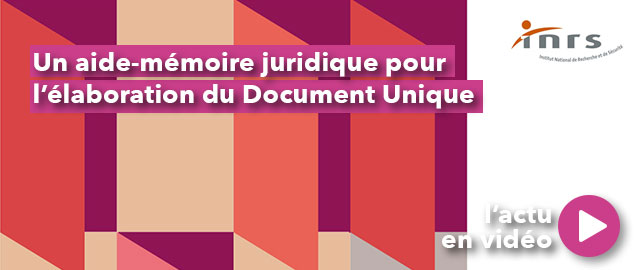Saisie suite à l’action en justice d’un CHSCT, elle retient en synthèse l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent, découlant du non-respect persistant par l’employeur de son obligation de sécurité.
Cette décision doit être analysée au regard du fait que les évènements se sont étalés sur près de 3 ans, dans le cadre d’un projet de licenciement collectif accompagné d’une harmonisation des systèmes d'information et des organisations commerciales, via le développement de nouveaux outils informatiques.
Sur cette période, la mise en œuvre expérimentale du projet sur une région pilote s’était heurtée à une succession d’écueils : la validation judiciaire d’une expertise CHSCT motivée par un risque grave et actuel constaté au sein de l’établissement ; les conclusions d’expertise faisant état d’une situation psychosociale alarmante en lien avec un modèle organisationnel jugé « pathogène » et déstabilisant (situation de perpétuel changement) ; l’exercice d’un droit de retrait par plusieurs salariés refusant d'utiliser le logiciel ; la survenance d’arrêts maladie ; le constat par l’Inspecteur du travail d’une existence avérée de risques psycho-sociaux liés au projet et la demande à la direction d’en faire une étude d'impact, suivie d’une mise en demeure de prendre des mesures de protection conformément aux principes généraux de prévention.
Au fil de ces évènements, la direction prendra des mesures correctrices, mais qui seront jugées insuffisantes.
En appel, les juges retiennent qu’« en application de l'article L4121-1 du Code du travail, lui-même interprété à la lumière de la directive CEE n° 89-391 du 12 juin 1989 tendant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs, l'employeur est tenu, à l'égard de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il est interdit à l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. (…) »
Au regard des éléments persistants de risques psycho-sociaux relevés, la société se voit interdire de déployer les nouveaux outils informatiques sur les autres régions, dans l’attente du bilan des mesures mises en oeuvre par l’employeur sur les sites de la région pilote à la suite de la mise en demeure administrative.
L’entreprise ayant donné des gages de bonne volonté, le CHSCT est débouté de sa demande de la voir condamnée à une astreinte de 10 000 euros par jour de retard dans l’exécution de la décision.
1. Une solution classique depuis 2008
Cet arrêt s’inscrit dans une longue lignée de décisions depuis la célèbre affaire SNECMA, qui a initié ce courant jurisprudentiel (cf. Cass. Soc. 5 mars 2008, n° 06-45888 : rappelons que dans cette affaire, l’entreprise avait mis en œuvre une réorganisation de ses activités de maintenance et de surveillance d’un établissement classé SEVESO, dont il a été jugé qu’elle réduisait le nombre des salariés assurant le service et entraînait un isolement augmentant les risques liés au travail dans l’installation, aggravé par une insuffisance du dispositif d’assistance pour garantir la sécurité des salariés. Les juges ont ordonné la suspension de cette organisation, jugée de nature à compromettre la santé et la sécurité des travailleurs concernés).
L’attendu de principe, était radical : « Mais attendu que l’employeur est tenu, à l’égard de son personnel, d’une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; qu’il lui est interdit, dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés ».
Depuis, c’est surtout la question des risques psychosociaux générés par la réorganisation qui a alimenté ce contentieux collectif (essentiellement devant les juridictions du fond d’ailleurs, car le temps judiciaire n’est pas celui de l’entreprise, et le plus souvent, les effets de la réorganisation sont très largement corrigés en cours d’instance).
Dans ce cadre, l’utilisation de nouveaux outils, voire de nouvelles technologies, est souvent mise en avant en tant que facteur de risques.
Typiquement, le contentieux dans ce domaine porte sur la question de la soumission à la procédure d’information-consultation obligatoire du CHSCT (exemple pour le passage de la 3G à la 4G : CA Versailles 5 août 2013, n° 13-05861), ou encore sur celle du droit du CHSCT de recourir à un expert agréé.
En soi toutefois, il est important de préciser que l’introduction d’un nouveau logiciel n’est pas nécessairement de nature à constituer un « projet important » modifiant les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail et à justifier l’intervention d’un expert (cf. Cass. Soc. 8 février 2012, n° 10-20376).
Tout est affaire de cas par cas.
Dans la présente affaire soumise à la Cour d’appel de Versailles, l’un des éléments retenus pour caractériser la violation de l’obligation de sécurité résidait dans la mise en demeure de l’Inspection du travail, constatant la non-conformité des nouveaux logiciels au regard des exigences de l'article R4542-5 du code du travail.
Ce texte, noyé dans la jungle réglementaire du Code du travail, dispose en effet que « Pour l'élaboration, le choix, l'achat et la modification de logiciels ainsi que pour la définition des tâches impliquant l'utilisation d'écrans de visualisation, l'employeur prend en compte les facteurs suivants, dans la mesure où les exigences ou les caractéristiques intrinsèques de la tâche ne s'y opposent pas :
- Le logiciel est adapté à la tâche à exécuter ;
- Le logiciel est d'un usage facile et est adapté au niveau de connaissance et d'expérience de l'utilisateur ;
- Les systèmes fournissent aux travailleurs des indications sur leur déroulement ;
- Les systèmes affichent l'information dans un format et à un rythme adaptés aux opérateurs ;
- Les principes d'ergonomie sont appliqués en particulier au traitement de l'information par l'homme. »
En l’espèce, les logiciels présentaient de nombreux dysfonctionnements pénalisant les salariés.
La sanction est lourde : l’employeur se voit interdire d’en poursuivre le déploiement national sur l’ensemble de ses établissements.
Cela conduit donc à considérer qu’un outil technologique, même neutre en apparence, est susceptible d’avoir des impacts en matière de conditions de travail, éventuellement diffus et différés, ce qu’il faut dès lors évaluer systématiquement afin de prévoir, si nécessaire, des mesures d’accompagnement du changement et de prévention.
L’impréparation dans ce domaine peut venir fâcheusement remettre en cause le bon déroulement du projet.
2. En l’espèce : une application au cas particulier d’un plan de réorganisation avec suppressions d’emplois
Cette affaire contribue au passage à clarifier la question de la juridiction compétente pour apprécier l’existence d’un éventuel manquement de l’employeur à son obligation générale de sécurité, lorsque le projet de réorganisation est adossé à un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).
Depuis la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, les décisions prises par l'administration au titre de la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation du PSE (C. Trav., L1235-7-1). Conséquence, les litiges dans ce domaine relèvent de la compétence exclusive du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
Cette compétence réservée est-elle de nature à écarter toute possibilité d’intervention pour le juge judiciaire ?
La réponse de la Cour d’appel de Versailles est négative.
Dans une précédente décision, elle avait déjà admis que l’homologation du contenu du PSE et de la procédure ne préjuge pas du respect de l’obligation de sécurité (cf. CA Versailles, 1er décembre 2015, n° 15/01203).
Elle réitère ici sa position, considérant qu’au regard des pouvoirs dont dispose l'autorité administrative et de l'objet de la demande de validation ou d’homologation, son contrôle est limité à la vérification du contenu de l'accord ou du document unilatéral au regard des dispositions régissant son objet, du respect des procédures de consultations des institutions représentatives, de l'existence d'un plan de reclassement et des modalités de suivi de la mise en oeuvre effectives des mesures contenues dans ce plan et, le cas échéant, des obligations de recherche d'un repreneur.
A contrario, il n'appartient pas à l'autorité administrative de contrôler les conséquences du PSE sur la santé et la sécurité des salariés, ce qui dès lors ouvre la possibilité de saisir le juge judiciaire sur ce terrain.
(A noter que l’on retrouve une dualité de compétences comparable s’agissant du contentieux de l’indemnisation des ATMP, pour lequel la jurisprudence considère qu’en présence d’une demande visant à tirer les conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle -peu important que cela soit lié ou non à un manquement à l’obligation de sécurité-, seul le Tribunal des affaires de la sécurité sociale est compétent, à l’exclusion du Conseil de prud’hommes.)
Reste à attendre une confirmation par le Conseil d’Etat (sachant que dans un registre parallèle, celui-ci a jugé que la vérification par l’autorité administrative de la régularité de la procédure d’élaboration du PSE peut nécessiter de vérifier la régularité de celle du CHSCT, notamment sur le point de savoir si l’instance a reçu toutes les informations nécessaires pour lui permettre d’exercer utilement sa compétence et de rendre un avis notamment au regard des RPS – cf. CE 29 juin 2016, n° 365581).
3. Une occasion pour la Chambre sociale de la Cour de cassation de préciser sa jurisprudence sur l’obligation de sécurité ?
L’arrêt du 18 janvier 2018 mentionne expressément l’obligation de sécurité « de résultat ».
Cette affaire illustre le fait que l’obligation de sécurité de résultat demeure une référence tenace devant les juridictions du fond.
De son côté, la Chambre sociale de la Cour de cassation a fait évolué sa jurisprudence depuis 2015 avec l’arrêt Air France, et encore très récemment, en s’appuyant sur la notion d’obligation de prévention (cf. https://www.preventica.com/actu-chronique-obligation-securite-prevention-risques-professionnels.php ).
La Chambre sociale ayant vocation à connaître aussi de ce type de contentieux collectif, il faut s’attendre, si elle est saisie, à ce qu’elle puisse profiter de cette occasion pour clarifier sa position sur la portée générale de l’obligation de sécurité entendue ou non comme une obligation de résultat, et dans ce prolongement, de livrer des indices utiles pour guider l’analyse concernant l’appréciation des manquements dans ce contentieux spécifique des réorganisations.
On sait qu’en matière de risques psychosociaux, les mesures de prévention secondaire ne peuvent suffire, et qu’il faut avant tout travailler en amont, sur la prévention primaire.
Cela étant, une réorganisation étant par définition complexe, sa mise en œuvre peut nécessiter des ajustements au fil de l’eau, ce qui mérite de tenir compte des diligences mises en œuvre par l’employeur (cf. chronologie, investissements, pertinence et consistance, conformité aux principes généraux de prévention, etc.) en vue d’améliorer les situations de travail.
En l’espèce, il a été constaté une persistance des facteurs de risques psycho-sociaux (ce qui relève d’une appréciation souveraine des faits par les juges du fond), en dépit de ces mesures de prévention mises en oeuvre par l’employeur tout au long du processus, et notamment en cours d’instance devant les juridictions.
Faut-il pour autant atteindre un résultat donné, c’est-à-dire une éradication des facteurs de risques, pour autoriser l’employeur à reprendre le déploiement de ses mesures ?
Sans doute serait-il bon ici d’éviter les amalgames –fréquents-, entre risque psychosocial et risque grave (pas d’automaticité), afin de ne pas paralyser de manière excessive et disproportionnée des projets qui peuvent être vitaux pour l’avenir de l’entreprise.
Eu égard aux enjeux pour les entreprises, les précisions de la Cour de cassation seront particulièrement bienvenues et utiles.
4. Quelles perspectives de contentieux des réorganisations avec le nouveau CSE ?
L’approche des réorganisations va être nécessairement impactée par la fusion des instances représentatives élues au sein du Comité social et économique (CSE), au plus tard le 1er janvier 2020 selon le calendrier électoral de chaque entreprise.
La mise en œuvre de projets complexes sera allégée, et plus sécurisée, du fait de la disparition du CHSCT (ainsi que de l’instance de coordination facultative), acteur devenu incontournable dans ce domaine.
Le découpage de l’entreprise en établissements distincts aura également une incidence majeure sur la complexité des opérations en termes d’articulation des procédures consultatives selon les niveaux (établissements vs/ central).
Pour le reste, le CSE conservera les grandes attributions dévolues aux instances actuelles en matière de consultations ponctuelles obligatoires (cf. notamment : aménagement important modifiant les conditions de travail ; introduction de nouvelles technologies, licenciement collectif économique).
Un accord d’entreprise, conclu « à froid » ou « à chaud », pourra toutefois venir en adapter les modalités (cf. nombre de réunions, délais).
Lorsqu’elle(s) existe(ront) la/les Commissions de santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) pourront être éventuellement associées à la préparation des travaux, mais sans toutefois pouvoir se voir déléguer par l’instance plénière la restitution d’avis ou le recours à une expertise.
Sur le plan légal, des changements significatifs sont prévus en revanche concernant les modalités du recours aux expertises (baptisées ici « qualité de travail et emploi » (C. Trav., L2315-96), sans doute pour leur donner un relief plus consensuel … ), et notamment le séquençage des opérations et contestations.
A noter que la réforme a mis fin à la difficulté lancinante que représentait l’absence de budget du CHSCT : le CSE, instance unique, sera quant à lui doté d’un budget pour son fonctionnement (revalorisé à 0,22% de la masse salariale brute pour les entreprises de plus de 2 000 salariés). Cela devrait conduire à une évolution des solutions existantes au sujet de l’obligation pour l’employeur de prendre en charge des frais de justice de l’instance notamment lorsqu’elle perd son procès (cf. Cass. Soc. 21 juin 2017, n° 15-27506) …
Derrières ces ajustements techniques, c’est surtout la question des postures, tant côté managérial que des représentants du personnel, qui sera déterminante.
Tout l’enjeu avec cette nouvelle instance sera de permettre l’émergence d’un dialogue social constructif et qualitatif, ce qui semble particulièrement bienvenu pour la conduite des projets de réorganisation.