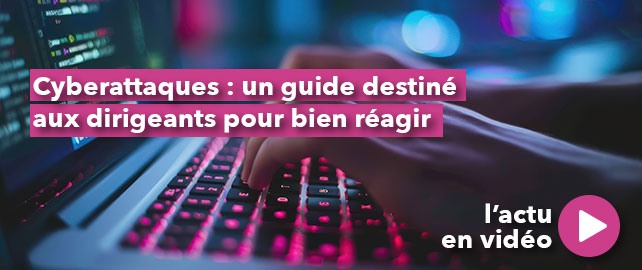Dans cette chronique, nous avions précédemment abordé la mise en place fragmentaire en 2013 d’un cadre juridique de protection des lanceurs d’alerte (cf. Le droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement : quelles conséquences pour les entreprises ? ; La protection des lanceurs d’alerte en cas d’infraction en entreprise).
Dans le contexte des affaires médiatiques liées aux révélations (leaks) de ces derniers mois, la question du lanceur d’alerte est à nouveau au cœur d’une actualité multiple au plan juridique :
- Jurisprudentielle tout d’abord, avec une importante décision
de la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. Soc. 30 juin
2016, n° 15-10557, FS-P+B+R+I, arrêté appelé à figurer au rapport
annuel de la Cour de cassation pour 2016), rendue dans une
affaire concernant un salarié, directeur administratif et
financier d’une association, licencié pour faute lourde pour
avoir dénoncé auprès du Procureur de la République le recours à
un emploi fictif.
Précisons que les faits étaient antérieurs à la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, en sorte qu’il n’existait pas de fondement textuel spécifique prévoyant une protection pour le salarié auteur d’une telle dénonciation.
La solution a donc été trouvée en référence au droit international :
- Premier temps, la cour rappelle un principe déjà
posé précédemment : « le fait pour un
salarié de porter à la connaissance du procureur de la
République des faits concernant l’entreprise qui lui
paraissent anormaux, qu’ils soient ou non susceptibles de
qualification pénale, ne constitue pas en soi une
faute » (cf. Cass. Soc. 29 septembre 2010, n°
09-41543).
Point important du point de vue de l’appréciation de la bonne foi du salarié, il suffit que les faits soient « susceptibles » de recevoir une qualification pénale, sans exiger qu’ils donnent lieu à un engagement de poursuites ou à condamnation effective (la Cour se montre ainsi moins restrictive que l’article L1132-3-3 du Code du travail qui exige que en matière de dénonciation de corruption que les faits soient effectivement constitutifs d’un délit ou d’un crime).
Dans son communiqué de presse, la Cour précise même qu’« une telle décision est de nature à protéger les lanceurs d’alerte, dans la mesure où, par ailleurs, la chambre sociale instaure cette immunité non seulement lorsque les faits illicites sont portés à la connaissance du procureur de la République mais également, de façon plus générale, dès lors qu’ils sont dénoncés à des tiers ». - Deuxième temps, elle ajoute en référence à la liberté d’expression que « vu l’article 10 § 1 de la de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu’en raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté d’expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d’un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est frappé de nullité ».
En définitive, elle casse l’arrêt de la Cour d’appel et rejette l’argument tiré de l’adage classique « pas de nullité sans texte », considérant que le licenciement du salarié aurait dû être annulé, pour violation d’une liberté fondamentale du salarié « citoyen au travail ».
Ce n’est pas la première fois que la jurisprudence fait jouer le régime de la nullité du licenciement lorsqu’est porté atteinte à une liberté fondamentale (cf. sur la liberté fondamentale de témoigner garantie d’une bonne justice – Cass. Soc. 29 octobre 2013, n° 12-22447 ; de saisir l’Inspecteur du travail – Cass. Soc. 14 mars 2000, n° 97-43268 ; d’exercer son droit de retrait – Cass. Soc. 25 novembre 2015, n° 14-21272 ; ou encore en cas de pressions constitutives de harcèlement moral – CPH Paris 5 mars 2015).
Au-delà de ces principes, la question de la bonne foi du salarié est tout-à-fait centrale.
La dénonciation peut constituer un abus d’usage de la liberté d’expression, en raison de propos ou d’écrits présentant un caractère excessif, injurieux, diffamatoire ou calomnieux. L’inexactitude des faits, le mode de publicité utilisé ou l’impossibilité pour le salarié d’étayer ses allégations par exemple constituent autant d’éléments à charge de nature à justifier une mesure disciplinaire, voire l’engagement de sa responsabilité civile et/ou pénale.
Tout est donc affaire de cas par cas et d’appréciation, ce qui peut certainement être un élément de nature à dissuader le lancement d’alertes à la légère.
Pour son auteur, l’alerte s’exerce donc « à ses risques et périls » (cf. p. ex. Cass. Soc. 3 décembre 2014, n° 13-20501).
Cela vient d’être illustré dans un récent arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH 21 juin 2016, req. n° 79972/12, Soares/ Portugal), considérant que le fait pour un agent public de signaler un détournement de fonds publics par son supérieur hiérarchique sur la base d’une simple rumeur justifie une condamnation pénale pour diffamation aggravée, sans constituer une violation de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Eu égard à l’absence de bonne foi de l’agent (l’enquête n’ayant pas pu établir l’existence même de cette rumeur) et à l’atteinte à la réputation de la personne mise en cause, la sanction est considérée comme non disproportionnée.
- Premier temps, la cour rappelle un principe déjà
posé précédemment : « le fait pour un
salarié de porter à la connaissance du procureur de la
République des faits concernant l’entreprise qui lui
paraissent anormaux, qu’ils soient ou non susceptibles de
qualification pénale, ne constitue pas en soi une
faute » (cf. Cass. Soc. 29 septembre 2010, n°
09-41543).
-
Hasard du calendrier, ces décisions interviennent dans un contexte de discussions parlementaires autour du projet de loi Sapin II, relatif à la prévention de la fraude, la transparence et la modernisation de la vie économique, actuellement en cours de discussions.
Dans la version adoptée le 14 juin 2016 en 1ere lecture par l’Assemblée nationale,il est prévu notamment d’étendre le champ de la protection des lanceurs d’alerte dans un cadre plus général que celui mis en place par la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013.
Cela passe d’abord par une définition du lanceur d’alerte. Dans le cadre de sa version présentée au 22 juin 2016, un lanceur d'alerte serait « une personne physique qui signale, dans l'intérêt général, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime, un délit ou une violation grave et manifeste de la loi ou du règlement dont il a eu personnellement connaissance » (cf. art. 6A).
Il est tout de suite précisé qu’« une personne faisant un signalement abusif engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 226-10 du code pénal et de l'article 1382 du code civil ».
Une procédure est envisagée pour le traitement des alertes dites « éthiques », en interne à l’entreprise, avec une obligation de signaler l’alerte, par ordre de priorité :
-
au supérieur hiérarchique ;
-
à défaut, à une « personne de confiance » désignée par l’employeur ;
-
à défaut, à l'autorité judiciaire, à l'autorité administrative ou aux ordres professionnels ;
-
en dernier recours (en cas d’inertie pendant 3 mois), la possibilité d’une divulgation publique de l’alerte (limitée au cas de danger grave et imminent ou en présence d'un risque de dommages irréversibles).
Le respect de cette procédure de signalement serait un des éléments constitutifs de la bonne foi, avec toutefois une sérieuse marge d’interprétation possible pour le juge en cas de divulgation publique, qui serait déterminée au regard de 4 critères :
-
l'intérêt prépondérant du public à connaître de cette information ;
-
le caractère authentique de l'information ;
-
les risques de dommages causés par sa publicité ;
-
la motivation de la personne révélant l'information.
Le projet de loi ajoute entre autres que toute personne pourrait adresser son signalement au Défenseur des droits afin d'être orientée vers l'organisme approprié de recueil de l'alerte.
Un dispositif est également prévu afin de garantir au niveau des procédures et systèmes d’information une stricte confidentialité de l’identité du ou des auteurs de signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies par l'ensemble des destinataires du signalement. Aucun élément de nature à identifier le lanceur d'alerte ne pourrait être divulgué sans son consentement (hormis devant une juridiction de jugement). Toute divulgation illégale de ces éléments confidentiels constituerait un délit passible d’une peine de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
Au titre des mesures de protection, signalons :
-
Qu’un nouveau cas d’irresponsabilité pénale serait introduit dans le Code pénal (art. 122-9 nouveau) à côté notamment de la légitime défense, au bénéfice de « la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu'elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d'alerte » (non applicable toutefois en cas violation du secret de la défense nationale, du secret médical ou du secret des relations entre un avocat et son client) ;
-
Que le lanceur d’alerte éthique bénéficierait d’une protection contre toute mesure discriminatoire en matière d’emploi (extension de la protection anti-discriminations directes ou indirectes prévue à l’article L1132-3-3 du Code du travail au bénéfice des personnes ayant relaté ou témoigné de bonne foi de faits « constitutifs » d'un délit ou d'un crime dont elle aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions).
Des dispositions spécifiques sont en outre prévues dans le cadre du Code monétaire et financier pour le domaine spécifique des banques et des assurances, de manière à imposer la mise en place de procédures permettant un signalement de tout manquement aux obligations professionnelles dans ces secteurs auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et/ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Dans ce cadre, les personnes physiques signalant de bonne foi à l'Autorité des marchés financiers ou à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des faits susceptibles de caractériser l'un ou plusieurs des manquements ne pourraient faire l'objet, pour ce motif, d'un licenciement, d'une sanction, d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération ou d'évolution professionnelle, ou de toute autre mesure défavorable, sous peine de nullité de plein droit de la mesure.
Selon une mécanique probatoire désormais classique (cf. les harcèlements au travail), en cas de litige il appartiendrait à l'auteur du signalement d’établir des faits permettant de présumer qu'il a agi de bonne foi, à charge ensuite pour la partie défenderesse, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement. Le juge peut ordonner toute mesure d'instruction utile.
-
Il faudra articuler ce futur texte avec la directive européenne adoptée le 14 avril 2016 par le Parlement et le Conseil de l’UE, sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l’obtention, l'utilisation et la divulgation illicites, afin de protéger les « secrets d’affaires » des entreprises européennes et leur capacité d’innovation contre l’espionnage industriel ou économique.
D’emblée, cette proposition de directive a suscité une forte controverse en raison de craintes que les « représailles » possibles à l’encontre des lanceurs d’alerte notamment conduisent à empêcher le déclenchement d’alertes.
Dans son préambule (cf. considérant n° 20), la directive expose toutefois que « les mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive ne devraient pas entraver les activités des lanceurs d’alertes. La protection des secrets d'affaires ne devrait dès lors pas s'étendre aux cas où la divulgation d'un secret d’affaires sert l'intérêt public dans la mesure où elle permet de révéler une faute, un comportement inapproprié, ou une activité illégale directement pertinents. Cela ne devrait pas être compris comme empêchant les autorités judiciaires compétentes d'autoriser une dérogation à l'application de mesures, procédures et réparations lorsque le défendeur avait toutes les raisons de croire, de bonne foi, que son comportement satisfaisait aux critères appropriés énoncés dans la présente directive. »
L’article 4 prévoit par ailleurs une série de dérogations aux mesures de réparation en cas de divulgation de secrets d’affaires, et dont pourront bénéficier éventuellement les lanceurs d’alerte de bonne foi. Les États membres devront ainsi veiller à ce qu'une demande de réparation notamment soit rejetée lorsque l'obtention, l'utilisation ou la divulgation alléguée du secret d'affaires a eu lieu :
- Soit pour exercer le droit à la liberté d'expression et d'information établi dans la Charte, y compris le respect de la liberté et du pluralisme des médias ;
- Soit pour révéler une faute, un comportement inapproprié ou une activité illégale, à condition que le défendeur ait agi dans le but de protéger l'intérêt public général ;
- Soit en cas de divulgation par des travailleurs à leurs représentants dans le cadre de l'exercice légitime par ces représentants de leur fonction, pour autant que cette divulgation ait été nécessaire à cet exercice;
- Soit aux fins de la protection d'un intérêt légitime reconnu par le droit de l'Union ou le droit national.
Compte tenu des tensions entre défense de la transparence au nom de l’intérêt public et protection non moins légitime d’intérêts privés, on suivra avec intérêt ces évolutions législatives (notamment la transposition de la directive, sous 2 ans) et les développements judiciaires à venir sur ce sujet particulièrement sensible.