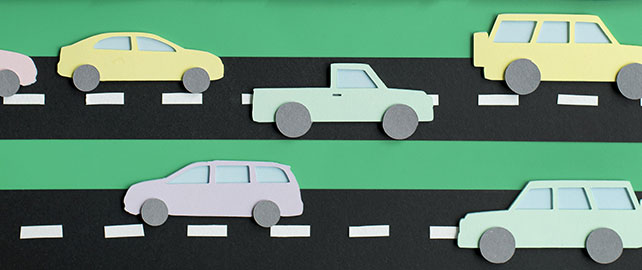Un constat s’impose : rares sont aujourd’hui les travailleurs non concernés par l’utilisation quotidienne des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans leur cadre professionnel. Ces outils, de plus en plus puissants, rapides et interconnectés ont entraîné de très profondes mutations du rapport individuel et collectif au travail, et au temps.
L’hyper-sollicitation, l’hyperréactivité et l’hyperjoignabilité permanentes sont désormais la règle, les exigences de résultats et de reporting sont démultipliées, créant souvent une surcharge de travail et informationnelle.Les dérives apparaissent également, avec parfois une tendance des acteurs du monde de l’entreprise à adopter des comportements peu responsables de type consumériste. L’adaptation insuffisante du salarié aux évolutions incessantes des technologies mises à disposition peut être en outre facteur de « handicap » numérique, source de stress.
L’utilisation inappropriée et déraisonnée des outils technologiques peut ainsi être source de dégradation des conditions de travail pour les travailleurs salariés (commerciaux, managers, etc.), alimentant alors un cercle vicieux nuisible à l’efficacité du travail sur le long terme et de nature à pénaliser la compétitivité de l’entreprise.
De fait, il existe des zones de risques émergentes pour les employeurs, avec en arrière-plan la question des TIC.
Impossible de passer à côté de la montée en puissance de la
judiciarisation de la matière : remise en cause tous azimuts
des dispositifs de forfait annuel en jours ; problématiques
de harcèlement moral ; contestation de licenciement pour
inaptitude médicale suite à burn out
professionnel ; etc.
Les décisions de jurisprudence sont nombreuses (et
statistiquement sévères pour les employeurs), et risquent de
s’accroître avec la probable intégration des affections
psychiques dans le tableau des maladies professionnelles ou
l’abaissement du seuil d’incapacité permanente partielle pour ces
mêmes affections (cf. loi n° 2015-994 du 17 août 2015, art. 33),
ce qui ne manquera pas alors d’alimenter le contentieux de la
faute inexcusable.
En l’absence de réglementation spécifique au travers du Code du travail (cf. p. ex. dispositifs de contrôle de l’activité professionnelle ; suivi de la charge de travail pour les télétravailleurs et ; consultation du CE en cas de mutations technologiques) ou de lois spéciales (cf. la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978), les moyens juridiques ne manquent pas pour mettre en cause la responsabilité de l’employeur, notamment en cas de manquement à son obligation de sécurité de résultat (même si la jurisprudence vient de tempérer celle-ci en matière de risques psychosociaux dans la désormais célèbre affaire Air France – cf. Cass. Soc. 25 novembre 2015, n° 14-24444).
Par exemple, citons en matière d’accidents du travail, le risque
routier lié à l’utilisation des outils de téléphonie constitue un
enjeu majeur en termes de prévention (cf. précédente chronique
« Risque routier et télécommunications : fini l’oreillette au volant ! »
- août 2015). Typiquement, l’obligation d’évaluer les risques
professionnels fait partie des fondamentaux, et les TIC doivent
être intégrées dans cette approche.
Avec le développement du travail non-salarié (cf.
autoentrepreneurs, etc.) et l’uberisation de l’économie
dite « collaborative », la question risque également de déborder
le seul sujet du salariat.
Les donneurs d’ordre doivent se montrer vigilants quant à
l’utilisation des TIC, au risque par exemple que celle-ci puisse
être le support de reconnaissance d’un lien de subordination
juridique susceptible d’entraîner la requalification de la
relation de travail (cf. Cass. Soc. 6 mai 2015, n° 13-27355 ;
Cass. Crim. 15 décembre 2015, n° 14-85638).
Cela étant, on ne peut pas considérer que la technologie soit en elle-même bonne ou mauvaise. Il convient d’appréhender cela sous un triple angle technique, humain et organisationnel.
D’ores et déjà, le Plan santé au travail (PST) pour 2016-2020, focusé sur la prévention, identifie les RPS en tant que priorité d’action nationale, et prévoit à ce titre de veiller aux conditions d’usage des outils numériques, notamment au regard des risques liés au travail sur écrans (cf. action n° 1.21), et de mettre les technologies du numérique au service de la qualité de vie au travail, dans le cadre du dialogue social (action n° 2.3).
Une « évolution du cadre normatif du droit à la déconnexion » est annoncée ; reste à savoir quel en sera le contenu. Plutôt que d’évolution, il serait plus approprié de parler de définition, car c’est tout le problème.
Au plan juridique, plusieurs approches sont en effet possibles, allant :
- D’une protection dont l’invocation serait laissée à la libre initiative du salarié (forme de « droit de retrait numérique » applicable au-delà de certains seuils à définir) … sachant que la jurisprudence assure déjà un contrôle en jugeant par exemple que « le fait de n'avoir pu être joint en dehors des horaires de travail sur son téléphone portable personnel est dépourvu de caractère fautif et ne permet donc pas de justifier un licenciement disciplinaire pour faute grave » (Cass. Soc. 17 février 2004, n° 01-45889) ;
- A un dispositif plus coercitif pour les employeurs, imposant
par exemple la mise en place après information/consultation des
IRP et information individuelle des salariés (cf. C. Trav.,
L2323-47 ; L1222-1 et suivants), des mesures techniques de
blocage physique d’accès ou d’utilisation des outils dans
certaines circonstances (ex : arrêt maladie), ou plages
horaires (repos, nuit, etc.).
Cette dernière voie, sans doute plus conforme à une logique de prévention primaire, paraît toutefois peu réaliste est n’a d’ailleurs quasiment pas été expérimentée par les entreprises en pratique.
Si techniquement « tout est possible », sans doute faut-il concilier les impératifs de santé avec la question du coût économique raisonnablement acceptable pour les entreprises (même si la Directive européenne n° 89/391 du Conseil du 12 juin 1989 pose le principe selon lequel « l'amélioration de la sécurité, de l'hygiène et de la santé des travailleurs au travail représente un objectif qui ne saurait être subordonné à des considérations de caractère purement économique »).
Il faut en outre considérer la question de la responsabilité individuelle du salarié, sachant que l’exposition aux écrans et l’hyperconnexion sont des phénomènes multifactoriels, et que l’employeur n’a pas d’emprise sur le comportement du salarié homo connecticus dans le cadre de sa vie privée (sauf à lui reconnaître une obligation de veiller à maintenir le salarié en bon état de santé, ce qui irait très au-delà de ses prérogatives).
La déconnexion professionnelle imposée aux salariés constitue donc une alternative, mais il faudrait alors ne plus renoncer à parler de « droit », sauf à considérer que cette obligation serait une garantie d’effectivité du droit à la santé.
Puisque l’on parle d’effectivité, resterait à définir comme cette obligation serait contrôlée par l’employeur et sous quelles sanctions (pour les salariés au forfait-jours par exemple, la loi prévoit actuellement qu’« un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur (…) sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié » - C. Trav., L3121-46).
La réponse de l’Etat se devra d’être équilibrée, en tenant compte
des consensus issus du dialogue social.
Que ce soit au niveau interprofessionnel, des branches ou des
entreprises, le dialogue social peut apporter des réponses
pertinentes (la Convention OIT n° 187 qui vient d’être publiée
par le décret n° 2016-88 du 1er février 2016 incite d’ailleurs à
mobiliser la négociation collective comme vecteur de
prévention).
Le Gouvernement a annoncé que le chantier du numérique serait
l’un des sujets le plus ouvert à la négociation.
Force est cependant de constater qu’hormis la branche des Bureaux d’études techniques (dite Syntec), le sujet reste sensible, et la négociation, difficile.
Or, l’absence de mesures conventionnelles ne pourra qu’inciter l’Etat à chercher à réguler par la loi le sujet, sachant que le projet refondation de l'architecture du Code du travail esquisse une distinction entre ce qui relèverait :
- D’une part, des droits fondamentaux garantis à tous ;
- D’autre part, des accords de branche ou d’entreprise dont le champ doit être conforté ;
- Enfin, des règles applicables de manière supplétive en l’absence d’accord.
Le droit à la déconnexion trouvera sa place dans ce nouvel édifice selon le contenu qui lui sera donné.
En tout état de cause, rien n’empêche d’ores et déjà les entreprises de mettre en œuvre, notamment au travers de la nouvelle négociation sur la qualité de vie au travail (QVT), des mesures de régulation originales et adaptées à leur réalité.
Le droit d’expression peut d’ailleurs être source de bonnes idées ; être à l’écoute ne signifie pas renoncer au pouvoir d’arbitrage et de direction.
D’une manière générale, cette régulation ne paraît adaptée que si elle est ancrée dans une politique globale et intégrée, fondée notamment sur une exemplarité managériale et la mise en œuvre d’actions de sensibilisation individuelle et collective des salariés sur les bonnes pratiques d’« hygiène numérique » (entendue ici en termes de santé et pas de sécurité des systèmes d’information), avec par exemple des chartes de bonne utilisation des messageries de manière à limiter les phénomènes de « pollution » numérique.
En lien avec la RSE, cela peut même aller jusqu’à une sensibilisation des clients, usagers ou fournisseurs. Certaines entreprises ont même choisi de changer d’approche SAV, par exemple en remplaçant l’assistance téléphonique –source de RPS- par une assistance dématérialisée via internet (chat en ligne). La digitalisation de la relation client peut ainsi être à la fois source de progrès social et de performance du service économique.
En recentrant la négociation collective sur une logique de dialogue social plus stratégique, la loi Rebsamen du 17 août 2015 a ouvert une nouvelle dynamique, appelée à s’amplifier notamment dans les PME/TPE, car le « virage numérique » mérite d’être placé au cœur de la stratégie de toutes les entreprises.
Il est regrettable que le numérique soit perçu –comme l’illustre la question du droit à la déconnexion- comme un facteur de risques uniquement sous un angle négatif, alors qu’il s’agit d’une formidable opportunité pour les entreprises françaises et leurs salariés.
Si l’on change de point de vue, l’Etat doit accompagner les entreprises dans cette mutation et il devrait être de la responsabilité des pouvoirs publics d’avoir une vision stratégique de long terme mieux affirmée, laquelle impliquerait notamment d’adapter fondamentalement le droit du travail à la digitalisation du travail.
Combien de concepts issus de l’ère post-industrielle paraissent aujourd’hui dans bien des métiers en total décalage avec la réalité du travail et même des attentes des salariés en termes de mobilité ou de flexibilité d’organisation privée/ professionnelle ?
Pour l’instant, force est de constater que le numérique n’irrigue que très faiblement le droit du travail alors qu’il fournit de réelles opportunités de simplification (ex : possibilité nouvelle de recours aux visioconférences pour les réunions d’IRP ; dématérialisation de la base de données économiques et sociales ; etc.).
Il serait utile de réfléchir à intégrer tout ce que le numérique peut apporter de positif en termes d’améliorations sur le plan notamment de l’innovation, des conditions de travail, tout en instituant bien sûr des garde-fous (prévention des risques, conditions de contrôle de l’activité des salariés, big data, etc.).
L’« épaisseur » du Code du travail semble être un faux débat ; mieux vaudrait s’intéresser aux moyens d’adapter celui-ci de manière structurante au nouveau contexte économique afin de permettre à nos entreprises d’être plus robustes et de préserver leurs emplois.
Au niveau des entreprises, l’enjeu principal est d’accompagner le changement, ce qui doit s’inscrire dans une réflexion sur la mutation de l’activité, des marchés et des process.
Si le digital amène à faire évoluer le travail, il ne remplacera jamais les hommes qui sont la première ressource de l’entreprise. Le travail et le digital sont bien au cœur de la stratégie de l’entreprise, le droit du travail doit d’adapter pour les faire converger.