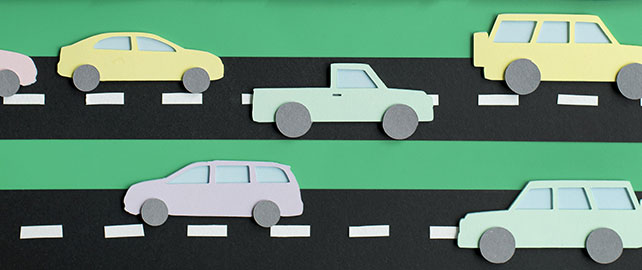Pourquoi cet ouvrage sur les risques criminels en
entreprise ?
Les entreprises françaises n’ont opéré que récemment leur
révolution commerciale pour entrer de plain-pied dans l’économie
internationale. Contrairement aux entreprises anglo-saxonnes qui
ont mis en place des directions de la sécurité dès les années 70,
les entreprises françaises ont pris du retard.
Elles ne sont pas toujours bien préparées aux risques criminels
très diversifiés qui peuvent mettre en péril leur existence
même.
Les directeurs sûreté
ou sécurité, ces deux appellations coexistent, font face
aujourd’hui au crime organisé, à la mafia, aux mouvances
terroristes à l’international sans parler de la cybercriminalité.
En 2011, la D.C.R.I. (Direction Centrale du Renseignement
Intérieur) a recensé plus de mille attaques contre les
entreprises.
Les entreprises évoluent aujourd’hui dans un environnement
éminemment instable et hostile avec un désengagement de l’Etat,
qui les obligent à se structurer et à professionnaliser leurs
politiques de gestion des risques.
Quelles sont les principales menaces criminelles qui
pèsent sur les entreprises ?
Les menaces criminelles sont de trois ordres : les menaces
avérées et à forte occurrence, les menaces avérées mais
difficiles à appréhender et les menaces émergentes. Toutes ces
menaces ont un point commun : elles déstabilisent
l’entreprise parce qu’elles mettent à mal son équilibre financier
et son développement, qu’elles entraînent un traumatisme pour le
personnel de l’entreprise, ou qu’elles ont une incidence forte
sur l’image du groupe.
Vous identifiez la cybercriminalité, la délinquance
environnementale et l’activisme postmatérialiste comme des
phénomènes montants en termes de risques,
expliquez-nous.
L’espionnage économique, le terrorisme ou encore la corruption ne
sont pas des menaces nouvelles à gérer pour les entreprises.
D’autres phénomènes plus difficiles à cerner représentent des
menaces sérieuses auxquelles les entreprises doivent se
préparer.
En 2011, 1,8 million de nouvelles attaques cybercriminelles sont
apparues chaque jour, soit deux fois plus qu’en 2010. Surtout,
ces attaques ont muté, dans leurs formes autant que dans leurs
cibles. Du hacking en passant par le phreaking ou encore le
phishing, il est possible d’user à des fins de malveillance
différents outils cybercriminels, en premier lieu desquels
figurent les A.P.T. (Advanced Persistent Threat), qui sont des
attaques commanditées avec des objectifs précis.
Concernant la délinquance environnementale, plusieurs affaires
récentes concernant le traitement des déchets ont mis en lumière
les conséquences que peuvent avoir ces agissements sur
l‘environnement et la santé publique mais aussi sur l’activité
économique des entreprises de ce secteur.
Enfin, les mouvements de contestation éthique (altermondialistes,
anti-OGM, anticonsommation…) dans leurs branches les plus
radicales peuvent dériver vers des pratiques délictuelles, voire
violentes afin de capter l’attention des média.
Face à toutes ces menaces, comment mettre en place un
système de management de la sûreté efficace ?
La priorité d’un responsable sûreté est la résilience,
c’est-à-dire la capacité de l’organisation à surmonter une
interruption d’activité causée par un accident majeur ou une
crise en minimisant les impacts sur le fonctionnement de l’unité
concernée, voire de l’entreprise dans sa globalité.
Dans cette optique, trois mots clés sont à retenir :
anticiper, manager et réagir.
La phase d’anticipation permet d’évaluer les menaces, d’analyser
les risques et de mettre en place les outils de protection
adéquats pour prévenir et faire face à la survenance d’une
menace.
La phase de management consiste à implémenter la sûreté au sein
de l’organisation par une sensibilisation des collaborateurs et
un contrôle du respect des procédures sûreté.
Enfin, la phase de réaction concerne la capacité à faire face à
une situation susceptible d’engendrer une crise et de minimiser
ses impacts sur l’activité et le patrimoine de l’entreprise.
En conclusion, pour vous, à quoi ressembleront les
services de sûreté de demain ?
En premier lieu, je suis fondamentalement convaincu des bénéfices
d’une intégration poussée de la sûreté dans la gestion globale
des risques, avec un positionnement des directeurs sûreté en
soutien des grandes orientations stratégiques de la direction
générale.
En ce qui concerne la gouvernance de la sûreté, les scandales
récents impliquant de grandes entreprises telles que Renault,
Areva ou Canal + m’incitent à penser que celle-ci doit évoluer
dans le cadre d’une meilleure collaboration avec les services de
renseignement de l’Etat. Dans cette même idée, l’arsenal
juridique à disposition des entreprises doit être renforcé,
notamment en ce qui concerne la protection des systèmes
d’information.
Enfin, je crois au développement de synergies entre la sûreté et
le développement durable. L’entreprise ne doit plus se cantonner
à une approche seulement attentiste ou défensive en matière de
sûreté, elle doit avoir une approche plus sociétale, afin
d’anticiper les problèmes d’intégration et les phénomènes de
malveillance qui pourraient en résulter.
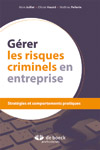 En savoir plus
En savoir plus
- Gérer les risques criminels en entreprise, Stratégies et comportements pratiques - Olivier Hassid, Alain Juillet et Mathieu Pellerin, Editions De Boeck, sept. 2012