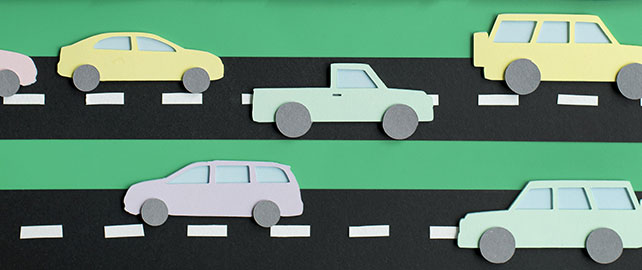L’action du Fonds national de prévention pour les Fonctions publiques territoriale et hospitalière
Le Fonds national de prévention de la CNRACL a intégré le
Comité de pilotage national pour la prévention du
risque routier professionnel en 2006.
Depuis, dans le cadre des groupes de travail, il a œuvré pour
la prévention de ce risque et multiplié ses interventions afin de
favoriser les démarches dans les collectivités territoriales et
établissements hospitaliers.
Résultats des travaux engagés au cours des trois dernières années.
I – Animer les groupes de travail
Le FNP a participé à plusieurs groupes de travail mis en place
pour atteindre les objectifs fixés par le programme
d’actions 2006-2009 du Comité de pilotage pour la prévention
du risque routier : risque trajet, compétences, statistiques
Sécurité Routière, risque mission : Groupe Commun de
Concertation des véhicules ultras légers (GCC VUL).
C’est au travers du GCC VUL, dont le FNP a assuré la présidence
de 2007 à 2009 qu’une concertation entre les acteurs a été
possible.
Le 2e séminaire du Comité de pilotage 7 et 8
décembre 2009 organisé par le FNP a permis de faire le
point sur les axes de travail prioritaires en lien avec les
groupes mis en place :
- Le risque trajet (groupe trajet),
- Le risque mission (management des véhicules – Véhicule
Utilitaire Léger - groupe GCCVUL),
- Activité de conduite / activité de travail (management des
déplacements et des communications),
- Les compétences (management des compétences - ancien groupe
«post permis professionnel»).
Groupe risque trajet
Le programme d’action 2002-2005 avait proposé, pour la
prévention de ce risque spécifique, un code de bonnes pratiques
en 6 points :
- Réduire l’exposition au risque trajet en limitant les
déplacements des salariés,
- Préférer les moyens de transport collectifs aux moyens de
transport individuels,
- Aménager les accès à l’entreprise et faciliter le
stationnement des véhicules des salariés,
- Inciter les salariés à veiller au bon état de leur
véhicule,
- Apporter une aide aux salariés pour qu’ils puissent
prendre la route dans des conditions aussi sûres que
possible,
- Informer et former les salariés.
Le Comité de pilotage a mis en place un groupe de travail
et lui a fixé les objectifs suivants :
- Faire le bilan des actions les plus exemplaires : actions
menées par les CRAM, la MSA et la CNRACL, dossiers examinés dans
le cadre des Trophées en 2008,
- Mettre en place une expérimentation spécifique qui
pourrait concerner 8 à 10 sites, associant si possible plusieurs
entreprises et éventuellement plusieurs régimes,
- Tester les possibilités de rapprochement ou de convergence
avec les PDE dans le cadre de ces expérimentations.
Bilan des actions mises en œuvre lors de la table ronde
du 9 octobre 2009
Au cours de cette journée, plusieurs intervenants ont témoigné du
rapprochement sur le terrain des démarches de prévention du
risque trajet et des Plans de Déplacement d’Entreprise (PDE). La
question de la prévention du risque trajet dans les zones
d’activité économique a été largement évoquée, ainsi que la
possibilité de mobiliser les PME dans des démarches collectives,
et le rôle essentiel des collectivités territoriales.
De ces échanges a émané l’idée que la prise en compte des enjeux
de mobilité durable (restriction de l’usage de la voiture
individuelle, entre autres) ne doit pas se faire au détriment de
la sécurité des salariés (risque lié à l’usage croissant du deux
roues motorisé notamment), et que la convergence est aujourd’hui
nécessaire dans la définition des politiques publiques sur ces
sujets.
Nouvelles propositions
- Favoriser la convergence des politiques de prévention du risque
trajet et des politiques de mobilité durable,
- Promouvoir les approches collectives de prévention du
risque trajet dans les zones d’activités économiques,
- Développer la prévention dans les PME,
- Mieux connaître la sinistralité et l’exposition des
salariés au risque.
Ces orientations seront précisées dans le programme d’action 2010-2012 du Comité de pilotage. D’ores et déjà, ce dernier a décidé de publier en janvier 2010 un livre blanc «Mieux prévenir les accidents de trajet, un enjeu de santé au travail et de mobilité durable». Ce livre blanc formalisera les propositions de la table ronde, ouvrira de nouvelles pistes de prévention et précisera les sujets sur lesquels une concertation sera nécessaire entre les acteurs.
Groupe de concertation sur les VUL (véhicules utilitaires légers)
Le GCC VUL est en lien avec l’axe de travail «management des véhicules» (équipement et aménagement des véhicules, maintien en bon état de fonctionnement). Son action s’inscrit dans le cadre de la prévention du risque «mission».
Deux moments clés ont présidé à la naissance des travaux sur les
VUL :
- Tout d’abord, en 2001 le rapport SAADIA
aboutit à des propositions relatives à l’entreprise, la
formation, les incitations financières, le véhicule et la prise
en compte du risque routier professionnel par les acteurs de la
prévention. Une attention particulière est dédiée au Véhicule
Utilitaire Léger (< 3,5 tonnes),
- En 2003-2004 la CATMP (Régime Général) adopte
les guides de bonnes pratiques «risque mission» et «risque trajet».
Le Comité de pilotage pour la prévention du risque
routier engage alors trois actions
prioritaires :
- Lancement d’une enquête terrain CNAMTS pour mieux connaître
l’état du parc des VUL,
- Organisation d’une Table Ronde VUL en 2006 à laquelle participe
le FNP de la CNRACL,
- Formalisation dans un Livre Blanc des 12 propositions
correspondant aux besoins mis en évidence lors de la Table Ronde
(dont le GCC VUL).
Le Conseil d’Administration de la CNRACL accepte de présider le
Groupe commun de concertation VUL (GCC VUL) mis en place.
Douzième proposition du Livre blanc et placé sous l'égide du
Comité de pilotage pour la prévention du risque routier
professionnel (COPIL), le Groupe Commun de Concertation VUL a
permis notamment de :
- Développer les douze propositions et en assurer le suivi,
- Intégrer l’exigence de sécurité dans les textes réglementaires,
normatifs ou de bonnes pratiques,
- Tenir compte de la spécificité des métiers et des secteurs
professionnels,
- S’assurer que les préconisations couvrent le choix ou la
spécification à l’usage du VUL dans un cadre professionnel.
Les travaux et débats du GCC VUL animés par le FNP ont débouché
sur une série de propositions qui dessinent les contours d’une
politique volontariste en faveur d’un VUL plus sûr.
Ils ont notamment contribué à la finalisation du rapport final
VUL qui vient d’être publié.
Il a fait l’objet d’une présentation à la Commission européenne
le 4 mars 2010.
> Télécharger : la synthèse (lien cliquable vers PDF n°4) et le rapport final
> Avancées par rapport au livre blanc. Consultez les annexes du rapport
Groupe post permis professionnel
Créé en lien avec le thème «management des compétences», dans le
cadre de la prévention du risque «mission».
Ce groupe est issu d’une expérimentation de formation, dite «post
permis professionnel», réalisée avec des entreprises volontaires.
L’objectif est d’étendre cette expérimentation aux collectivités
territoriales et hospitalières.
Aujourd’hui dénommé «groupe compétences», il poursuit le travail
engagé sur le référentiel dans le cadre du GCCVUL.
II - Expérimenter dès aujourd’hui « pour un VUL plus
sûr » :
des outils mis à disposition
Tous les acteurs peuvent mettre en place le plus rapidement
possible un certain nombre d’initiatives de prévention en
faveur d’un VUL plus sûr.
II est possible de traiter les situations de risques existantes
sans attendre les retombées des travaux à engager sur le plan
réglementaire, national et communautaire.
Ainsi, pour les collectivités utilisatrices de VUL, le GCC VUL
propose de mettre en œuvre une démarche volontaire de prévention
en conformité avec les préconisations du rapport incluant
notamment:
- Des critères de choix du VUL (guides d’achat type),
- La mise en place d’un carnet de suivi,
- La reconnaissance des compétences (référentiel).
Suite aux travaux déjà engagés entre la CNAMTS, l’INRS et les représentants des CRAM, certains outils sont disponibles.
Un guide d’aide au choix d’un VUL
(CRAMAM)
Ce carnet réalisé par la CRAM Alsace Moselle a pour objet
d’accompagner dans le choix de son futur véhicule. Il se présente
sous forme de fiches, qui permettent d’exprimer ses besoins de
façon chiffrée et facilitent les discussions avec les aménageurs
et concessionnaires.
> Télécharger : le Guide d’aide au choix d’un VUL
Un guide de sélection (INRS)
Cette brochure s'adresse aux entreprises qui souhaitent acquérir
un véhicule utilitaire léger (VUL).
Les différentes options proposées par les constructeurs, dont
certaines contribuent pleinement à la prévention des accidents du
travail et des maladies professionnelles, y sont présentées.
Une liste de questions préalables à l'achat d'un VUL ainsi qu'une
série de points clés à vérifier sont aussi proposées afin d'aider
les entreprises à choisir un véhicule utilitaire léger adapté à
leur activité professionnelle spécifique.
> Télécharger : la brochure INRS ED 6046 "Choisir son véhicule utilitaire léger (VUL)"
Le carnet de suivi des véhicules utilitaires légers
(VUL)
Une des mesures de prévention de l’accident de la route au
travail consiste à mettre en place, dans l’entreprise, un carnet
de suivi par véhicule. Le carnet de suivi, mis en place pour
chaque véhicule, se compose d’une fiche portant au recto les
caractéristiques du véhicule, l’historique de l’entretien et des
réparations ainsi que la signature du chef d’entreprise
autorisant l’utilisation du véhicule ; au verso, les
conducteurs notent les contrôles avant le départ et les incidents
survenus en mission.
Le carnet de suivi permet au chef d’entreprise comme aux
conducteurs, par l’engagement et l’application de chacun à
renseigner le document, de s’assurer du bon état des véhicules
qui partent en mission.
http://www.inrs.fr/inrs-pub/
Un référentiel de compétences.
L’élaboration de ces documents s’est faite en concordance avec la
construction, actuellement en cours, d’un référentiel de
compétences à l’usage du VUL dans le cadre professionnel
permettant :
- A l’employeur, de disposer de repères l’aidant dans sa décision
d’autoriser ses salariés à utiliser un VUL à titre
professionnel,
- A l’utilisateur d’un VUL, de réaliser la mission qui lui est
confiée par le chef d’établissement, en sécurité et en préservant
sa santé.
III - Encourager les démarches de prévention
Le risque routier encouru par les agents fait partie des risques professionnels et doit être intégré au processus d’évaluation des risques. A ce titre, le FNP soutient les démarches engagées par les employeurs publics, que ce soit pour prévenir le risque trajet et/ou le risque mission.
Le risque routier professionnel est un risque
professionnel
auquel s’appliquent les principes généraux de
prévention
Évitement et limitation de
l’exposition
Éviter ou limiter les déplacements en recourant à des moyens
alternatifs
Lorsque les déplacements sont nécessaires, donner la priorité
aux moyens de déplacement les plus sûrs.
Organisation des
déplacements
Identifier et emprunter les itinéraires les plus sûrs
Prévoir le temps nécessaire pour conduire en sécurité
Utiliser des outils fiables de préparation d’itinéraires
Adaptation des véhicules au
déplacement et à la tâche
S’assurer que les véhicules utilisés sont aménagés et équipés
pour permettre des déplacements sûrs, et adaptés à l’activité
du salarié.
Les maintenir en bon état de fonctionnement
Maîtrise des
communications
Ne pas utiliser de téléphone au volant, quel que soit le
dispositif technique
Définir des règles de gestion pour une communication sûre
Compétence reconnue du
salarié conducteur
Les professionnels de la route (poids lourds) ont une
obligation de formation au-delà du permis.
Les professionnels sur la route devraient pouvoir bénéficier de
dispositifs équivalents sans pour autant tomber dans la
lourdeur des CACES, FIMO, FCOS et autre…
A ce jour (2005 à avril 2010), le FNP a accompagné 17 démarches de prévention du risque routier professionnel.
Deux démarches ont reçu une
mention spéciale
lors des Trophées sécurité routière en
2008
La participation du FNP au Comité de pilotage national pour la
prévention du risque routier a permis aux collectivités locales
de concourir pour la première fois aux «Trophées entreprises et
sécurité routière» qui se sont déroulées le 28 mai 2008 à
Paris.
Lors de la cérémonie de remise des prix, le jury a récompensé 2
des projets déposés par des collectivités locales.
Département de l’Essonne (91)
A l’origine de la démarche de prévention, une triple
motivation :
- Le constat que le risque routier est la cause première des
accidents mortels du travail, et qu’au sein du Conseil Général
91, il est le premier risque professionnel sur le critère du
nombre d’agents d’exposés,
-La volonté d’inscrire le Conseil Général dans le renforcement
des politiques publiques sur la sécurité routière et dans
l’accentuation mise sur le risque routier dans la politique de
prévention des risques professionnels,
La démarche basée sur les actions de communication et de
sensibilisation comportait notamment un diagnostic de la
mobilité des agents : enquêtes et entretiens sur les
pratiques actuelles de déplacement, état des lieux de
l’accessibilité des sites du Conseil Général, réalisation d’un
compte de déplacement, bourse de covoiturage…
Aujourd’hui, le Conseil Général veut aller encore plus loin dans
sa démarche en diminuant le recours à la voiture.
Service Départemental d’Incendie et de Secours de la
Drôme (S.D.I.S 26).
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Drôme,
SDIS26 s’est engagé, au début de l’année 2006, dans une politique
de prévention de risques routiers. La démarche, déclinée en
plusieurs étapes, s’est déroulée de la fin 2005 à début 2007.
Validée lors du Comité d’Hygiène et de Sécurité du 7 mars 2007,
la rédaction du Plan de Prévention des Risques Routier, le PPRR,
a permis de dresser un diagnostic sur la sinistralité routière au
sein du SDIS de la Drôme et de définir un plan
d’actions destiné à réduire le nombre et la gravité des
accidents.
Notes
[1] Créés en 2006, les Trophées “Entreprise et sécurité routière” valorisent des actions de sécurité routière menées dans le cadre professionnel, une des priorités portées par Jean-Louis Borloo, Ministre d’État, Ministre de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire, en matière de lutte contre l’insécurité routière. A l’occasion de cette nouvelle édition, ouverte à l’ensemble des professions et des régimes sociaux, Cécile Petit, déléguée interministérielle à la Sécurité routière et Stéphane Seiller, directeur des risques professionnels à la CNAMTS, ont remis 14 distinctions.
Liens
- http://fnp.cnracl.fr
- www.risqueroutierprofessionnel.fr
- http://www.cram-alsace-moselle.fr/Prevent/doc/docrout.htm
- www.cram-alsace-moselle.fr/editorial/spip.php?rubrique8
- http://pedro.artifrance.fr/
- www.inrs.fr/dossiers/conduire.html