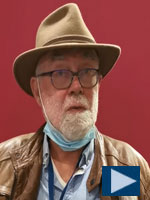Ces premières rencontres consacrées aux normes et à la sécurité
civile, organisées par la Direction Générale de la Sécurité
civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC), en partenariat avec
la Fédération Française des Métiers de l’Incendie (FFMI),
réunissaient des représentants de l’Etat, des sapeurs-pompiers,
des industriels, des organismes de normalisation et de
certification, des professionnels et des assureurs.
La sécurité civile française s’exporte dans de nombreux pays.
Cette reconnaissance internationale repose sur l’action
volontariste des pouvoirs publics, la compétence des
sapeurs-pompiers et sur les savoir-faire des entreprises
hexagonales. Un des piliers de ce modèle est la norme, qui
permet à la filière française de sécurité civile d’être
compétitive, mais qui est également un outil de performance
économique et sociétale globale.
Patrick Butor, délégué interministériel aux normes, et
Julien Marion, directeur adjoint de la DGSCGC ont rappelé
l’importance pour tous les acteurs de participer activement au
processus d’élaboration des normes françaises, européennes et
internationales. Plus qu’un simple enjeu économique, leur
maitrise est un enjeu de « souveraineté nationale ».
Cette dimension a été au cœur des échanges : sapeur-pompiers,
services d’achat du Ministère de l’intérieur, industriels ont
témoigné de la place de la norme technique comme aide à la
décision d’achat, outil de transparence pour l’utilisateur,
facteur de concurrence par la qualité et reflet des besoins de
l’ensemble des parties prenantes.
Mais les participants ont également rappelé que les effets
vertueux de la norme technique étaient conditionnés à la
confiance accordée par les acteurs de la sécurité civile au
processus d’évaluation de sa conformité. Ce faisant, ils ont
rappelé la nécessité d’une certification de conformité
systématique par tierce partie indépendante, cette dernière étant
unanimement considérée par l’ensemble des participants comme un
véritable « outil de confiance ».
L’intérêt des marques de qualité volontaires qui complètent,
lorsque c’est nécessaire, les normes européennes ou
internationales, a également été souligné afin de s’assurer que
les solutions de sécurité sont bien en adéquation avec les
exigences réglementaires ou la manière de construire et exploiter
un bâtiment.
Ce triptyque « norme, certification, marque de qualité volontaire
» occupe une place centrale dans le schéma de sécurité civile, en
France, comme dans la plupart des Etats qui ont souhaité se doter
d’instruments de sécurité efficaces.
Ce schéma fait ses preuves depuis plus de 30 ans et évolue
constamment pour répondre aux enjeux de la sécurité des français
et de leurs biens. Intervenants et participants ont toutefois
partagé leur préoccupation quant à la conjonction de trois
phénomènes.
Si les produits et solutions techniques sont au cœur du schéma de
confiance français, les services associés, notamment
l’installation et la maintenance des produits, sont encore trop
insuffisamment intégrés à ce schéma.
Aujourd’hui 90% des normes applicables dans le domaine de la
protection des bâtiments et de leurs occupants sont d’origine
européenne. Or, il existe une tendance récente à supprimer dans
ces normes les niveaux de performance attendue des produits
concernés. D’une part, cette tendance remet en cause la confiance
des acteurs dans ces solutions, d’autre part, elle peut avoir un
impact très négatif sur le niveau de sécurité. Il apparaît
donc indispensable que la réglementation prenne le relais et
rappelle clairement les seuils minimum d’exigences pour les
produits de sécurité.
Les institutions européennes ne disposent pas aujourd’hui des
moyens nécessaires pour s’assurer que chaque Etat agit avec la
même vigilance en matière d’évaluation de la conformité aux
normes. Il y a donc lieu de promouvoir une harmonisation accrue
des pratiques en matière de normalisation et de certification et
de continuer à promouvoir le modèle français auprès de nos
partenaires.
En conclusion, Régis Cousin, président de la FFMI, comme Julien Marion, ont souligné que cette manifestation marquait la collaboration de plus en plus étroite et constructive entre acteurs publics et privés de la sécurité civile et ont rappelé que les acteurs devaient pouvoir compter sur un véritable « Etat-Stratège» dans ce domaine. Cette coopération est la clé du devenir du modèle français et de sa capacité à évoluer au service de la sécurité de tous.