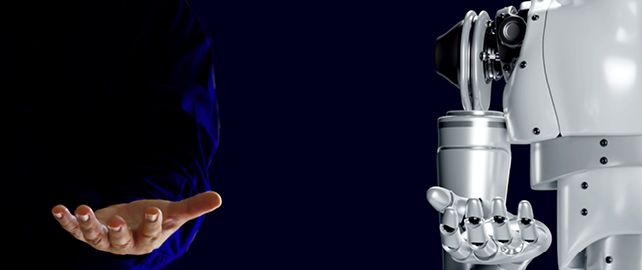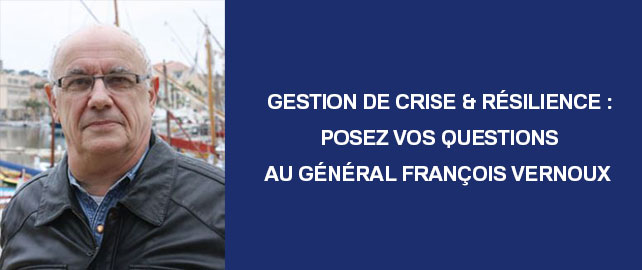Le 21 septembre 2001 à 10h17, l’agglomération toulousaine est
secouée par une importante déflagration : environ 300 tonnes
d'ammonitrate explosent dans le hangar 221 de l'usine AZF.
Le bilan est très lourd. Il s’agit d’une des plus graves
catastrophes industrielles en France. 10 ans après, des progrès
ont été constatés en matière d’évaluation et de prévention des
risques d’accident sur les sites industriels. Mais, tout n’est
pas réglé pour autant.
Explications
L’un des plus importants accidents technologiques en
France
Au matin du 21 septembre, une terrible explosion survient sur le
site d’AZF. On estime la déflagration au niveau d’un séisme de
magnitude de 3,4 sur l'échelle de Richter. Elle a été ressentie
jusqu’à 75 kms aux alentours.
Il faudra attendre un rapport d’experts de 2006 pour en connaître
les causes. Il s’agit d’un malheureux mélange de plusieurs
dizaines de kilos de dichlorocyanurate de sodium (utilisé pour
traiter les piscines) avec 500 kg de nitrate d’ammonium
déversés sur le tas principal de nitrate peu de temps avant
l’explosion.
Le bilan est lourd :
- 31 morts, dont 21 sur le site
- 2 500 blessées
- 1 300 entreprises et 20 000 emplois sinistrés à divers degrés
- 82 écoles, 19 collèges et 15 lycées, 4 établissements d’enseignement supérieur et 3 résidences universitaires endommagées
- 25 550 logements dégradés (11 180 gravement)
- 1 200 familles relogées
- Une facture d’environ 2 milliards d'euros de dégâts
La loi Bachelot de 2003
La principale mesure prise à la suite de l’accident est
l’adoption de la « loi Bachelot » du 30 juillet 2003
relative à la prévention des risques technologiques et naturels
et à la réparation des dommages. Elle a donné lieu à une table
ronde nationale qui a défini 6 priorités d’action pour le
gouvernement :
- Mise en place des PPRT (Plans de prévention des risques technologiques) : créés pour limiter, autour des 630 établissements Seveso (classés seuil « haut »), l’exposition de la population aux conséquences des accidents, contrôler l’urbanisation existante et future autour des sites à risques. 415 bassins industriels (et 900 communes) sont concernés par cette mesure.
- Augmentation des effectifs de l’inspection des installations classées de plus de 40 % : ils ont permis de réaliser plus de 1 500 contrôles sur les sites classés en 2010.
- Définition d’un nouveau périmètre pour les études de danger afin de réduire le risque à la source. Depuis 2003, les industriels ont investi, selon les chiffres du ministère de l’Écologie, des « montants annuels de 250 à 300 millions d'euros » et réduit les zones exposées d'environ 350 kms.
- Mise en place de procédures pour mieux informer la population : la loi a créé une « obligation d’information de l’acheteur ou du locataire de tout bien immobilier situé dans une zone de plan de prévention des risques naturels ou technologiques, que ce plan soit prescrit ou approuvé ».
- Création d’un dispositif assurantiel « catastrophes technologiques » comme pour les catastrophes naturelles
- Création de la base ARIA : base de données, accessible au public, qui recense les incidents et accidents industriels en France et dans le monde : elle en compte aujourd’hui 40 000.
La loi du 30 juillet 2003, en rendant obligatoire l’établissement de scénarios d’accidents pour les industriels a permis de renforcer « l’armure » des usines. Le travail de cartographie des zones à risque se termine et, à ce jour, 1600 études de dangers ont déjà été menées pour identifier tous les scénarios possibles d'accidents (de la vanne défaillante à l'erreur humaine) et améliorer la prévention.
Un dossier difficile
Tous les problèmes ne sont pas réglés. Seulement 101 plans de
prévention des risques technologiques (PPRT) ont été approuvés en
mai 2011, sur les 374 prescrits. Il n’y a que 1200 inspecteurs
pour vérifier quelque 500 000 sites industriels : c’est
encore trop peu.
En outre, les expropriations programmées des riverains résidents
trop près des zones à risques font toujours l’objet de
transaction entre l’État, les collectivités et les
industriels.
Le financement des travaux imposés par la législation pour
sécuriser les habitations (façades, fenêtres et toitures) pose
également problème. Dans les zones intermédiaires autour des
sites, il peut y avoir des prescriptions imposées aux
constructions existantes et futures et notamment des travaux aux
riverains. Mais dans ce cas, la facture, estimée à environ
200 millions d'euros et subventionnée à 30 % seulement,
sera à la charge des résidents, souvent à revenus modestes (on
n’habite pas aux abords d’un site industriel pour le plaisir) qui
ne pourront pas payer.
Conscient de la faiblesse du crédit d’impôt, le ministère en
charge de l’écologie indique que « des discussions se
poursuivent au niveau national avec les industriels et les élus
pour identifier des ressources supplémentaires permettant de
réduire la part à la charge des riverains ».
Concernant AZF, le Groupe Grande Paroisse, en tant que personne
morale, et le directeur de l’usine ont été mis en examen le 20
septembre 2006. Le 1er procès a abouti à un non-lieu en novembre
2009.
Le Parquet a fait appel. Un second procès débute le 3 novembre
2011 à Toulouse.