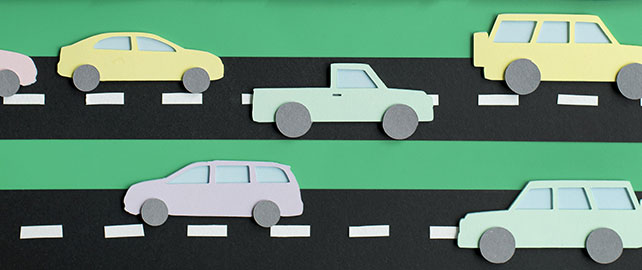Préventica - On attend davantage l’IRSN sur
le terrain du nucléaire en général que sur celui des risques
professionnels. Et pourtant, plusieurs unités de l’Institut
interviennent dans ce champ. Que faites-vous pour les entreprises
en la matière ?
Pascale SCANFF -
L’IRSN, Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
couvre, comme son nom l’indique, le risque nucléaire au sens
large, incluant la sûreté des installations nucléaires et la
radioprotection, c’est à dire la protection des personnes contre
les rayonnements ionisants. Trois groupes d’individus sont
considérés : la population générale, les patients (ceux qui
bénéficient d’examens médicaux utilisant les rayonnements
ionisants ou ceux traités pour un cancer, par exemple) et, enfin,
les travailleurs qui peuvent être exposés dans le cadre de leur
activité professionnelle. Il était donc logique que l’Institut se
préoccupe de risque professionnel, en termes de protection, mais
aussi de prévention (les deux vont de pair).
Les 1 800 salariés, experts, ingénieurs, chercheurs, physiciens,
chimistes, géologues, médecins, biologistes, épidémiologistes…,
agissent de plusieurs manières, mais toujours avec le même
but : développer la recherche et mener des études pour
maintenir et développer les compétences nécessaires à l’expertise
dans les domaines d’activité de l’Institut. L’IRSN assure des
missions de service public, dont l’une d’entre elles consiste à
assurer une veille permanente en matière de radioprotection et
notamment de radioprotection des travailleurs. À ce titre,
l’Institut centralise les données de la surveillance de
l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants et gère
le registre national SISERI (Système d’Information de la
Surveillance des Expositions aux Rayonnements Ionisants).
L’IRSN exploite ces données et en dresse annuellement un
bilan : élaboré pour les pouvoirs publics (Direction
Générale du Travail -DGT, Autorité de Sureté Nucléaire –ASN,
Délégué à la sureté nucléaire et à la radioprotection pour les
activités et installations intéressant la défense -DSND), ce
bilan est publié sur notre site Internet.
Nous mettons nos compétences au service des employeurs, médecins
du travail et personnes compétentes en radioprotection
(PCR) : à la demande de l’employeur, nous intervenons pour
évaluer le risque et réaliser des études de poste, en particulier
sur des cas complexes nécessitant un point de vue d’expert.
L’Institut propose également des prestations pour assurer la
surveillance de l’exposition des travailleurs : dosimétrie
externe, mais aussi évaluation de l’exposition interne depuis les
analyses individuelles permettant de détecter cette exposition
jusqu’au calcul de la dose engagée.
Par ailleurs, l’Institut en sa qualité de gestionnaire du
registre national des données du suivi de l’exposition des
travailleurs, met à disposition des acteurs de terrain de la
radioprotection (médecins du travail et PCR), les informations
dosimétriques des travailleurs qu’ils suivent, via le système
SISERI.
Enfin, nous avons aussi un rôle de conseil, d’information
vis-à-vis des différents acteurs de la radioprotection sur le
terrain et de formation (l’IRSN possède un département
enseignement).
Prév. - Revenons à ces bilans que vous publiez chaque
année. Quel est l’impact de tels travaux ?
P.S. - Le premier objectif de notre synthèse
annuelle est de faire un état des lieux exhaustif de l’exposition
des travailleurs aux rayonnements ionisants en France. En 2010,
plus de 330 000 travailleurs, dans différents secteurs
d’activités ont été suivis, car susceptibles d’être exposés à des
sources artificielles de rayonnements ionisants (nucléaire,
industrie, recherche, médecine, activités de défense) et 20 000 à
des sources naturelles (aviation, industries confrontées à la
présence sur le lieu de travail de radionucléides naturels non
utilisés pour leurs propriétés radioactives).
La réglementation impose une surveillance dosimétrique de ces
travailleurs dont l’exposition doit rester en deçà de valeurs
limites.
Le but de notre surveillance est de s’assurer non seulement du
respect des valeurs limites annuelles d’exposition (20 mSv en
dose efficace, 500 mSv en dose équivalente aux extrémités et 150
mSv en dose équivalente au cristallin), mais aussi d’analyser les
niveaux d’exposition en fonction des domaines et secteurs
d’activité des travailleurs.
Ce rapport annuel est demandé par les pouvoirs publics qui
souhaitent une connaissance précise de la situation pour pouvoir
prendre les mesures de prévention adéquates, voire faire évoluer
la réglementation. Elle est également utile aux professionnels de
la santé en entreprise, aux experts en radioprotection.
Prév. - La surveillance des expositions professionnelles
aux rayonnements ionisants est-elle suffisamment connue et
comprise par les préventeurs ou médecins du travail
?
P.S. -La fréquence annuelle de cette étude
permet de constater que la situation s’améliore d’année en
année : l’exigence de la réglementation française
(transposée de la réglementation européenne, plus stricte sur
certains points) a eu une influence positive sur le développement
de la prévention des risques.
La surveillance est bien maitrisée, depuis longtemps, par les
médecins du travail et professionnels œuvrant notamment dans
l’industrie nucléaire – les premiers décrets relatifs à la
radioprotection des travailleurs datent de 1966. En revanche, il
est plus difficile pour un médecin du travail qui n’est que
rarement confronté au risque radiologique de s’y retrouver dans
l’imposante et complexe législation en la matière. Dans les
entreprises, les médecins et services de santé suivent des
travailleurs exposés parfois à de multiples risques et il n’est
pas évident d’être spécialiste en tout !
Lors de notre première participation à Préventica, de nombreux
médecins du travail et préventeurs sont venus nous interroger à
ce sujet : ils sont parfaitement conscients de la
problématique, de l’étendue de la réglementation, de leurs
lacunes. Notre mission est ainsi de leur donner les premières
clés pour s’y retrouver.
Prév. - À ce titre, vous présentez une synthèse du suivi
de l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants lors
du Congrès de Préventica Strasbourg à la fin du mois de mai.
Expliquez-nous.
P.S. - Cet exposé a pour objectif d’apporter aux
médecins du travail et préventeurs présents à Préventica un
éclairage très concret du suivi de l’exposition des travailleurs
aux rayonnements ionisants. Ainsi, après un rappel des principaux
aspects réglementaires, nous expliquerons très concrètement
comment mettre en place la surveillance d’un travailleur soumis à
des rayonnements (qui surveiller ? Quel type de dosimétrie
mettre en œuvre ?...) et donnerons des informations sur le
traitement des données de surveillance ainsi collectées.
Enfin, nous présenterons le système SISERI (centralisation
nationale des données) et présenterons le bilan de ces
expositions au niveau national avec les secteurs d’activité dans
lesquels les travailleurs sont les plus exposés.
Prév. - Cette nécessaire communication sur le suivi des
expositions aux rayonnements explique-t-elle votre participation
au Congrès / Salon Préventica Lyon 2011 ?
P.S. - Bien sûr ! De par mon activité, je
suis souvent en contact avec les médecins du travail et les
personnes compétentes en radioprotection. Je me rends
parfaitement compte de l’importance de communiquer sur ce
point : une meilleure connaissance du dispositif national de
radioprotection et du suivi de l’exposition permettra d’améliorer
le système de prévention et donc de protection. C’est également
une opportunité de faire connaître l’étendue de l’expertise de
l’IRSN et le panel de nos prestations en la matière. Nous sommes
experts publics sur le sujet, mais tout le monde ne le sait
pas.
Notre participation à Préventica l’an dernier nous a confrontés
aux demandes des acteurs de la prévention dans les entreprises et
à leurs questionnements : cette première expérience nous
permet désormais de mieux répondre à la demande des visiteurs,
tous secteurs confondus.