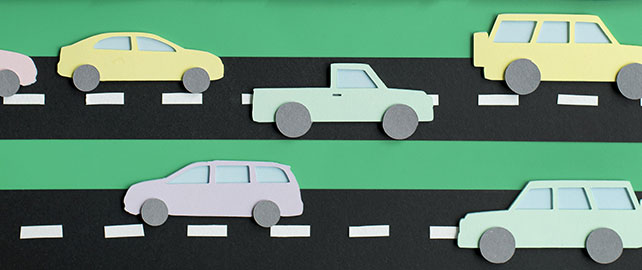Cela fait 30 ans que vous travaillez sur l’évaluation du
facteur humain, quels enseignements pouvez-vous nous faire
partager ?
Effectivement cela fait 30 ans que je pratique l’évaluation de
femmes et d’hommes dans divers contextes : le recrutement,
la formation, l’évaluation obligatoire ou le reclassement. Cela
fait aussi 30 ans que je me bats contre les
« psychopitreries » qui voudraient nous faire tester
les gens sans les écouter, en les rangeant dans des cases, sur la
base de tests psychotechniques d’un autre âge.
On ne peut plus aujourd’hui décemment évaluer des salariés sans
s’occuper de leurs compétences, de leurs motivations et du
pourquoi de leur évolution de carrière. Il faut sortir d’un
jugement caricatural « j’aime/j’aime pas » pour
s’intéresser à la personne afin de l’aider à progresser, à se
perfectionner et à atteindre ses objectifs, en phase avec ceux de
l’organisation.
Quels outils pratiques proposez-vous pour évaluer de
façon pertinente le facteur humain ?
Dans le cadre du projet européen Leonardo da Vinci, nous
travaillons au développement d’un référentiel de compétences qui
se décline sur trois axes : les compétences relationnelles,
les compétences techniques et les compétences d’efficacité
personnelle. L’évaluation du facteur humain ne peut être
constructive que si elle s’appuie sur une attitude du manager
bienveillante et ouverte à la concertation, en pratiquant une
méthode de dialogue.
Vous êtes très critique sur la prévention des risques
psychosociaux dans les grands groupes…
Les risques psychosociaux sont une conséquence de la
dévalorisation du facteur humain par les dirigeants. En effet, ce
n’est pas de la prévention ! Lorsque l’on appelle un cabinet
spécialisé sur ce type de problématique, c’est que l’incendie est
déjà là et qu’il faut éviter qu’il se propage. On a totalement
oublié que l’homme est et doit rester au centre du système de
production et de service. Quand on le remplace par des robots ou
des systèmes sophistiqués de contrôle, les effets indésirables
surviennent : des troubles de plus en plus graves dans les
relations et une baisse des performances. Seules quelques grandes
majors américaines et quelques françaises, ont placé le bien-être
de leurs salariés au centre de leur politique générale et ces
entreprises s’en portent mieux que les autres.
Une situation encore pire dans le secteur de la
santé ?
Le secteur de la santé a 40 ans de retard sur le privé.
J’interviens régulièrement auprès de directions d’établissements
de ce secteur et je rencontre des comportements aberrants, de
l’ordre du féodal. A l’hôpital en particulier, les conflits
d’intérêts entre les grands mandarins, les administratifs, les
soignants et l’intérêt des patients produisent des résultats
désastreux. Certains directeurs ont décidé de prendre le problème
à bras le corps mais il y a une telle résistance au changement
dans les hautes sphères médicales que les effets restent très
timides.
Et puis, il y a un écran de fumée technocratique autour de la
fusion d’établissements, soi-disant nécessaires pour réaliser des
économies d’échelle qui oublient totalement le gaspillage humain
qui en découle : on ne fusionne pas diverses structures en
négligeant de préparer au changement les équipes concernées. En
réalité ces fusions risquent de n’avoir aucune efficacité et
produisent plus de gâchis que d’économies.
Comment jugez-vous la pratique managériale à la
française ?
En médecine, comme dans d’autres secteurs d’activité, toute
notion de management est carrément absente des programmes alors
que ces chefs de service devront manager et faire évoluer leurs
équipes.
En outre, les écoles de management françaises ne savent pas
former au leadership et encore moins développer les compétences
relationnelles. Les étudiants n’y apprennent pas à motiver,
entraîner l’adhésion, prendre la parole en public ou savoir
écouter. Dans la culture anglo-saxonne, dès le plus jeune âge et
tout au long de leur formation, les étudiants sont entraînés à
faire des exposés, à s’affirmer en jouant un rôle décisif au sein
d’un groupe de travail. Plus tard, ils sont capables de maîtriser
des négociations de haut vol, d’aller au-devant des autres
beaucoup mieux que nos jeunes français, très égocentriques et
pour qui le « facteur humain » est au mieux une
variable d’ajustement, au pire une source de problèmes… Ils ont
donc tout intérêt à l’appréhender par le dialogue et à le manager
par les compétences, ce qui nécessite deux méthodes d’évaluation
inséparable.

En savoir plus
- Le grand guide de l’évaluation du facteur humain – Alain Labruffe, Afnor Editions, nov. 2012